





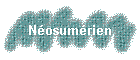

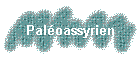
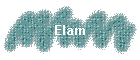


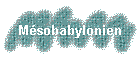




A - J. ABOUD, Die Rolle des Königs und seiner Familie nach den Texten von Ugarit, Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte 27, Münster , 1994, xi + 217 p.: étude de la famille royale à partir des archives d'Ugarit et de Ras Ibn Hani. L'a. s'intéresse d'abord à la chronologie des rois, à partir de KTU 1.113, puis se penche sur les relations internationales à travers l'analyse des traités diplomatiques, des mariages dynastiques et du commerce international. L'exercice du pouvoir est examiné à travers divers thèmes: le roi comme propriétaire supérieur du sol, comme juge suprême, comme maître du commerce terrestre et maritime; rôle de la reine et des palatins; rôle cultuel du roi et importance de la religion (la légitimité repose sur le culte des ancêtres divinisés). - D. ARNAUD, “Prolégomènes à la rédaction d'une histoire d'Ougarit I. Ougarit avant Suppiluliuma Ier", SMEA 39/2, 1997, p. 151-162: étude de l'histoire d'Ugarit antérieure au XIVe s., à partir de l'inscription conservée sur un éclat de statue; des légendes des sceaux-cylindres paléo-babyloniens, un bordereau d'Alalakh où figure le nommé Burruqu n'est pas roi d'Ugarit mais un simple ressortissant de cette ville; de la continuité entre Bronze moyen et Bronze récent; des rapports entre Ugarit et le Mitanni à partir de AT 4, qui montre qu'aucune convention d'extradition n'existait entre Ugarit et Alalakh et que Ugarit n'appartenait pas au Mitanni; du sceau de Yaqaru, perçu comme le refondateur de la dynastie au pouvoir. - E. AUERBACH, “Heirloom Seals and Political Legitimacy in Late Bronze Age Syria", Akkadica 74-75, 1991, p. 19-36: sur le réemploi des sceaux de famille par les rois d'Alalakh et d'Ugarit aux XIVe-XIIIe s. L'utilisation de ces sceaux familiaux souligne la légitimité de la succession au trône du roi régnant, spécialement lorsqu'il a usurpé le pouvoir (tel était le cas de Niqmepa, successeur d'Idrimi).
B - M. BALDACCI, La scoperta di Ugarit. La città-stato ai primordi della Bibbia, Casale Monferrato, 1996: manuel historique étudiant les rapports entre Ugarit et la Bible, l'archéologie, le contexte politique syrien à l'âge du Bronze et les textes mythologiques.
C - A. CAUBET, "Reoccupation of the Syrian Coast After the Destruction of the ‘Crisis Years'", in: Crisis Years, p. 123-131: la fin de la civilisation palatiale du littoral syrien, due à des facteurs externes et internes, n'a pas empêché la réoccupation des sites. Rien ne prouve que ces occupants aient fait partie des Peuples de la mer. - Y. COHEN et I. SINGER, "A Late Synchronism between Ugarit and Emar", in: Fs Na'aman, 2006, 123-138 : étude d'une lettre provenant des archives d'Urtenu à Ougarit (RS 34.152). Le contexte historique ainsi que la datation de ce document (par une étude prosopographique et une analyse du ductus) est confronté aux données issues des tablettes d'Emar.
K - H. KLENGEL, “Epidemien im spätbronzezeitlichen Syrien-Palästina", in: Fs Heltzer, p. 187-193: à propos des épidémies (mûtânu) dans la Syrie de l'âge du Bronze, notamment la “maladie cananéenne".
L - S. LACKENBACHER, “Les relations entre Ugarit et l'Egypte. A propos d'un texte inédit", in: Relations internationales, p. 107-118: étude d'une des rares lettres d'Egypte trouvées à Ugarit, envoyée par la chancellerie égyptienne au roi d'Ugarit pour annoncer l'envoi d'ouvriers ébénistes et de cadeaux (kubbuttatu). Ce document illustre le type de relation habituel entre deux pays en temps de paix, et montre que les liens avec l'Egypte n'ont jamais disparu, malgré l'allégeance aux Hittites. - EADEM, “La correspondance internationale dans les archives d'Ugarit", RA 89, 1995, p. 67-76: une partie de la correspondance internationale d'Ugarit a été retrouvée dans deux maisons “de fonction", hors du palais. - M. LIVERANI, "Mesopotamian Historiography and the Amarna Letters", RAI 45, p. 303-311: sur l'histoire officielle telle qu'elle est exposée dans la correspondance d'Amarna. L'a. s'intéresse au traitement de l'avènement du roi dans EA 17 et dans l'inscription de la statue d'Idrimi, et au dossier concernant Burna-Buriaš II, afin de montrer combien le discours historique diffère dans les deux cas tout en restant un enjeu politique essentiel. – IDEM, "The Great Powers' Club, in: Diplomacy, p. 15-27: préconisant une lecture “primitiviste" des lettres d'Amarna (i.e. sans recours aux concepts modernes), l'a. évoque les expressions utilisées dans les textes (formules juridiques ou métaphores quotidiennes, notamment celles de la famille ou du voisinage), et présente les principales caractéristiques formelles de la correspondance diplomatique et les modes de règlement des conflits. Ils consistent surtout en un compromis préservant à la fois le prestige du roi vis-à-vis de sa population et les intérêts internationaux. – IDEM, "An additional suggestion on EA 101", NABU 2002/10: relecture des ll. 11-12 de la lettre concernant la mort d'Abdi-Aširta. – IDEM, "An additional suggestion on EA 112", NABU 2002/11: l'a. confirme le sens de ištu aux ll. 10-12, "de quoi devrais-je me protéger, de mes ennemis ou de mes paysans?", notamment grâce au parallèle avec II Rois 6:27.
M - W. MAYER, “Die historische Einordnung der ‘Autobiographie' des Idrimi von Alalah", UF 27, 1995, p. 333-350: l'a. tente de reconstituer le contexte et la chronologie du règne d'Idrimi à partir de l'inscription sur la statue de ce roi. Réfugié à Emar après la mort de son père Ilim-ilimma, prince de Mukiš, lors de la prise d'Alep par les Hittites, Idrimi commence sa carrière politique après la bataille de Megiddo (1468) en s'alliant avec les Egyptiens dans les démêlés autour de Canaan. Prenant la tête de groupes de mercenaires, il combat comme force d'appoint aux côtés des Egyptiens à partir de 1465. Vers 1458, ayant reconquis Mukiš, il s'engage volontairement dans la vassalité de Barattarna, roi du Mitanni, et cesse toute collaboration avec l'Egypte. Le silence de l'inscription quant à la réconciliation entre le Mitanni et l'Egypte indique qu'Idrimi était déjà mort au moment de ce rapprochement, ce qui place son règne entre 1457/6 et 1427/6. - W. L. MORAN, “Some Reflections on Amarna Politics", in: Fs Greenfield, p. 559-572: contre l'opinion de M. Liverani, pour qui les obscurités de la correspondance entre suzerain égyptien et vassaux amarniens proviennent d'une conception radicalement différente des relations d'inférieur à supérieur, l'a. souligne plutôt le décalage entre le discours politique autoritaire de l'Egypte et la réalité du terrain, plus souple et laissant croître un pouvoir local contrôlé.
N - N. NA'AMAN, “Ammishtamru's Letter to Akhenaten (EA 45) and Hittite Chronology", Aula Orientalis 14, 1996, p. 251-257: nouvelle interprétation de la lettre EA 45. Le pharaon auquel cette lettre est adressée serait Akhénaton et se réfèrerait au conflit entre Ammistamru et Niqmepa évoqué dans le traité entre Aziru et Niqmadu II d'Ugarit. - IDEM, “Looking for the Pharaoh's Judgment", RA 90, 1996, p. 145-159: l'a. étudie deux épisodes relatés par les lettres d'El Amarna et dans lesquels le roi de Byblos réclame l'intervention et le “jugement" du pharaon.
O - J. C. OLIVA, "Alalah VII Chronolographica. Una revisión del archivo sobre la base de los textos de Yarim-Lim", in: Fs Del Olmo Lete, p. 229-239: l'analyse du corpus daté ou datable mentionnant le nom royal Yarim-Lim fait ressortir l'existence de 4 archives à l'intérieur desquelles l'a. propose un classement chronologique par souverain.
V - S. VON REDEN, Ugarit und seine Welt. Die Entdeckung einer der ältesten Handelsmetropolen am Mittelmeer, Bergisch Gladbach, 1992, 376 p., ill., index: synthèse sur l'histoire du royaume d'Ugarit, depuis l'apparition des premiers villages, vers 6500, jusqu'à la fin de la dynastie au XIIe s. L'a. examine l'environnement géographique et culturel, notamment la culture urbaine, la religion et les textes sapientiaux, et analyse les relations avec l'Egypte et le Hatti.
Y - M. YON, "The End of the Kingdom of Ugarit", in: Crisis Years, p. 111-122: l'attaque du royaume par les Peuples de la mer a provoqué la destruction du système politique et la fuite de la population vers l'arrière-pays. L'effondrement d'Ugarit est intervenu vers 1190-1185.
Z - F. ZEEB, "Tell Leilan und die Gründung des altbabylonischen Alalah", UF 23, 1991, p. 401-404: contre M. Heinz qui propose, sur des arguments archéologiques, une chronologie courte pour Alalah VII, allant du milieu du XVIIe s. jusqu'à 1575. Les textes de Leilan, montrant le synchronisme entre Mutia et Hammurabi d'Alep, permettent au contraire de reconstituer l'histoire d'Alalah sur une période plus longue et fournissent un terminus non ante.
A - D. ARNAUD, “Hazor à la fin de l'âge du Bronze d'après un document méconnu: RS 20.225", AuOr 16, 1998, p. 27-35: la relecture du fragment de lettre RS 20.225 montre que Hazor est une place forte à la fin du Bronze, dont le panthéon est dominé par Addu, dieu de l'Orage. De par sa langue et son protocole, cette lettre s'apparente à la documentation de Tyr.
D - M. DIJKSTRA, "The Weather-God on Two Mountains", UF 23, 1991, p. 127-140: contre les proposition de P. Bordreuil d'identification du village de Nanû avec le mont Nana, et d'équation Halbi du mont Hazi = Halbi du mont Nanâ. Le mont Nanâ se situe ailleurs, au nord du Gebel el-Nusairiye.
K - Z. KALLAI, "EA 288 and biblical history", RB 108, 2001, p. 5-20: dans la lettre EA 288, le roi de Jérusalem définit un horizon géographique allant "aussi loin que les territoires de Séïr et que Gath-Carmel". Cette délimitation à partir de Gaza trace une frontière entre nomades et sédentaires, et place la limite sud selon un schéma hérité de la tradition scribale israélite. Séïr se trouve en Transjordanie du sud plutôt que dans le Néguev.
V - W. VAN SOLDT, “Studies in the Topography of Ugarit (I). The Spelling of the Ugaritic Toponyms", UF 28, 1996, p. 653-692. - IDEM, “Studies in the Topography of Ugarit (2)", UF 29, 1997, p. 683-703: étude des frontières d'Ugarit d'après les éléments qu'en donnent les traités internationaux hittites. – IDEM, "Studies in the Topography of Ugarit (3) Groups of Towns and their Locations", UF 30, 1998, p. 703-744: étude des toponymes attestés dans les textes administratifs. - IDEM, "Studies in the Topography of Ugarit (4). Town sizes and districts", UF 31, 1999, p. 749-776: les divisions administratives du territoire d'Ugarit ne sont pas nommées par l'administration locale, à l'exception de la région entourant Ugarit jusqu'à la frontière sud, appelée 'arr. Le terme fréquent gr "montagne" est une vague localisation des villages dans les régions montagneuses. L'évaluation de la taille des villes d'après les listes de taxation montre une concentration urbaine dans les plaines fertiles du sud et du sud-est, et, dans une moindre mesure, dans la campagne vallonnée du centre; les provinces montagneuses du nord et du nord-est sont composées de petits villages.
Z - F. ZEEB, “Die Ortsnamen und geographischen Bezeichnungen der Texte aus Alalah VII", UF 30, 1998, p. 828-886.
A - D. ARNAUD, “Les ports de la ‘Phénicie' à la fin de l'âge du Bronze récent (XIV-XIII siècles) d'après les textes cunéiformes de Syrie", SMEA 30, 1992, p. 179-194: les sources de Ras Shamra documentent le rôle essentiel de Sidon et les institutions de cette ville: la royauté y est dynastique, transmise en ligne masculine et contrebalancée par l'autorité des Anciens comme le montre un conflit à propos de la punition de blasphémateurs ugaritains. La réparation pécuniaire ordonnée par le roi après des rituels d'offrandes est dénoncée par la ville qui réclame la lapidation des fautifs et l'exposition de leurs corps. - D. ARNAUD et M. SALVINI, “Le divorce du roi Ammistamru d'Ougarit: un document redécouvert", Sémitica 41-42, [1991-1992], 1993, p. 7-22: les aa. reprennent le dossier du conflit opposant Ammistamru à son épouse fugitive, et l'enrichissent d'un nouveau texte publié en éd. complète. Il s'agit d'un duplicat de l'une des nombreuses versions du premier jugement rendu dans cette affaire, prononçant le divorce et assignant la femme à résidence en Amurru. - M. C. ASTOUR, "The Hapiru in the Amarna Texts. Basic Points of Controversy", UF 31, 1999, p. 31-50: synthèse sur les divers sens proposés pour le mot hâbiru, depuis l'interprétation de Zimmern dans les sources d'El Amarna, qui y voyait une désignation des Hébreux, jusqu'aux travaux sur Mari, rattachant les hâbiru au monde nomade. L'a. ajoute au dossier une lettre paléo-babylonienne de Šulgi où les hâbiru sont décrits comme des nomades, et les lettres de Kâmid el-Lôz, identifiées comme amarniennes d'après leur orthographe et leur formulaire (cf. Edzard), et montrant les hâbiru d'Egypte comme des prisonniers de guerre qui installaient leurs tentes dans les pâturages syriens. La bibliographie sur Mari doit être complétée avec l'interprétation "émigré/immigré" de J.-M. Durand pour Mari (cf. LAPO 17, p. 374-375).
C - R. COHEN et R. WESTBROOK, "Introduction: The Amarna System", in: Diplomacy, p. 1-12: présentation des objectifs des aa. dans leur approche du sujet. Partant d'un tableau général du système des relations internationales, qui fixe le contexte politique dans lequel les différentes composantes agissent, les contributions se concentrent ensuite sur la politique étrangère et impériale égyptienne et sur les aspects pragmatiquees de la diplomatie (échanges de biens, dieux, personnes; stratégies de négociation; mise en œuvre des alliances). Le tout s'inscrit dans une démarche consistant à appliquer à la correspondance d'El-Amarna des grilles de lecture issues des sciences sociales, notamment des relations internationales et des sciences politiques. Amarna représente le premier véritable système international: les grandes puissances couvrent l'ensemble du Proche-Orient et s'organisent entre elles pour établir un réseau complexe de relations dynastiques, commerciales et stratégiques, dont la gestion politique est assurée par la diplomatie, chargée de représenter les grands rois et de conduire les négociations. – EIDEM, "Conclusion: The Beginnings of International Relations", in: Diplomacy, p. 225-236: principales conclusions tirées de l'approche interdisciplinaire des sources d'Amarna. Le système repose sur la notion d'échanges (commerciaux, dynastiques, culturels) instaurant l'interdépendance de tous les grands rois, qui sont liés sur le mode de la fraternité (ahhûtu). La pertinence des grilles de lecture moderne appliquées à la correspondance amarnienne divise historiens et politistes. De véritables structures juridiques internationales sont mises en place qui reposent sur des bases ontologiques différentes des nôtres mais fonctionnellement équivalentes. Est aussi débattue la question d'une Realpolitik des Égyptiens, cherchant un équilibre des pouvoirs à travers des stratégies de coalition (surtout via les mariages diplomatiques) destinées à bloquer une opposition potentielle. La longévité du système (plus de 200 ans) s'explique par la parité des souverains impliqués et la politique de prévention des conflits.
D - M. DIETRICH et O. LORETZ, “Schiffshandel und Schiffsmiete zwischen Byblos und Ugarit (KTU 4.338:10-18)", UF 22, 1990, p. 89-96: à propos d'un texte concernant l'achat par le roi d'Ugarit de bateaux au prince de Byblos. Ce contrat envisage à la fois l'achat et la location de bateaux. Ainsi s'expliquent, à la lumière du droit comparé (LE et CH), les différents prix consignés dans l'acte.
H - M. HELTZER, “Vineyards and Wine in Ugarit (Property and Distribution)", UF 22, 1990, p.119-135: les vignobles d'Ugarit étaient privés, ou concédés par le roi en rémunération de services ou encore détenus collectivement. L'a. examine la production et sa répartition (consommation cultuelle, stockage pour la consommation royale), ainsi que la distribution mensuelle de vin. - IDEM, "New Evidence about Tribute from Ugarit to the Hittite King (KTU 4.610 and RS 92.2001+92.2002)", UF 35, 2003, p. 238-242 : sur deux listes de tributs destinés à mon Soleil, le Grand Roi de Hattuša. Ces listes mentionnent le nom de 82 villages selon la reconstruction de l’a. - R. S. HESS, “Alalakh Studies and the Bible: Obstacle or Contribution?", in: M. D. Coogan et al. éd., Scripture and Other Artifacts. Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King, Louisville, 1994, p. 199-215: le hupšu à Alalah présente des ressemblances avec le hopšî biblique, et a un statut social semblable à celui du hapiru d'Ugarit et de la correspondance d'Amarna. - IDEM, “A Comparison of the Ugarit, Emar and Alalakh Archives", in: Fs Gibson, p. 75-83: étude comparative des trois sites contemporains d'Ugarit, Emar et Alalah, pour souligner les différences entre les archives de ces trois villes (palatiales, templières ou “privées"; contenu administratif ou économique) et les comparer avec celles d'autres cités de la fin du Bronze. - IDEM, "Canaan and Canaanite at Alalakh", UF 31, 1999, p. 225-236: l'analyse des six occurrences des mots "Canaan" et "Cananéen" dans les textes d'Alalakh (niveau IV + l'inscription d'Idrimi) montre la diversité sociale de cette population, bien intégrée dans la société à des niveaux très élevés ou au contraire modestes. - J. HOFTIJZER et W. H. VAN SOLDT, "Texts from Ugarit concerning Security and Related Akkadian and West Semitic Material", UF 23, 1991, p. 189-216: analyse de plusieurs transactions d'Ugarit, d'Emar et d'Alalakh, assorties de sûretés ou de gages pour le créancier. Les sources emploient indifféremment le terme qâtâtu pour désigner le gage et la sûreté.
L - S. LACKENBACHER, “Un contrat d'adoption en fraternité", in: Fs Garelli, p. 341-343: éd. d'un contrat d'adoption passé devant le bourgmestre d'Ugarit, n'emportant aucune pénalité en cas de rupture unilatérale du contrat. - E. LIPINSKI, "Arcanes et conjonctures du marché immobilier à Ugarit et à Emar au XIIIe s. av. n. è.", AOF 19/1, 1992, p. 40-43: comparaison des actes de vente foncière à Ougarit et à Emar. Les donations royales d'Ugarit sont en réalité des ventes déguisées. Les clauses pénales des contrats d'Emar contiennent de lourdes amendes payables au Palais, au temple ou à la ville. - IDEM, "Arcanes et conjonctures du marché immobilier à Ugarit et à Emar au XIIIe s. av. n.è.", AOF 19/1, 1992, p. 40-43. - M. LIVERANI, "2 Kings 5:5-6 in the Light of the Amarna Letters", in: Gs Cagni, vol. 3, p. 1709-1718: étude des mécanismes de communication épistolaire dans la lettre du roi d'Aram au roi d'Israël (II R 5:5-6), montrant que l'arrivée d'un personnage important est précédée de l'envoi d'un messager rapide chargé de prévenir les autorités locales afin d'organiser l'accueil du visiteur. La même procédure est attestée dans les lettres d'El-Amarna: le pharaon envoie une lettre annonçant l'arrivée d'un dignitaire et demandant au roi local de se préparer à le recevoir selon les formes dues à son rang. Les critiques (Moran, Na'aman) grammaticales adressées à cette théorie sont réfutées par l'a. qui présente une série d'exemples à l'appui de sa démonstration. – IDEM, "The Influence of Political Institutions on Trade in the Ancient Near East (Late Bronze to Early Iron Age)", in: Mercanti, p. 119-137: durant le Bronze récent, le commerce est centré et organisé autour du palais, des agents royaux et des villes royales. A l'âge du Fer, le commerce est l'affaire de groupes spécialisés (marchands sur la côte méditerranéenne, caravanes de chameaux dans le désert). Ce sont désormais les stratégies commerciales qui déterminent les décisions politiques. Les horizons géographiques s'élargissent considérablement, et les routes commerciales relient villes et ports spécialisés dans le commerce avec les lieux d'approvisionnement en métaux et biens exotiques. L'impulsion n'est plus donnée par l'Etat et les grandes places commerciales traditionnelles mais par de nouveaux établissements plus petits.
M - F. MALBRAN-LABAT, "Les textes akkadiens découverts à Ougarit en 1994", RAI 42, p. 237-244: sur les apports des textes de la Maison d'Urtenu à la connaissance des activités économiques, des relations internationales et de l'urbanisme d'Ugarit, dans la période des 30 dernières années du royaume. - I. MARQUEZ ROWE, “KTU 3.7 reconsidered. On the ilku-service in Ugarit", AuOr 11, 1993, p. 250-252: ce texte n'est pas un contrat impliquant une série d'individus envers un nommé Msry, mais un texte administratif énumérant des Egyptiens d'Ugarit astreints au service-ilku comme d'autres habitants du pays. Le document révèle aussi les deux formes de recrutement pour ce service, d'après la compétence professionnelle ou le lieu de résidence. Il y a là un reflet de l'organisation bipartite de la société d'Ugarit à la fin du IIe millénaire, divisée en secteur “libre" dans les villages et secteur “palatial" regroupant divers métiers. Il semble que l'ilku dû par les Egyptiens ait été de nature militaire. - IDEM, “More Evidence of the Grazing Tax in Ugarit", UF 27, 1995, p. 317-331: à propos du terme maqqadu “droit de pacage", analysé dans deux documents (PRU 3, 146 et PRU 6, 116). Il s'agit d'une taxe urbaine, due par les villageois au roi, propriétaire foncier, et portant sur des moutons et des chèvres. - IDEM, "The King's Men in Ugarit and Society in Late Bronze Age Syria", JESHO 45/1, 2002, p. 1-19: nouvel examen de l'akkadien bunusu malki, “hommes du roi" à Ugarit, et du hurrite e'gelli “celui qui a été sauvé" à Alalakh. Comme les amîlûtu d'Emar, ces deux catégories de personnes sont astreintes à des obligations liées non pas à la corvée due à la couronne mais à leur incapacité à rembourser les dettes qu'elles ont contractées.
S - J. SANMARTĺN, “Wirtschaft und Handel in Ugarit: Kulturgrammatische Aspekte", in: Ugarit I, p. 131-158: à travers l'étude du vocabulaire économique, l'a. l'existence de formes de capitalisme à Ugarit, à travers ce qu'il appelle le “ba’alisme", combinant un aspect privé (“patrimonialité") et un aspect public (instance étatique). - J. D. SCHLOEN, The House of the Father as Fact and Symbol. Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East, SAHL 2, 2001, xv + 414 p. - L. SHEDLETSKY et B. A. LEVINE, “The mšr of the Sons and Daughters of Ugarit (KTU2 1.40)", RB 106, 1999, p. 321-344: la tablette KTU2 1.40 est une adaptation des édits de mîšarum babyloniens, et dépeint un rite associant l'ensemble des citoyens d'Ugarit, qui promettent de remédier aux doléances des habitants d'autres localités.
T - O. TAMMUZ, “Justice, Justice Shall You Pursue", UF 29, 1997, p. 641-653: 4 affaires judiciaires concernant des Ugaritains montre que le roi d'Ugarit tente par tous les moyens de décourager les étrangers réclamant justice contre l'un de ses sujets. L'a. explique cette attitude par le souci pour le monarque de conserver une main d'œuvre suffisante dans son pays, leur assurant une protection au mépris même des intérêts de la justice. - A. TSUKIMOTO, "An Akkadian Field Sale Document Privately Held in Tokyo", ASJ 14, 1992, p. 311-315: éd. complète d'un contrat de vente foncière. La clause pénale prévoit le paiement de 1000 sicles d'argent à Ninurta et à la ville en cas de contestation.
V - W. VAN SOLDT, "De stad Ugarit", Phoenix 36/2, 1990, p. 9-30: synthèse sur la société d'Ugarit, sa population, son architecture, ses activités économiques et son administration. - IDEM, “PRU 6 no. 78 (RS 19.41) Towns in the land of Siyannu or in the land of Ugarit?", in: Fs Loretz, p. 777-784: la liste de personnes PRU 6 78 détermine la ville d'origine des individus répertoriés, indiquant ainsi que l'administration surveillait les déplacements de citoyens. Les toponymes cités appartiennent au royaume d'Ugarit. Un appendice aux dernières lignes du texte indique que certaines personnes de Qaratu vivaient dans le pays de Siyannu. - IDEM, "Studies on the sâkinu-Official (1). The spelling and the office-holders at Ugarit", UF 33, 2001, p. 579-600: présentation du corpus des sources et étude des noms de personnes citées comme sâkinu, accompagnée des toponymes et dates d'exercice de leurs fonctions. Il en ressort une forte proportion de NP hurrites, deux fois plus nombreux que les NP ouest-sémitiques. - R. VAN WALSEW, "De stad Amarna: exponent van traditie vernieuwing en ideologie", Phoenix 36/2, 1990, p. 31-50: étude de l'idéologie royale à travers la statuaire et l'architecture. - P. VARGYAS, “Immigration into Ugarit", in: Fs Lipinski, p. 395-402: à propos du terme ubru, qui désigne un immigré sans doute de condition sociale modeste, par comparaison avec les occurrences akkadiennes de ce terme, notamment le § 41 LE (ubârum). L'ubru était un dépendant du roi, astreint à un service militaire ou civil, ne pouvant acquérir des biens fonciers et donc privé de droits civiques. Son statut se rapproche de celui du métèque grec.
W - W. G. E. WATSON, “Ugaritic Onomastics (3)", AuOr 11, 1993, p. 213-222: suite des recherches de l'a. sur l'onomastique ugaritaine. L'a. examine notamment les NP composés en bt “fille (de)" et ceux qui comportent une forme verbale féminine. - R. WESTBROOK, "International Law in the Amarna Age", in: Diplomacy, p. 28-41: définition des notions d'Etat, de droit international, reposant à la fois sur des règles coutumières et des traités, pour lesquels l'a. examine les questions de leur base juridique, de leur formation et de leur typologie. Les traités trouvent leur place dans la conception égyptienne du droit international, au même titre que dans le système hittite.
Z - C. ZACCAGNINI, "Ceremonial Transfers of Real Estate at Emar and Elsewhere", VO 8/2, 1992, p. 33-48: la possession de la terre à Emar est organisée notamment dans le cadre du système des tenures, concédées à charge de services et pouvant être confisquées par le roi en cas d'inexécution des obligations du tenancier. D'autres types de propriété du sol existent également, reflétés par le grand nombre de documents concernant la vente. L'a. étudie les rites de la vente, scellée par un repas symbolisant l'accord des parties, le versement d'une contribution minime aux frères du vendeur pour écarter toute revendication familiale, et enfin la délivrance du kuluru conférant un titre complet de propriété. - IDEM, “TÉŠ.BI = mithâru/mithâriš at Emar and Elsewhere", Or 65/2, 1996, p. 89-110: contre l'opinion dominante, l'a. considère que cette formule, qui figure dans les contrats de vente foncière ou de personne et les contrats d'adoption à Emar, signifie que le vendeur peut reprendre l'objet vendu contre le remboursement de la somme versée plus un montant additionnel équivalent. Il s'agit donc toujours d'un paiement au double. Les sources sont classées en trois groupes: celles qui ne mentionnent pas le montant de la pénalité; celles qui montrent un montant différent du prix de vente; celles dans lesquelles la pénalité s'élève au double du prix de vente. La démonstration s'appuie également sur les sources paléo-babyloniennes, méso- et néo-assyriennes. - R. ZADOK, "Notes on the Emar Documentation", OLP 22, 1991, p. 27-55: l'a. dresse à partir des textes des tableaux généalogiques sur au plus 5 générations, et examine la répartition géographique de la population et, d'après l'onomastique, sa composition ethnique. - IDEM, "Notes on the West Semitic Material from Emar", AION 51, 1991, p. 113-137: étude du panthéon d'Emar à travers les noms divins. - F. ZEEB, “Studien zu den altbabylonischen Texten aus Alalah. III: Schuldabtrennungsurkunden", UF 25, 1993, p. 461-472: étude des cessions de dettes d'après les quatre exemplaires connus à Alalakh pour ce type de transaction. L'a. présente le formulaire invariable de ces documents: énoncé du montant de la dette que le créancier a “saisie" (isbat) sur le débiteur; mention du roi, subrogé dans les droits du créancier (sa présence souligne le rôle essentiel de l'économie palatiale à Alalakh sous le règne d'Ammitaqum, confirmé par les documents de créance et de gage remontant aussi à ce roi); clauses spéciales (transmission de la dette aux ayants droit). Dans l'ensemble, la servitude pour dette attestée dans la Syrie du début du IIe millénaire, rappelle celle de l'Antiquité gréco-romaine.
A - B. ANDRE-SALVINI et M. SALVINI, “Un nouveau vocabulaire trilingue sumérien-akkadien-hourrite de Ras Shamra", SCCNH 9, 1998, p. 3-40: éd. complète d'une tablette trilingue de lexicographie. - D. ARNAUD, "Contribution de l'onomastique du moyen-Euphrate à la connaissance de l'émariote", SEL 8, 1991, p. 23-46: l'étude des anthroponymes sémitiques de la vallée du moyen-Euphrate montre que l'émariote est une langue sémitique distincte de l'akkadien, appartenant au même groupe que l'arabe. - IDEM, “Jours et mois d'Ougarit", SMEA 32, 1993, p. 123-129: éd. de deux tablettes, un almanach et un texte administratif contenant une liste d'attribution de rations d'épeautre. - IDEM, "Une bêche-de-mer antique. La langue des marchands à Tyr à la fin du XIIIe siècle", in: Fs Del Olmo Lete, p. 143-166: identification morphologique de la langue attestée dans 13 lettres de la "maison d'Ourtenou" et rédigées à l'aide d'un dialecte simplifié du babylonien, utilisé - mais non inventé – par les marchands de Tyr comme marque de reconnaissance et d'identité de leur groupe. - P. ARTZI, “Nippur Elementary Schoolbooks in the ‘West'", RAI 35, p. 1-5: les manuels scolaires occidentaux d'El-Amarna (EA 350) et d'Ugarit (AS 16, 1965, p. 29ss) établis d'après un modèle de Nippur, reflètent les capacités d'adaptation linguistiques des régions de l'ouest. - IDEM, “Studies in the library of the Amarna Archive", in: Fs Artzi, p. 139-156: contrairement à l'avis formulé par G. Beckman, pour qui la littérature cunéiforme est secondaire dans les territoires sous influence égyptienne, le véhicule littéraire presque exclusif à l'ouest, à l'exception d'Ugarit, est le cunéiforme. Il en va de même en Canaan, où l'influence mésopotamienne s'est faite à travers la médiation de l'ouest. - IDEM, “EA 16", AOF 24/2, 1997, p. 320-336: trs, trd et commentaire de EA 16, une lettre d'Aššur-uballit au Pharaon Amenhotep IV, concernant la politique commerciale des deux Etats.
B - P. BORDREUIL (éd. ), Une bibliothèque au sud de la ville, Ras Shamra-Ougarit VII, Paris, 1991, 208 p.: éd. collective des tablettes akkadiennes et ougaritiques de Ras Shamra trouvées au cours des fouilles de 1973. Les sources akkadiennes, présentées par D. Arnaud et travaillées par F. Malbran-Labat et B. André-Salvini, intéressent la diplomatique (traité entre Hattušili III et Niqmepa), l'administration (listes diverses, bordereaux), la lexicographie et les relations épistolaires. La correspondance royale documente la stratégie militaire et atteste l'intervention du souverain dans des conflits entre particuliers, notamment dans un litige financier et dans une affaire de vente d'un marchand par son associé à des Egyptiens. Les textes ougaritiques sont étudiés par P. Bordreuil et D. Pardee. - P. BORDREUIL et D. PARDEE, "Catalogue raisonné des textes ougaritiques de la Maison d'Ourtenou", in: Fs Del Olmo Lete, p. 23-38: le lot comporte notamment 2 textes juridiques (un acte successoral; une vente foncière), 72 documents adminstratifs (bordereaux et listes), 26 lettres royales ou privées, 3 textes religieux (rituels), et 4 exercices scolaires.
C - G. CAMPS, "La narración de Gn 18, 1-15. Un trasfondo ugarítico?", in: Fs Del Olmo Lete, p. 39-43: étude parallèle d'un épisode de l'épopée d'Aqht et de Gen. 18:1-15. Dans les deux récits, l'annonce d'une descendance comme faveur divine (à Danilu ou à Sara, se tenant tous deux sur le seuil de leur porte) provoque le rire. Les deux récits s'inspirent d'un fond cultuel commun cananéen. - C. CHAIM, “The Ugaritic Hippiatric Texts. Revised Composite Text, Translation and Commentary", UF 28, 1996, p. 105-153: relecture des textes hippiatriques d'Ugarit, avec commentaire et analyse. - Z. COCHAVI-RAINEY, “Egyptian Influence in the Akkadian Texts Written by Egyptian Scribes in the Fourteenth and Thirteenth Centuries BCE", JNES 49/1, 1990, p. 57-66: étude de l'influence linguistique égyptienne sur les formules épistolaires akkadiennes rédigées par les scribes égyptiens. - EADEM, “The Style and Syntax of EA 1", UF 25, 1993, p. 75-84: étude rhétorique et syntaxique de la lettre EA 1, adressée par le Pharaon Amenhotep III à Kadašman-Enlil, roi de Babylone. - EADEM, “Egyptian Influence in the Amarna Texts", UF 29, 1997, p. 95-114: l'a. passe en revue les termes akkadiens pouvant avoir une étymologie égyptienne dans les lettres d'El-Amarna.
D - G. DEL OLMO LETE, “Once again on the ‘Divine Names' of the Ugaritic Kings. A Reply", AuOr 14, 1996, p. 11-16: réponse aux critiques de D. Pardee sur l'interprétation de la liste KTU 1.102:15-28 comme “noms divins" des rois d'Ugarit. - A. DEMSKY, “The Education of canaanite scribes in the Mesopotamian Cuneiform Tradition", in: Fs Artzi, p. 157-170: la littérature cunéiforme trouvée en Canaan et les tablettes d'El-Amarna éclairent les activités des écoles des scribes et leurs aspirations. - M. DIETRICH, “Aspects of the Babylonian Impact on Ugaritic Literature and Religion", in: Fs Gibson, p. 33-48: Ugarit a dû passer d'une culture alphabétique à une culture cunéiforme sous l'influence prédominante des Hittites dans le nord de la Syrie. La tradition de la littérature syro-babylonienne n'est pas ancienne et n'a donc pu se développer de manière indépendante. La littérature babylonienne étudiée dans les écoles d'Ugarit reflète des importations akkadiennes plus qu'une culture vivante. Les œuvres syro-babyloniennes de la seconde moitié du IIe millénaire n'ont pas eu d'influence déterminante sur la mythologie et les textes religieux d'Ugarit. - M. DIETRICH et O. LORETZ, "Rasuren und Schreibfehler in den keilalphabetischen Texten aus Ugarit. Anmerkungen zur Neuauflage von KTU", UF 26, 1994, p. 23-62: catalogue des «fautes de scribe∞ dans les textes ugaritiques et classification de ces erreurs et ratures. – EIDEM, “Ugaritisch it tyndr und hebräisch 'šh, šy (KTU 1.14 IV 38; 2.13: 14-15; 2.30:12-14a)", UF 26, 1994, p. 63-72: refusent l'équation de it (ug.) avec 'šh (héb.) “offrande" et de šy “cadeau" (héb.). - EIDEM, "Der Vertrag zwischen Ir-Addu von Tunip und Niqmepa von Mukiš", in: Fs Astour, p. 211-242: nouvelle éd. commentée du traité entre le roi d'Alalakh et celui de Tunip.
G - J. M. GALÁN, "EA 164 and the god Amun", JNES 51/4, 1992, p. 287-291: dans la lettre d'Aziru, gouverneur d'Amurru, à Dudu, haut fonctionnaire égyptien, envisageant un traité d'amitié entre les deux pays, l'expression dingir.a ne renvoie pas au dieu Amun, qui n'est plus honoré à la cour d'Egypte, mais constitue un terme volontairement très vague typique du langage diplomatique. - IDEM, “What is he, the dog?", UF 25, 1993, p. 173-180: l'appellation “chien" (kalbu) dans les lettres d'El-Amarna, notamment celles qui sont adressées au roi égyptien, n'est pas une insulte mais désigne une position d'infériorité. - A. GIANTO, “Subject Fronting in the Jerusalem Amarna Letters", Or 63, 1994, p. 209-225: étude syntaxique des 5 lettres d'Amarna. - IDEM, "Amarna Lexicography: the Glosses in the Byblos Letters", SEL 12, 1995, p. 65-73: sur les usages scribaux dans les gloses des lettres de Byblos. - IDEM, "Amarna Akkadian as a Contact Language", RAI 42, p. 123-132: les aberrations grammaticales et syntaxiques de l'akkadien d'El-Amarna ne résultent pas seulement de l'influence du langage local; elles témoignent aussi du développement d'un système linguistique propre, différent de l'akkadien et du substrat linguistique local, et fonctionnant comme un langage de contact dans une société multilingue. - J. C. GREENFIELD, "našû-nadânu and its Congeners", in: Kl. Schr. Greenfield, p. 720-724: rééd. de l'art. de l'a. publié dans réf, et concernant les formules de concession de terre à Ugarit.
H - J. HOFTIJZER, "Some Notes on the Ugaritic Text KTU 2.42 Lines 1-9", JEOL 34, 1995-1996, p. 73-80: étude d'une lettre d'Ugarit (KTU 2.42) en cunéiforme alphabétique. - J. HUEHNERGARD, “A Byblos Letter, Probably from Kâmid-el-Loz", ZA 86/1, 1996, p. 97-113: éd. complète d'une lettre envoyée au “grand homme" (lugal) - sans doute le gouverneur égyptien - de l'ancienne Kumidi. L'expéditeur en serait le successeur de Rib-Addi de Byblos, connu déjà dans la documentation d'Amarna.
I - S. IZRE'EL, "Some Thoughts on the Amarna version of Adapa", RAI 36, p. 211-220: à propos de la version amarnienne de l'histoire d'Adapa, composée vers le XIVe s. Les points rouges portés sur la tablette sont des repères pour l'analyse métrique des vers de ce poème. - IDEM, “New Readings in the Amarna Versions of Adapa and Nergal and Ereškigal", in: Gs Kutscher, p. 51-67: nouvelles lectures et interprétations des textes littéraires amarniens d'Adapa et de Nergal et Ereškigal. - IDEM, The Amarna Scholarly Tablets, Cuneiform Monographs 9, 1997, xii + 109 p. + 51 pl.: étude des textes scolaires, retrouvés dans un bâtiment constituant sans doute une école de scribes. Le corpus contient des syllabaires, des listes de signes, de vocabulaire, de noms divins et des textes littéraires. Les tablettes sont données en photo, trs et trd commentée.
K - Th. R. KÄMMERER, šimâ milka. Induktion und Reception der mittelbabylonischen Dichtung von Ugarit, Emâr und Tell el-‘Amarna, AOAT 251, 1998.
L - S. LACKENBACHER, “Ugaritica V n° 36", NABU 1994/58: joint de plusieurs moulages de fragments qui complètent l'unique lettre adressée à Ramsès II connue jusqu'ici. Le document concerne une affaire commerciale. - EADEM, “girgû dans un texte d'Ugarit", NABU 1996/11: le terme désigne un objet en corde et non en roseau. - EADEM, “À nouveau RS 88.2158", NABU 1999/53: trs et commentaire d'un passage de la lettre inédite RS. 88.2158, concernant les relations entre Ugarit et l'Egypte. – EADEM, “RS 17.59", NABU 1999/66: relecture de cette lettre du roi hittite dispensant le roi d'Ugarit d'apporter son aide militaire dans la guerre contre l'Assyrie, en échange d'une grosse quantité d'or. - EADEM, "Les archives palatiales d'Ugarit", Ktema 26, 2001, p. 79-86: les fouilles du palais d'Ugarit ont mis au jour cinq lots d'archives bilingues (akkadien et ougaritique) écrites respectivement en cunéiforme syllabique et alphabétique. La composition des lots n'obéit pas à un critère thématique ou linguistique, et semble postérieure à la mainmise hittite. Un tableau récapitule les types de texte selon le locus auquel ils appartiennent. – EADEM, Textes akkadiens d'Ugarit, LAPO 20, 2002: trd et commentaire des tablettes akkadiennes exhumées par C. Schaeffer entre 1936 et 1970. La première partie traite des textes internationaux et des lettres. La seconde partie regroupe les textes juridiques les plus significatifs, classés de manière thématique: libéralités royales portant sur des biens fonciers, achat de terres, gage, adoption et successions. Les politiques d'acquisition foncière de membres de la famille royale, notamment les reines, et de personnages importants, sont également discutées. L'ouvrage est complété par des index complets et quelques illustrations (plan du palais, 2 cartes). - O. LORETZ, “Ugaritische Lexikographie", SEL 12, 1995, p. 105-120: illustration de la complexité de l'ugaritique à travers l'exemple des techniques scribales, de l'étymologie, des synonymes et des interférences du hurrite.
M - I. MARQUEZ ROWE, “Evidence of the Trade Between Ugarit and Byblos. Once More on KTU 4.338: 10-18", AuOr 11, 1993, p. 101-106: la relecture du texte KTU 4.338: 10-18 conduit à une interprétation nouvelle du document, qui contient une vente de bateaux par le roi de Byblos à celui d'Ugarit. - IDEM, “Mind the edge!", NABU 1995/63: la tablette RS 18.252 comporte à la fin de la l. 1 deux signes, lus GÁN.ME, et compris en référence au nombre de champs distribués à des groupes professionnels. Il faut en réalité lire LÚ.MEŠ, désignant les hommes recrutés au titre du service-ilku. - IDEM, “An Akkadian Letter fo the Amarna Period at Ugarit", AuOr 14, 1996, p. 107-126: nouvelle interprétation de la lettre “du Général" (RS 20.33) éditée par S. Izre'el et I. Singer. - I. MARQUEZ ROWE et W. H. VAN SOLDT, “The Hurrian Word for ‘Brideprice' in an Akkadian Text from Alalah IV", AuOr 16, 1998, p. 132-133: le mot waduranni “don nuptial" est un terme emprunté au hourrite, d'origine indo-européenne, intégré dans le vocabulaire d'un texte akkadien d'Alalakh d'époque médio-babylonienne (AT 94).
N - N. NA'AMAN, “Amarna sakânu (“to govern") and the west semitic sôkên (“governor")", NABU 1995/42: l'a. corrige le sens du verbe sakânu, “gouverner", à la lumière du sens de malâku “se comporter en gouvernant". Dès lors, les substantifs sâkinu/sôkên/skn désignent des officiers administratifs. - IDEM, “Amarna Notes", NABU 1997/21: remarques philologiques portant sur 6 lettres d'Amarna (EA 77; 109; 126; 154; 155; 190).
O - J. C. OLIVA, "A Forgotten Text from Alalakh VII", JCS 52, 2000, 61-65: collation de la tablette Al.T *98d autorisant une traduction des 18 premières lignes de la tablette. Il s'agit d'un contrat d'achat d'une vigne et de rations alimentaires pour des animaux. La séquence ma-az-za-az (l. 7) est comprise non pas en référence au terme mazzazânu "gage, sûreté", mais dans un sens idiomatique avec larû, le tout désignant contextuellement le chemin d'accès à la vigne, inclus dans le prix d'achat.
P - D. PARDEE, "Épigraphie et structure dans les textes administratifs en langue ougaritique: les exemples de RS 6.216 et RS 19.017", Or 70/3, 2001, p. 235-282: relecture de 2 textes administratifs très abîmés, l'un distribuant des cruches de vin et du pain et l'autre énumérant les contributions versées par des villes et des corporations. L'étude veut insister sur l'importance primordiale de la structure d'un texte pour en comprendre la signification, cette démarche étant particulièrement nécessaire compte tenu du mauvais état des sources. - W. T. PITARD, "A New Edition of the ‘Râpi'ûma' Texts: KTU 1.20-22", BASOR 285, 1992, p. 33-77: article de méthodologie épigraphique illustrée: la bonne compréhension d'un texte suppose son éd. complète (photos, fac-similés, transcription, traduction et commentaires); cette méthode, appliquée à KTU 1. 20-22, conduit à remettre en question les conclusions habituellement tirées de ce document quant à la société, la politique et la religion d'Ugarit.
R - J. RENGER, “Zur Wurzel MLK in akkadischen Texten aus Syrien und Palästina", ARES 1, pp. 165-172: dans les lettres d'Amarna, malâku dérive de la racine ouest-sémitique mlk désignant le commandement et le pouvoir et se traduit donc par “gouverner", tandis qu'il signifie “conseiller" en akkadien et en araméen.
S - J. SANMARTIN, “Das Handwerk in Ugarit: eine lexikalische Studie", SEL 12, 1995, p. 169-190: étude du vocabulaire technique du travail manuel, à travers d'une part l'analyse du sens des termes, et d'autre part leur clasification thématique. - IDEM, “Götter, die in Zelten wohnten?", Fs Hirsch, WZKM 86, 1996, p. 391-397: à propos de la racine 'aHL- qui désigne la “ville" plutôt que la “tente" ou la “famille (élargie)".
T - J. TROPPER, “Bedeutende Neuerscheinungen der Ugaristik", OLZ 92/4-5, 1997, p. 455-467: compte rendu de G. del Olmo Lete et J. Sanmartín, Diccionario de la lengua ugarítica, vol. I, 1996; de M. Dietrich et O. Loretz, Analytic Ugaritic Bibliography 1972-1988, AOAT 20/6, 1996; de P. ZemSnek, Ugaritischer Wortformenindex, 1995; de M. Dietrich et O. Loretz, Word List of the Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, ALASPM 12, 1996 et de J. L. Cunchillos et J. P. Vita, Banco de datos filológicos semíticos noroccidentales, 1995. - J. TROPPER et J. -P. VITA, “Untersuchungen zu ugaritischen Wirschaftstexten", UF 30, 1998, p. 679-696: relecture après collation d'une douzaine de textes économiques d'Ugarit.
V - W. H. VAN SOLDT, “Babylonian Lexical, Religious and Literary Texts and Scribal Education at Ugarit and its Implications for the Alphabetic Literary Texts", in: Ugarit I, p. 171-212: l'a. présente les textes lexicaux et les textes littéraires et religieux, avant d'analyser leurs points communs et leurs caractéristiques linguistiques, ainsi que les méthodes d'enseignement de l'akkadien. - IDEM, “The Akkadian of Ugarit: lexicographical Aspects", SEL 12, 1995, p. 205-215: les particularités lexocographiques de l'akkadien d'Ugarit rendent indispensable la fabrication d'un dictionnaire spécifique de l'akkadien de l'ouest. - IDEM, «Amarna upsu = Ugaritic ‘ps, “boundary (stone)"», NABU 1997/90: la proposition de l'a. de voir dans l'ougaritique ‘ps la “(borne) (frontière)" se trouverait confirmé par un passage de la lettre d'Amarna EA 366. - IDEM, "Nahiš-šalmu: an Assyrian scribe working in the “Southern Palace" at Ugarit", in: Fs Veenhof, p. 429-444: dans le "palais sud" d'Ugarit ont été trouvés une centaine de textes dont la grande majorité est rédigée en akkadien. Parmi eux, une lettre, adressée au scribe Naheši-šalmu, qui travaille pour le šatammu rabû, fait penser qu'il pourrait être l'auteur de ces tablettes. En effet, le nom de ce scribe indique une origine mésopotamienne plutôt que locale. Or, la paléographie, le choix des signes et la grammaire de plusieurs textes montrent une forte influence assyrienne. - J. -P. VITA, "Das Gezer-Corpus von El-Amarna: Umfang und Schreiber", ZA 90/1, 2000, p. 70-77: le corpus des lettres de la ville de Gezer comporte 25 lettres dont une vingtaine furent rédigées par le scribe de Milkilus, le reste pouvant être attribué à deux autres scribes. Gezer a ainsi fourni le second corpus épistolaire, en quantité, des textes d'El-Amarna (après Byblos). L'a. souligne que le "dialecte de Gezer" ne recoupe pas nécessairement la totalité des textes de Gezer, puisqu'on le trouve aussi dans des lettres de Šuwadarta.
W - W. G. E. WATSON, “Ugaritic Lexical Studies in Perspective", SEL 12, 1995, p. 217-228: article de méthodologie illustrée sur la fabrication d'un outil lexical de l'ougaritique. - IDEM, “Ugaritic Names With the Element kb", NABU 1997/69: l'a. cite 3 NP d'Ugarit (kbn, kpyn et ‘bdkb), où l'on retrouverait peut être l'akkadien kâpum, «roc» (cf. W. Heimpel, NABU 1997/2). - D. J. WISEMAN et R. S. HESS, “Alalakh Text 457", UF 26, 1994, p. 501-508: liste de personnes résidant à différents endroits (région d'Alalah et Alep pour autant qu'on puisse les situer). - F. C. WOUDHUIZEN, “Tablet RS 20.25 from Ugarit. Evidence of the Maritime Trade in the Final Years of the Bronze Age", UF 26, 1994, p. 509-538: commentaire des textes en écriture chypro-minoenne provenant d'Ugarit. L'a. propose de les dater du règne de Šuppiluliuma II.
Z - R. ZADOK, “girgû, girrigû", NABU 1997/16: à propos de la note de S. Lackenbacher, NABU 1996/11. - F. ZEEB, "Studien zu den altbabylonischen Texten aus Alalah. I. Schuldscheine", UF 23, 1991, p. 405-438: éd. complète de 14 textes du niveau VII d'Alalah contenant des reconnaissances de dettes assorties d'un gage personnel. Cet engagement de la force de travail du débiteur est sûrement la principale motivation des crédits consentis, car il permet de rentabiliser le prêt. La cession de la créance à un tiers s'accompagne du transfert de la force de travail du débiteur. Une telle pratique aggrave donc la situation du débiteur, qui entre dans un statut de dépendance économique et personnelle pour une durée parfois longue. - IDEM, “Das teqnîtu in den Immobilienkaufurkunden aus Alalah VII", in: Fs von Soden, p. 541-549: le terme teqnîtu, attesté uniquement dans les contrats de vente immobilière d'Alalakh VII et dans un procès de même époque, est construit sur la racine qnî, “garder pour soi", et signifie “(droit) de retrait". - IDEM, Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den spätlatbabylonischen Getreidelieferlisten aus Alalah (Schicht VII), AOAT 282, 2001, xiv + 757 p.: éd. et analyse de 94 tablettes de livraison de céréales pour reconstituer un aspect de l'économie palatiale d'Alalah d'époque paléo-babylonienne. L'introduction développe la méthode utilisée, centrée principalement autour de la notion de critique textuelle; vient ensuite une présentation du corpus des textes d'Alalah VII selon cette méthode d'analyse documentaire portant à la fois sur la forme et sur le genre des tablettes; le contexte historique est longuement développé, dans ses aspects chronologiques et politiques; les textes de livraison de grains sont présentés du point de vue général de leur forme, de leur contenu et de leur classement chronologique, puis sont rassemblés et combinés en divers paradigmes pour permettre une présentation des mécanismes de production et de répartition du travail dans le contexte palatial. - J. ZORN, "LÚ.PA-MA-HA-A in Ea 162:74 and the Role of the MHR in Egypt and Ugarit", JNES 50/2, 1991, p. 129-138: une lettre du Pharaon à Aziru, gouverneur d'Amurru, contient une liste de noms de personnes devant être extradées vers l'Egypte pour atteinte à l'ordre public. Un seul de ces individus est désigné par son titre uniquement, construit sur la racine MHR qui désigne, d'après les parallèles égyptien et ougaritique, le scribe-soldat.
A - D. ARNAUD, “L'incantation ougaritaine contre le ‘Feu': RS 17.155 2 § 8", AuOr 13, 1995, p. 137-139: nouvelle trs. de ce texte et commentaire philologique à la lumière du texte parallèle retrouvé dans la bibliothèque d'Urtennu.
B - M. J. BODA, “Ideal Sonship in Ugarit", UF 25, 1993, p. 9-24: l'étude contextuelle des passages de la Légende d'Aqhat décrivant le fils idéal montre le lien étroit unissant les pratiques cultuelles à la société et à la famille. - P. BORDREUIL, "Recherches ougaritiques", Semitica 40, 1991, p. 17-30: l'a. propose de localiser le combat entre Baal et Yam sur le massif du Galal al Aqra'. - P. BORDREUIL et D. PARDEE, “Textes ougaritiques oubliés et ‘transfuges'", Sémitica 41-42 [1991-1992], 1993, p. 23-58: éd. de 4 tablettes concernant la religion (offrande mortuaire, offrandes sacrificielles), et administratifs (inventaire des portes d'une maison, liste fragmentaire de corvées). - EIDEM, “Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques", MARI 7, 1993, p. 63-70: synthèse sur les quatre textes relatifs au mythe du combat entre l'orage et la mer, les armes employées et la portée politique du récit, notamment le lien entre la défaite de la mer et la prise du pouvoir royal.
D - G. DEL OLMO LETE, “The Sacrificial Vocabulary at Ugarit", SEL 12, 1995, p. 37-49: point sur les diverses manières de désigner le sacrifice cultuel. - J. C. DE MOOR et P. SANDERS, "An Ugaritic Expiation Ritual and its Old Testament Parallels", UF 23, 1991, p. 283-300: l'étude comparée du rituel KTU 1.40 et des parallèles de l'Ancien Testament démontre l'existence de la notion de péché à Ugarit. L'expiation de la Nation entière mentionnée dans ce texte a eu une influence sur la tradition religieuse d'Israël. - M. DIETRICH et O. LORETZ, “mt ‘Môt, Tod' und mt ‘Krieger, Held' im Ugaritischen", UF 22, 1990, p. 57-65: dans les textes mythiques, la racine mt signifie “mari, homme" mais aussi “guerrier, héros" en référence au roi, tout comme en Mésopotamie. - EIDEM, "Zur Debatte über ‘Funerary Rituals and Beatific Afterlife in Ugaritic Texts and in the Bible'", UF 23, 1991, p. 85-90: à propos de la discussion lancée autour de l'ouvrage de K. Spronk, Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East, 1986. Les aa. soutiennent la thèse de Spronk soulignant l'influence des pratiques funéraires paléoassyriennes et paléocananéennes sur le monde biblique via Ugarit, à l'époque pré-exilique, contre les critiques de K. van der Toorn. - EIDEM, "Graggeigaben für den verstorbene König. Bemerkungen zur Neuausgabe von RS 34.126 = KTU 1.161", UF 23, 1991, p. 103-106: contre l'avis des éd. du texte, les aa. maintiennent que le roi est enseveli avec les emblèmes de son pouvoir, et notamment son trône. - EIDEM, Mythen und Epen IV, TUAT III/6,1997: principaux mythes en langue ugaritique (cycle de Baal, épopée de Keret et d'Aqhat...). - M. DIETRICH, W. MAYER, “Sprache und Kultur der Hurriter in Ugarit", in: Ugarit I, p. 7-42: analyse grammaticale et linguistique d'un petit corpus de textes religieux hurrites de provenances et d'époques diverses. - M. DIJKSTRA, "The List of qdšm in KTU 4.412+ii 8ss", in: Fs Del Olmo Lete, p. 81-89: étude prosopographique et sociologique de la liste de qdšm reconstituée dans le texte KTU 4.412+. Comme la qadištu mésopotamienne et la qedêšâh biblique, la qdšm d'Ugarit n'a rien d'une prostituée cultuelle mais appartient au personnel du temple et exerce peut-être des fonctions liées aux sacrifices, à la divination et au chant. Cette prêtresse peut se marier, avoir des enfants, posséder des biens et en recevoir; elle apparaît comme témoin dans certains contrats et est assujettie à l'impôt.
G - W. R. GALLAGHER, “On the Identity of Hêlêl Ben Šahar of Is. 14:12-15*", UF 26, 1994, p. 131-146: l'a. propose des arguments en faveur d'une identification avec le dieu Enlil = Illil.
H - J. -M. HUSSER, “Culte des ancêtres ou rites funéraires? A propos du “Catalogue" des devoirs du fils (KTU 1.17:I-II)", UF 27, 1995, p. 115-127: analyse d'un passage de la Légende d'Aqhat, qui illustre la confusion occasionnelle entre le culte des ancêtres et les rites funéraires.
K - P. A. KRUGER, “Rank Symbolism in the Baal Epic. Some Further Indicators", UF 27, 1995, p. 169-175: l'a. analyse deux modes de communication non-verbale dans le cycle de Baal: le geste de saisir la frange de l'habit, qui manifeste toujours l'infériorité de l'exécutant et dénote ici une supplication; le deuil “royal" consistant à descendre du trône sur un tabouret puis du tabouret par terre, symbolisant la dégradation du statut du supérieur vers l'inférieur et la communion de tous les hommes ordinaires dans le deuil.
L - O. LORETZ, “Die Einzigkeit Jahwes (Dtn 6, 4) im Licht des ugaritischen Baal-Mythos. Das Argumentationsmodell des altsyrisch-kanaanäischen und biblischen ‘Monotheismus'", in: Fs von Soden, p. 215-304: examen de la question du monothéisme et de ses précurseurs orientaux à travers la comparaison de l'unicité de Yahwé et celle de Baal.
M - R. MC CLIVE GOOD, “The Sportsman Baal", UF 26, 1994, p. 147-164: description des capacités sportifs de Baal: course, lutte, chasse etc. et description générale des sports de combat au Proche-Orient ancien.
N - H. NIEHR, “Überlegungen zum El-Tempel in Ugarit", UF 26, 1994, p. 419-426: proposition d'identifier le sanctuaire sud-est d'Ugarit comme celui d'El et non de Dagan. En effet, Dagan et El sont confondus dans les textes hourrites avec Kumarbi.
P - D. PARDEE, “L'ougaritique et le hourrite dans les textes rituels de Ras Shamra-Ougarit", in: Bilinguisme, p. 63-80: synthèse sur les éléments hourrites dans la documentation religieuse d'Ugarit, qui souligne la formation bilingue des scribes et l'intérêt du souverain pour cette langue usitée dans le culte royal.
R - S. RIBICHINI et P. XELLA, "Problemi di onomastica ugaritica. Il caso dei teofori", SEL 8, 1991, p. 149-170: la confrontation des noms théophores avec les noms des divinités directement attestées permet une meilleur compréhension du panthéon local et des mécanismes d'attribution d'un nom (dévotion personnelle, tradition familiale, affirmation d'une identité ethnique ou culturelle).
S - J. SANMARTIN, "Sociedades y lenguas en el medio sirio-levantino del II milenio a.C.: Ugarit y lo hurrita", in: Fs Del Olmo Lete, p. 113-123: le hourrite est une langue attestée à Ugarit dans le seul cadre religieux, et ne correspond pas forcément à une langue vivante en usage dans une communauté culturelle et linguistique installée en Ugarit. Il s'agit là d'une survivance liée à la provenance hourrite d'une grande partie du clergé ougaritain, s'expliquant par l'importation massive de rites magiques et ésotériques. Il y eut donc un déclin du hourrite en Ugarit entre la conquête hittite (1340) et la ruine définitive du royaume (1175), parallèle à la situation constatée dans le monde hittite contemporain. - B. B. SCHMIDT, “A Re-Evaluation of the Ugaritic King List (KTU I. 113)", in: Fs Gibson, p. 289-304: analyse de la liste royale d'Ugarit, en comparaison avec celle d'Ebla. L'a. considère que les noms des rois morts étaient énumérés en même temps que leur dieu dynastique personnel (il), dans le cadre d'un rituel funèbre commémoratif destiné à asseoir la légitimité de la dynastie régnante. Le roi d'Ugarit n'est pas divinisé après sa mort.
T - J. TROPPER, "Els Schöpfungsakt nach KTU 1.16.V:28-32", AOF 16/1, 1999, p. 26-32: ce passage de l'épopée de Keret est le seul témoin à Ugarit d'un acte de création du dieu El. L'a. propose deux nouvelles lectures et interprétations de cet extrait. - J. TROPPER et J. -P. VITA, "Der Wettergott von Halab in Ugarit (KTU 4.728)", AOF 26, 1999, p. 310-313: nouvelle interprétation de KTU 4. 728, d'après laquelle Halab, le dieu de l'orage, faisait l'objet d'un culte à Ugarit, et disposait d'un clergé propre.
V - K. VAN DER TOORN, "Funerary Rituals and Beatific Afterlife in Ugaritic Texts and in the Bible", BiOr 48, 1991, p. 40-66: recension de K. Spronk, Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (AOAT 219) et discussion de 7 tablettes pour contester l'existence à Ugarit d'un concept de sauvegarde éternelle (résurrection, béatification de la vie après la mort). - IDEM, “Ilib and the ‘God of the Father'", UF 25, 1993, p. 378-387: le terme Ilib d'Ugarit correspond à l'akkadien dingir a-bi, “dieu de mon père", mais ne renvoie pas aux divinités familiales. Il désigne plutôt le père déifié, devenu un ancêtre. En Syrie, l'expression peut parfois qualifier aussi “l'esprit du père" et non pas le culte familial.
W - W. G. E. WATSON, "Comments on KTU 1.114:29'-31'", AuOr 8/2, 1990, p. 265-267: l'a. propose une nouvelle traduction d'un passage d'un texte paramythologique d'Ugarit. - IDEM, “Ugaritic ‘Judge River' and the River Ordeal", NABU 1993/95: l'association du feu et de la rivière divinisée, relevée par P.-A. Beaulieu pour l'ordalie néo-babylonienne CT 46, 45, trouve des parallèles dans la documentation d'Ugarit, où l'image est attestée en lien avec les messagers du dieu-Fleuve. Ces textes montrent aussi que le titre tpt signifie “juge" plutôt que “maître, souverain". - N. WYATT, “Le centre du monde dans les littératures d'Ougarit et d'Israël", JNSL 21/2, 1995, p. 123-142: toutes les allusions à diverses montagnes dans la mythologie ugaritaine se rapportent à un seul lieu, le Jebel el Aqra, qui consitute un motif unificateur dans la théologie. La Bible a adopté ce même motif et la symbolique qu'il revêt. - IDEM, Religious Texts from Ugarit: The Words of Ilimiku and His Colleagues, The Biblical Seminar 53, 1998. - IDEM, "Just How “Divine" Were the Kings of Ugarit?", in: Fs Del Olmo Lete, p. 133-141: la dimension divine du roi et de la reine mère à Ugarit est l'expression littéraire d'une vision de la royauté corroborée par les textes rituels, où le souverain est à la frontière entre les mondes humain et divin. Son rôle d'intercesseur le montre à la fois en tant qu'homme, pour représenter ses sujets vis-à-vis des dieux, et en tant que divinité pour répandre sur terre les bienfaits que les dieux lui ont transmis.
Y - M. YON, “Ougarit et ses dieux (travaux 1987-1988)", in: Fs Bounni, p. 325-343: étude des principales divinités d'Ugarit (Baal et El) et du rôle du roi, protecteur des guerriers et intermédiaire entre les humains et les dieux.
|