





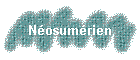
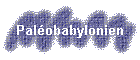
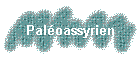
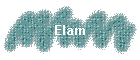


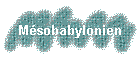




Cette
section comprend la bibliographie sur Isin, Larsa, Esnunna, Mari à l'époque
paléobabylonienne, Babylone à l'époque de la première dynastie.
A - P. ABRAHAMI, "ARM II 122, ARMT XXVI/2 440 et ARMT XXVI/2 440 bis", NABU 1992/1: les lettres acéphales de Mari ARMT 26 440 et 440 bis ont été écrites par Askur-Addu, roi de Karanâ à Zimri-Lim, l'expéditeur servant d'intermédiaire entre Meptûm et le roi de Mari. Ces courriers concernent une initiative politico-militaire des Babyloniens, qui avaient engagé un corps expéditionnaire de 20.000 hommes pour installer Hulâlum sur le trône d'Allahad. - IDEM, "La circulation militaire dans les textes de Mari: la question des effectifs", RAI 38, p. 157-166: estimation des effectifs de l'armée mariote, variant de 10.000 à 40.000 hommes selon les opérations militaires. - IDEM, “A propos des généraux (ga mar-tu) de la Mésopotamie du Nord à l'époque de Zimri-Lim", NABU 1998/31: sur les activités militaires des généraux et leur répartition dans les villes du Sinjar, du Subartum et du Zalmaqqum. - F. AL-RAWI, “A New Old Babylonian Date List from Sippir with Year Names of Apil-Sîn and Sîn-muballit", ZA 83/1, 1993, p. 22-30: éd. complète d'une tablette rassemblant les noms d'années de Sabi’um (15), d'Apil-Sîn (18) et de Sîn-muballit (20). Cette liste diffère, par son vocabulaire et les séquences chronologiques, de celle d'A. Ungnad (cf. “Datenlisten, RlA II). - M. ANBAR, Les tribus amorrites de Mari, OBO 108, 1991, 248 p.: synthèse des recherches actuelles sur les tribus amorrites. L'a. présente une chronologie de l'histoire de Mari à l'époque de ces dynasties, et étudie plus particulièrement l'organisation des tribus, leur répartition géographique, leurs activités économiques et leurs rapports avec les autorités. La pénétration de ces tribus dans les régions du Moyen Euphrate remonte au XXe s. Elles se sont tantôt assimilées aux populations sédentaires, tantôt maintenues dans un état de semi-nomadisme. - IDEM, “L'origine tribale de Zimri-Lim, roi de Mari", in: Fs Limet, p. 7-10: l'a. reprend l'ensemble des attestations sur l'appartenance tribale du roi de Mari, pour montrer que son rattachement aux Bensimalites n'est pas assuré. - IDEM, “La date de la prise de Larsa par Hammurabi, encore une fois", NABU 1995/65: l'a. abandonne la date qu'il proposait pour la prise de Larsa, au mois VI de ZL 11', et doute de la validité de l'hypothèse de D. Charpin, qui suggère le mois XII de ZL 10'. - IDEM, “La critique biblique à la lumière des Archives royales de Mari II: IS 18,21b", Biblica 78, 1997, p. 247-251: le double mariage de David avec Mérav et Mikal trouve un écho dans une lettre de Mari (ARM XXVI/2 303) dans laquelle Yamsûm rappelle à Hâya-sûmû, roi d'Ilân-surâ, que le roi Zimri-Lim lui a donné, par une faveur extraordinaire, ses deux filles pour épouses, afin de marquer l'estime du suzerain à son vassal. - IDEM, “Les tromperies d'Elam et d'Ešnunna", NABU 1997/15: l'a. relève les marques de défiance des Mariotes envers les Elamites et les Ešnunnéens, du fait de la situation politique, sous le règne de Zimrî-Lîm. – IDEM, “Deux cérémonies d'alliance dans Ex 24 à la lumière des Archives royales de Mari", UF 30, 1998, p. 1-4: rapprochement entre l'alliance par le sang évoquée dans Ex. 24 et ARM XXVI/2 33, et étude des rites de conclusion d'une alliance par le partage d'un repas dans la documentation de Mari. – IDEM, “L'expédition d'Ešnunna et les relations entre Mari et Andarig durant les années ZL 3' et ZL 4': probkèmes chronologiques", Israel Oriental Studies 18, 1998, p. 297-309: l'a. reconstitue les événements liés à l'expédition d'Ešnunna. Elle se compose d'une campagne en Haute Mésopotamie commencée en ZL 3' jusqu'en ZL 4', d'une campagne dans le Suhum en ZL 3', et de négociations de paix aboutissant à une alliance en ZL 4'. - B. ANDRÉ-SALVINI et M. SALVINI, “Ein König von Dêr", AOF 24/1, 1997, p. 39-43: éd. complète d'une stèle appartenant à une collection privée, et qui fournit les noms de deux rois jusqu'ici inconnus pour Dêr: Iddinûnim et son père Nûr-matîšu. L'emploi du titre de “roi", lugal, et non pas de gìr.níta = šakkanakku “vice-roi", pourrait traduire l'indépendance politique de ce petit royaume.
C - D. CHARPIN, “Un traité entre Zimri-Lim de Mari et Ibâl-pî-El II d'Ešnunna", in: Fs Garelli, p. 139-166: éd. complète d'un traité de paix entre les rois de Mari et d'Ešnunna, faisant suite à une offre d'alliance d'Ibâl-pî-El II, attestée par une lettre exceptionnellement longue publiée également par l'a. L'échec de cette proposition, destinée à consolider les liens avec Mari contre Ekallâtum, conduisit à la guerre en ZL 3', puis à la signature de la paix en ZL 4'. - IDEM, “Notices prosopographiques 4: le ‘prévôt des marchands' de Nêrebtum", NABU 1991/33: l'influence d'Ešnunna sur le royaume voisin d'Ekallâtum se manifeste dans l'emprunt du titre et des fonctions de “prévôt des marchands" (ugula dam-gàr) attesté à Ekallâtum. - IDEM, “Mari entre l'est et l'ouest: politique, culture, religion", Akkadica 78, 1992, p. 1-10: panorama de l'histoire de Mari au IIe millénaire. Les tablettes de Mari mettent en relief l'importance d'Alep, de Qatna et surtout d'Ešnunna, qui joua un rôle déterminant à la fois dans les relations internationales, l'évolution de l'écriture et la religion. L'image du rayonnement d'une Babylone puissante, occupant le centre culturel et politique du Proche-Orient, doit donc être révisée pour l'époque amorrite. - IDEM, “Rendez à César ce qui est à César!", NABU 1993/59: la collation de la lettre A. 9623 étudiée par D. Charpin en 1990, permet d'attribuer ce document à Yumras-El, roi de Qâ et Isqâ, et dont la correspondance sera éditée prochainement par J.-R. Kupper. - IDEM, “Un souverain éphémère en Ida-Maras: Išme-Addu d'Ašnakkum", MARI 7, 1993, p. 165-191: éd. complète de 13 tablettes de Mari éclairant l'histoire jusqu'ici mal connue d'Išme-Addu. Ce roi, peut-être un usurpateur, vassal du sukkal d'Elam et d'Atamrum d'Ešnunna, conclut une alliance avec les Bédouins et fut finalement décapité à la suite d'une conjuration orchestrée par la famille royale. - IDEM, “Usages épistolaires des chancelleries d'Ešnunna, d'Ekallâtum et de Mari", NABU 1993/110: l'adresse des lettres envoyées par les rois à leurs subordonnés comporte la mention du titre royal seul, sans le nom du souverain. Cet usage, probablement emprunté à la pratique scribale d'Ešnunna, diffère de celui de Babylone ou de Larsa. - IDEM, “Le début de l'année dans le calendrier sémitique du IIIe millénaire", NABU 1993/56: contre la proposition de M. Cohen, The Cultic Calendars of the Ancient Near East, 1993, qui place le début de l'année au mois Za-’a-tum. Les textes administratifs de Mari militent plutôt en faveur du mois I-si. - IDEM, "Les légendes de sceaux de Mari: nouvelles données", in: Mari in Retrospect, p. 59-76: étude des sceaux de plusieurs personnages importants: celui du devin Asqudum révèle qu'il a épousé une fille de Yahdun-Lim, ce qui explique les activités militaires d'Asqudum; celui de Samsi-Addu comporte une titulature modeste et une mention du nom de son père; ceux de Zimri-Lim font l'objet d'une synthèse augmentée d'un nouveau cylindre d'après lequel ce roi se dirait fils du mari de sa soeur, Addu-dûri. - IDEM, “Une décollation mystérieuse", NABU 1994/59: la lettre ARM VI 37 évoque la décapitation de Qarnî-Lîm, roi d'Andarig, dont la tête est à Qattunân et le corps introuvable. Le roi a sans doute été assassiné alors qu'il fuyait son royaume, agité par une révolte de palais. - IDEM, “A propos des rois de Hana", NABU 1995/23: l'a. soutient l'hypothèse d'A. Podany (JCS 43-45), pour qui le “royaume de Hana" est distinct de Terqa et qui place six “rois de Hana" au début de l'époque médio-babylonienne et non à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Le titre de “roi de Hana" repris par les souverains médio-babyloniens indique une domination sur les bédouins du Moyen-Euhrate et du Habur. L'a. reconstitue la généalogie des rois de Terqa, de Samsu-iluna de Babylone à Paratarna du Mitanni, en combinant les informations d'A. Podany et d'O. Rouault (SMEA 30). - IDEM, “Iluni, roi d'Ešnunna", NABU 1998/29: remise en ordre des noms d'année de ce roi d'après la documentation de Mê-Turan. - IDEM, "Chroniques du Moyen-Euphrate 1. Le “royaume de Hana": textes et histoire", RA 96, 2002, p. 61-92: review-article de A. Podany, The Land of Hana, 2002, examinant les conclusions de l'ouvrage recensé à la lumière de la documentation de Mari. Cette riche mise en perspective reprend des points d'histoire événementielle mais aborde aussi plusieurs aspects juridiques importants du formulaire des contrats (clauses pénales, en particulier la clause de l'asphalte ou la renonciation à l'application d'une andurârum, ou encore la question de la rétribution des témoins). - IDEM, Hammu-rabi de Babylone, Paris, 2003: synthèse de l'histoire événementielle, politique, juridique et économique de la Babylonie du XVIIIe s., à travers la figure de Hammurabi. Le propos est illustré par des traductions de textes, notamment tirés de la documentation épistolaire de Mari ou encore de Hammurabi avec ses officiers administratifs. - IDEM, "Ibni-Sadûm, roi de Kisurra, fils de Manna-balti et gendre de Sûmû-El de Larsa", NABU 2002/39: Ibni-Sadûm est roi de Kisurra et successeur de Manna-balti-El, comme l'indique le sceau de Sât-Sîn, épouse d'Ibni-Sadûm, mentionnant les noms de son père, de son beau-père et de son mari. La présence du nom du beau-père laisse supposer que le mariage eut lieu alors qu'Ibni-Sadûm n'était encore que prince héritier. – IDEM, "La carrière de Sîn-iddinam et la mainmise babylonienne sur Larsa", NABU 2003/1: Sîn-iddinam commença sa carrière comme “secrétaire" (tupšar sakkakkim) de Hammurabi, puis devint gouverneur de Larsa après son annexion à la Babylonie. – IDEM, "L'onomastique des nourrices royales et des esclaves domestiques", NABU 2003/2: le NP féminin Abî-lîbûr, cité dans le contrat YOS XII 322, a été attribué à la servante après la naissance de son fils, et correspond à l'onomastique propitiatoire attestée pour les nourrices royales de Mari. – IDEM, "La date de la construction de la muraille de Babylone", NABU 2003/4: Sûmû-abum n'est pas le fondateur de la première dynastie de Babylone. Le nom d'année de l'an 1 de Sûmû-abum est un doublon artificiel de l'an 5 de Sûmû-la-El, lequel a construit la muraille de Babylone en 1877. - D. CHARPIN et J. M. DURAND, “Ašsur avant l'Assyrie", MARI 8, 1997, p. 367-391: le statut d'Aššur au début du IIe millénaire est fort différent de celui que l'on connaît par la suite. En effet, il faut considérer Samsî-Addu, non pas comme un roi d'Aššur, mais comme un roi d'Ekallâtum, ville qui représente le centre de son pouvoir ('âlum', la 'Ville' dans la documentation de Mari), et le siège de son empire. Ašsur était indépendante d'Ekallâtum et se distinguait par certains particularismes (linguistiques et culturels) et par l'activité internationale de ses marchands. - D. CHARPIN et N. ZIEGLER, Mari et le Proche-Orient à l'époque amorrite, Essai d'histoire politique, FM V, 2003, x + 302 p.: indispensable synthèse d'histoire politique à partir de l'ample documentation de Mari, dont les informations, replacées dans leur ordre chronologique, permettent de brosser un tableau cohérent et éclairant des événements complexes couvrant les 25 dernières années du royaume de Mari. - M. CHAVALAS, “Terqa and the Kingdom of Khana", BA 59/2, 1996, p. 90-103: synthèse archéologique sur l'histoire de Terqa aux IIIe et IIe millénaires. Servant de lien entre les sites de la côte méditerranéenne et la Mésopotamie, Terqa devient une puissance stratégique importante comme en témoigne son dispositif défensif impressionnant. Elle est dotée d'un complexe administratif étendu à l'époque paléo-babylonienne et d'un temple dédié à Ninkarrak. L'article contient une chronologie des rois de Khana établie d'après les derniers travaux sur la question (notamment A. Podany dans JCS 1991=-1993).
D - K. DE GRAEF, "Les étrangers dans les textes paléobabyloniens tardifs de Sippar (Abi-ešuh-Samsuditana)", 1re partie, Akkadica 111, 1999, p. 1-48, 2e partie, Akkadica 112, 1999, p. 1-17: l'a. a réuni les différentes attestations des étrangers (dont l'origine est connue ou non) dans les textes de Sippar datant des règnes d'Abi-ešuh à Ammiditana (1711-1595 ou 1611-1495 av. J.-C. selon la nouvelle chronologie), à partir de la documentation publiée et d'attestations inédites issues des archives d'Ur-Utu. - Z. DIANHUA, “On the role of Lu-Ninurta in Hammurapi's administrative structure", JAC 11, 1997, p. 11-122: Lu-Ninurta est un haut fonctionnaire sous Hammurabi. Il entame probablement sa carrière dans l'administration au moment de la conquête du sud. L'examen de la correspondance de Šamaš-Hazir montre qu'il intervient fréquemment dans le règlement des litiges concernant les champs. Il fait office de conseiller du roi. - J. -M. DURAND, "Espionnage et guerre froide: la fin, de Mari", in: Fs Fleury, p. 39-52: l'intervention directe de l'Elam dans les affaires mésopotamiennes, après une période de suzeraineté incontestée, a suscité la résistance des royaumes amorrites menés par Babylone, qui tira finalement les bénéfices de la victoire. Restées seules face à face, Mari et Babylone ne pouvaient que s'affronter, rompant ainsi une entente apparemment solide et durable. Prétextant une trahison mariote, Hammurabi lança victorieusement ses armées contre Zimri-Lim et détruisit Mari. - IDEM, "Nouvelles de Tuttul", NABU 1991/114: remarques philologiques et historiques sur les tablettes de Tuttul, l'actuel Tell Bi'a, récemment publiées (MDOG 122). Les textes attestent la présence de sakkanaku, comme à Mari et à Terqa, et mentionnent la venue de Samsî-Addu. - IDEM, "La conscience du temps et sa commémoration en Mésopotamie: l'exemple de la documentation mariote", Akkadica 124, 2003, p. 1-11: le site de Mari n'a livré que peu de textes historiques: deux récits de construction datés du règne de Yahdun-Lim, qui témoignent d'une influence des traditions akkadiennes en Syrie, en lien avec la réforme de l'écriture venue d'Esnunna; l'Epopée de Zimri-Lim, qui constitue plutôt une composition poétique quoiqu'elle contienne des informations historiques; la Liste des sakkanakku, œuvre idéologique servant à rattacher la lignée bensimalite aux gouvernants de l'époque de Sargon d'Akkad, sans doute parce que le titre lui-même était appliqué aux souverains de la région; les Chroniques éponymales, textes écrits en Haute Mésopotamie et rapportés à Mari comme butin, et relatant la geste de la famille de Samsî-Addu, sans doute dans la perspective de l'accomplissement des rites funéraires (kispum). D'une manière plus générale, le rappel de faits passés sert à justifier le conservatisme et à rejeter l'innovation, et se situe dans une mémoire généalogique ne dépassant pas 3 générations. Les textes d'alliance politique conservent aussi la trace d'événements historiques cités comme autant de mises en garde contre la reproduction de précédents néfastes. Ces documents ne sont pas des précurseurs de la diplomatie internationale de l'époque d'El Amarna mais des pactes familiaux entre groupes tribaux allogènes, les protagonistes devenant "frères" par l'établissement de pactes de sang. Il existe enfin des procédés de falsification de l'histoire, destinés à rattacher artificiellement un roi à une lignée légitime (e.g. Zimrî-Lîm ou Samsî-Addu) ou un groupe benjaminite à un clan bensimalite, par un procédé de parenté fictive.
E - J. EIDEM, “From the Zagros to Aleppo - and Back. Chronological Notes on the Empire of Šamši-Adad", Akkadica 81, 1993, p. 23-28: l'a. trouve une confirmation de sa reconstitution de l'histoire des Turukkéens (exposée dans The Shemshâra Archives 2, p. 16-21) dans une nouvelle analyse de la chronologie des dernières années du règne de Šamši-Adad, s'écartant du schéma proposé par D. Charpin et J.-M. Durand dans MARI 4. - IDEM, “Sûmu-Epuh. A stretcher-case?", NABU 1994/10: l'a. maintient qu'il faut abaisser la date de la mort de Sûmu-Epuh, roi du Yamhad, contre les arguments de P. Villard (NABU 1993/119). - J. EIDEM et F. HOJLUND, “Assyria and Dilmun revisited", RAI 40, p. 25-31: les contacts entre Dilmun et la Syrie du nord n'étaient pas de nature commerciale mais diplomatique et idéologique. Les archives de Mari attestent en effet l'existence d'un roi de Dilmun, interlocuteur du souverain de Mari. Il faut donc admettre l'existence d'un royaume de Dilmun dès 2050 et jusqu'à 1600, caractérisé par son appartenance à la “culture de Barbar".
G - M. GUICHARD, “La conquête de Haššum par le roi de Zarwar", NABU 1993/54: à propos d'Anu-harwi, roi de Zarwar puis de Haššum, qui devint sa capitale en raison de sa puissance politique supérieure. - M. GUICHARD et D. SEVALIE, "Akîn-amar, Kabiya et la 'guerre de Bunû-Estar' ", NABU 2003/6: Akîn-amar n'était pas roi de Kahat mais fut le protégé de son souverain, Kabiya.
H - W. HEIMPEL, "Inbatum goes home", NABU 2000/31: ARM XXVI 502 est une lettre de Buqaqum à sa maîtresse, sans doute Inbatum, la femme d'Atamrum et fille de Zimri-Lim, plutôt que Šibtum, l'épouse de Zimri-Lim. La lettre serait écrite juste après la mort d'Atamrum et concernerait le retour d'Inbatum à Mari. – IDEM, "Aškur-Addu almost becomes king of Nahur", NABU 2000/3: la fin du contrôle de Haya-Sumu sur Nahur fut l'occasion pour Aškur-Addu de réclamer la place à Zimri-Lim, comme le montre ARM XXVI 359. – IDEM, "The Date of ARM 2 23", NABU 2000/35: l'a. propose de dater cette lettre de ZL 9' et non de ZL 2' (D. Charpin).
J - F. JOANNES et N. ZIEGLER, “Une attestation de Kumme à l'époque de Samsî-Addu et un Turukkéen de renom à Shemshâra", NABU 1995/19: relecture de la lettre SH.894, où le toponyme Šakummi (l. 44) est corrigé en Kumme. En outre, Hazib-Teššub fut sans doute roi de Haburâtum, à l'époque de Yahdun-Lîm. S'étant réfugié à Shemshâra après l'invasion Guti, il fut assassiné sur l'ordre de Samsî-Addu.
K - H. KLENGEL, König Hammurapi und der Alltag Babylons, Düsseldorf, 1999: ouvrage s'adressant à un public élargi, et présentant quelques aspects historiques et culturels du XVIIIe s. av. J.-C.: la vie politique, la société, les fondements du pouvoirs et le Code de Hammurabi. - M. KREBERNIK, "Neues zu den Eponymen unter Jasmah-Addu", AOF 28/1, 2001, p. 1-7: reconstitution de la séquence des éponymes contemporains de Yasmah-Addu d'après les nouvelles informations de Tell Bi‘a (ancienne Tuttul), et mise en ordre chronologique de ces textes. - J. -R. KUPPER, “Zaziya ‘prince' d'Ita-Palhum", NABU 1990/131: le Zaziya du sceau publié par D. Charpin et D. Beyer dans MARI 6 ne serait pas le roi des Turukkéens. - IDEM, “Lettres ‘barbares' de Shemshâra", NABU 1992/105: l'étude linguistique de 11 lettres de Shemshâra récemment publiées (JCS 42, 1990, p. 127ss) confirme l'existence d'une tradition nord-syrienne déjà relevée pour la documentation d'Ilan-surâ (cf. D. Charpin, Mélanges Finet, p. 31ss). - IDEM, "Un épisode de l'histoire du royaume d'Ašnakkum", RA 93, 1999, p. 79-90: étude, à partir d'un dossier de lettres, de l'histoire du royaume nord-mésoptamien d'Ašnakkum à l'époque de Zimri-Lim et de ses rois Sammêtar, Išme-Addu. Ce royaume est lié à celui d'Urkeš (tell Mozan) et associé aux villes de Šinah et Hurrâ. Des épisodes mouvementés et troubles se placent au moment de l'intervention de l'Elam dans la région (en l'an ZL 9') et dans les deux années qui suivent. Il n'est pas sûr qu'Ili-Sûmû ait régné à Ašnakkum. - IDEM, "Les débuts du règne d'Ibâl-Addu", RA 95, 2001, p. 32-38: mise au point historique sur les événements entourant l'arrivée d'Ibâl-Addu sur le trône d'Aslakkâ, à l'aide des lettres ARM XXVIII 77, 48, 49 et 59.
L - D. LACAMBRE, “Ibni-Erra, un souverain d'Ešnunna?", NABU 1993/29: le fils d'Iqiš-Tišpak, Ibni-Erra, n'a pas régné, contrairement à ce que laissait croire la lecture hypothétique du seul nom d'année connu pour ce personnage (cf. S.D. Simmons, JCS 13, p. 78). - IDEM, “La date de la prise de Râpiqum par Ešnunna et du début de la guerre avec Zimri-Lim", NABU 1993/30: la documentation de Mari permet de situer la prise de Râpiqum par l'armée ešnunnéenne au mois viii de ZL 2'. Ce fut le début d'une guerre qui dura jusqu'au mois vi de ZL 4'. - IDEM, “La bataille de Hirîtum", MARI 8, 1997, p. 431-454: l'a. a réuni la documentation disponible sur cet affrontement qui vit la défaite des Elamites face aux Amorrites coalisés (Babylone, Mari, etc.), dans la 12e année du règne de Zimrî Lîm (ZL 10', soit 1764 av. J. C.). - IDEM, “Le mariage de la princesse Qihila de Mari", NABU 1999/76: Narâm-ilišu, époux de Qihila, l'une des filles du roi de Mari, serait un Ešnunnéen. - IDEM, "Etudes sur le règne de Zimrî-Lîm de Mari", RA 96, 2002, p. 1-21: étude issue de la thèse de l'a., développant trois moments importants du règne de Zimrî-Lîm, à savoir le conflit contre Esnunna, la menace élamite et le conflit avec Hammurabi. – IDEM, "La région du Suhûm (Moyen-Euphrate) et le commerce de l'étain à l'époque de Mari", NABU 2003/29: commentaire de ARM XXV 247 et VIII 75, confirmant que à l'époque de Yahdun-Lîm, le Suhûm sert d'intermédiaire entre Mari et Esnunna pour l'approvisionnement d'étain. - B. LAFONT, "Relations internationales, alliances et diplomatie au temps des royaumes amorrites", Amurru 2, p. 213-328: après avoir présenté les données textuelles, chronologiques et géographiques de la période considérée, l'a. étudie les relations entre les innombrables rois et chefs de tribus, les façons de constituer une alliance, l'organisation de la diplomatie et ses modes de fonctionnement autour des échanges de cadeaux et de personnes (mariages interdynastiques), dominés par la notion de réciprocité. Les rapports entre les souverains reproduisent le schéma de la structure familiale à 3 niveaux: père (abum), fils (mârum), serviteur (wardum), ce schéma étant décliné dans de multiples combinaisons, comme l'illustre le cas d'Atamrum d'Andarig. Les deux rites de conclusion d'une alliance, hayâram qatâlum ("sacrifier l'ânon") et napištam lapâtum ("toucher la gorge") s'enracinent dans deux conceptions culturelles différentes mais complémentaires, la première bédouine et collective, la seconde urbaine et individuelle. Les textes des traités d'époque amorrite représentent une transition entre les sources de la seconde moitié du IIIe millénaire et celles du Ier millénaire (adê), à ceci près que la valeur juridique intrinsèque de l'écrit ne deviendra effective qu'à partir du Bronze récent. Les tablettes de Mari attestent donc la mise en place d'un véritable système de relations, codifié et méthodiquement organisé, qui fut ensuite emprunté par les grands rois de l'époque amarnienne (XVe-XIIIe s.). Amarna ne serait donc pas le premier système diplomatique (cf. l'opinion contraire de R. Cohen et R. Westbrook, Diplomacy). - B. LION, “Yatârum et ses homonymes", NABU 1995/47: point sur les différents personnages porteurs de ce NP dans la documentation de Mari, qui conduit à réduire à une douzaine le chiffre initial de dix-neuf homonymes répertoriés en ARM XXVI/1. - EADEM, “ARMT XXVII 19 et le siège de Kurdâ par Bûnû-Eštar", NABU 1995/18: la lettre ARMT XXVII 19 documente un épisode des changements diplomatiques intervenus en Ida-Maras. Zimrî-Lîm ne soutient plus Simah-ilânê et laisse son nouvel allié, Bûnû-Eštar, envahir Kurdâ. - EADEM, "Les gouverneurs provinciaux du royaume de Mari à l'époque de Zimrî-Lîm", Amurru 2, p. 141-209: étude terminologique et prosopographique sur les gouverneurs des 4 districts centraux du royaume de Zimrî-Lîm (Mari, Terqa, Saggarâtum et Qattunân). Le terme halsum ne correspond pas à une structure administrative unique du type "district", mais désigne plutôt une "zone de compétence" ou une "zone d'autorité". L'arrivée au pouvoir de Zimrî-Lîm est marquée par une grande instabilité des gouverneurs qui se succèdent à un rythme parfois étonnant (3 changements à Qattunân en un an). Les carrières de ces fonctionnaires obéissent à un mouvement centripète, les conduisant toujours plus loin de la capitale. Leurs attributions sont surtout diplomatiques, les fonctions judiciaires et militaires étant moins bien attestées dans leur correspondance.
M - P. MARELLO, “Documents pour l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie IV: Lammassi-Aššur", MARI 7, 1993, p. 271-279: éd. de deux tablettes mentionnant Lammassi-Aššur, et permettant de confirmer son identification comme reine d'Ekallatum (et donc épouse d'Išme-Dagan) proposée par M. Birot. - S. MAUL, “Zwischen Sparmassnahme und Revolte... Die Aktivitäten des Iasîm-Sûmû, des šandabakkum von Mari", MARI 8, 1997, p. 755-774: nouvelle synthèse sur les activités de Yasîm-Sûmû, comptable archiviste de Zimrî-Lîm, à la suite de la publication récente de 20 nouvelles lettres de ce personnage, venant compléter le dossier réuni et analysé par M. Birot. Les attribution de cet officier sont très étendues: stockage des denrées et matières premières de la couronne, gestion et surveillance du personnel du palais, approvisionnement du personnel, des invités et des militaires, division du travail, inspection des moissonneurs. Les textes documentent les efforts déployés par Yasîm-Sûmû pour compenser les déficits chroniques de matières premières et de personnel. - IDEM, “Korrekturen zu M.A.R.I. 8 (1997), S. 755-774", NABU 1997/77. - J. L. MILLER, "Anum-Hirbi and His Kingdom", AOF 28/1, 2001, p. 65-101: l'énigmatique roi Anum-Hirbi aurait régné de 1795 à1765 sur un royaume situé en Anatolie, et dont l'a. tente de préciser les frontières: Haššu du côté de Gaziantep, Ma'ama entre Göksun et Maraş, Zalwar sur le haut Karasu et le mont Adalur, dans le Kara Dağ. L'a. ajoute un commentaire général sur le nom du roi, quelques éléments d'histoire politique et événementielle ainsi que des considérations sur le peuplement.
P - L. PECHA, "Das Amt des šassukkum in der altbabylonischen Zeit", ArOr 67, 1999, p. 51-71: synthèse sur les attributions du šassukkum d'après les sources paléo-babyloniennes, d'où il ressort que les fonctions précises de cet officier ne peuvent être limitativement définies. Les attributions très larges d'un Šamaš-hazir ne sont peut-être pas représentatives de la fonction mais plutôt liées au rang élevé de ce personnage dans l'administration royale, chargé de la gestion de l'ensemble des tenures dans le royaume. - R. PIENTKA, Die spätbabylonische Zeit, 2 vol., IMGULA 2, 1998: après une étude du contexte historique, économique et culturel de la période allant d'Abi-ešuh à Samsu-ditana, l'a. étude les sources par lieu de découverte (Babylone, Kiš, Áupur-Šubula, Dilbat, Sippar, Tell ed-Dêr) en abordant pour chacun les aspects de géographie et d'urbanisme et les aspects religieux (panthéon, cultes). - F. POMPONIO et A. ROSITANI, “Rîm-Anum di Uruk", in: Fs Loretz, p. 634-649: reconstitution de la chronologie du règne de Rîm-Anum à partir des noms de mois figurant dans les cinq formules de datation connues pour ce roi.
R - O. ROUAULT, “Les relations internationales en Mésopotamie du nord. Techniques d'expansion et stratégies de survie", in: Relations internationales, p. 95-106: à partir de l'exemple de Terqa, l'a. examine les divers moyens imaginés par les petits Etats du nord de la Mésopotamie pour résister aux ambitions de leurs voisins. Outre les stratégies habituelles (mariage, alliances diplomatiques), le roi détournait parfois une titulature royale prestigieuse comme celle de Mari pour renforcer, au moins symboliquement, son autorité.
S - S. SANATI-MÜLLER, “Rîm-Anums Absetzung durch Samsu-ilûna in Uruk", NABU 1996/23: deux formules de datation en référence à Samsu-iluna sur des tablettes d'Uruk permettent d'affiner le synchronisme des rois de la dynastie de Sînkâšid (en l'espèce Rîm-Anum). - C. SAPORETTI, "Due ponti sulla cronologia di Ešnunna", in: Gs Cagni, vol. II, p. 913-920: 1/ l'année “de l'ivoire de l'éléphant" attesté dans la 4e (IM 54569) des 6 listes de noms d'années d'Ešnunna, correspond à l'année “de la grande porte du kikurrûm" figurant dans la liste 1 (IM 52962). 2/ Il n'y a qu'un seul Dannum-tâhâz (contra D. Charpin), contemporain de Yasmah-Addu, et se plaçant après Narâm-Sîn dans la chronologie des rois d'Eshnunna. - J. SASSON, “Mariage entre grandes familles", NABU 1993/52: nouvelle interprétation de la tablette A. 1224 (MARI 6, p. 283-285), à propos du mariage de Yasmah-Addu avec Beltum. Il s'agit d'un memorandum du mariage unissant deux grandes familles, sous le contrôle bienveillant de Samsi-Addu. - IDEM, "On Reading the diplomatic Letters in the Mari Archives", Amurru 2, p. 329-338: analyse interne de 2 lettres de Mari pour mesurer leur efficacité dans la reconstruction historique des événements politiques qu'elles décrivent. 1/ La lettre de Yatar-Addu à Zimri-Lim à propos d'une alliance de Babylone avec l'Elam (éditée par J. -M. Durand dans Fs Fleury) n'apporte que des miettes d'informations glanées par l'expéditeur, et ne peut être reliée à un contexte chronologique sûr, ce qui hypothèque son commentaire historique. 2/ La nouvelle de la mort de Zuzu, qu'Ibal-El décrit à Zimri-Lim en 3 versions (éditée par D. Charpin dans Cahiers de NABU 1990), est contredite par ARM X 122+, qui décrit la capture du roi d'Apum par Zimri-Lim. La transmission de cette information erronée par un diplomate obéit à des conventions qui nous échappent. Il ne faut donc pas lire les lettres de Mari pour elles-mêmes mais pour découvrir la motivation qu'elles cachent. - P. STEINKELLER, "Išbi-Erra's Himmelfahrt", NABU 1992/4: la tradition néosumérienne de la "montée au ciel" du roi divinisé a été reprise par Išbi-Erra d'Isin et ses successeurs pour établir la légitimité de la dynastie.
V - M. VAN DE MIEROOP, “The Reign of Rim-Sin", RA 87/1, 1993, p. 47-69: le règne du dernier roi indépendant de la dynastie de Larsa a été marqué par une importante réforme administrative destinée non pas à affirmer sa puissance après sa victoire sur Isin, mais à lutter contre l'influence grandissante de Hammurabi de Babylone. La centralisation politique opérée par Rîm-Sîn est illustrée par le rôle accru du palais dans les systèmes agraire et fiscal, la proclamation d'une andurârum et la modification du calendrier. - F. VAN KOPPEN, "Išar-Lim, 'governor of the Amorites' ", NABU 2002/21: le titre nouvellement créé de šâpir mar-tu “gouverneur des Amorrites", porté par Išar-Lim, correspond à la nouvelle titulature de Hammurabi après sa conquête de Mari (“roi de tout le pays des Amorrites") et confirme qu'Išar-Lim fut bien l'administrateur en chef de Mari après la conquête babylonienne (J. -M. Durand). - K. R. VEENHOF, “The Sequence of the ‘Overseers of the Merchants' at Sippar and the Date of the Year-Eponymy of Habil-kênum", JEOL 30, 1987-1988, p. 32-37: datation de l'éponymat de Habil-kênum d'après les nombreux textes de Šehnâ (ancienne Šubat-Enlil = Leilan) dans lequel il apparaît, ainsi que trois memorandums de Sippar (dont deux inédits): Hammurabi 43 (ou 42) et Samsu-iluna 1(ou 2). Ces sources confirment par ailleurs la remarque de D. Charpin quant à la coexistence possible de deux ugula à l'époque paléo-babylonienne. - P. VILLARD, “La mort de Sûmu-Epuh et la révolte des Turukkéens", NABU 1993/119: l'a. conteste la proposition de J. Eidem d'abaisser la date de la mort du roi d'Alep, Sûmu-Epuh, en se référant à la reconstitution des règnes de Yarim-Lim et Zimri-Lim ainsi qu'à la chronologie des gouverneurs de Tuttul. - IDEM, “La place des années de “Kahat" et d'“Adad d'Alep" dans la chronologie du règne de Zimri-Lim", MARI 7, 1993, p. 315-328: l'année de la “prise de Kahat“ est un doublet pour l'année “où Zimri-Lim a fait faire la statue d'Annunîtum de Šîhrim" (ZL 2); celle de “la statue d'Adad d'Alep" correspond à l'année “où Zimri-Lim a remis en état les bords de l'Euphrate" (ZL 3). - IDEM, "Les administrateurs de l'époque de Yasmah-Addu", Amurru 2, p. 9-140: à partir d'une étude prosopographique des hauts fonctionnaires du royaume de Mari à l'époque de Yasmah-Addu, l'a. examine leurs attributions administratives et retrace les étapes du déroulement de leur carrière. Cette rigoureuse analyse fait ressortir la grande mobilité du personnel administratif, liée à des considérations parfois contingentes, mais aussi à une stratégie politique consistant à associer les élites locales à la gestion du royaume afin de créer un corps uni dans la fidélité au roi et non pas divisé par des particularismes régionaux. Il est difficile de distinguer clairement domaine privé et domaine public dans les textes, l'opposition bîtum/ekallum (maison/palais) désignant tantôt le patrimoine privé du prince par rapport au domaine public, tantôt la gestion administrative des affaires par rapport à leur gestion politique. - G. VOET, “Het Ur-Utu archief: evolutie in de zegelpraxis", Akkadica 72, 1991, p. 20-36: les tablettes les plus récentes des archives d'Ur-Utu, datées de la 17e année d'Ammi-saduqa, documentent l'arrivée d'éléments nomades étrangers, les Cassites, qui déstabilisent la société. L'a. étudie les sceaux de la période comprise entre la fin de la dynastie babylonienne et les premiers documents cassites. A défaut de tablettes pour cette période, la glyptique fournit des informations utiles sur les structures sociales alors existantes.
Y - W. YUHONG, "Samsi-Adad died in Vth of the eponymy of Tab-silli-Ashur since Yasmah-Addu entered his paternal estate on 5/VIth of the year", NABU 1992/91: la documentation de Mari, concernant l'accès au trône de Yasmah-Addu, la visite de ce roi à Ekallatum et la rupture du traité entre Ibal-pî-el d'Esnunna et Samsi-Addu, permettent d'affiner la date de la mort de Samsi-Addu. Les troubles consécutifs à son décès ont provoqué un retard de 5 mois dans l'attribution de l'éponymat. - IDEM, "Yarkab-Addu, the king of Subat-Samas", NABU 1992/50: plusieurs lettres de Mari font de Yarkab-Addu le roi de Subat-Samas, une ville du Zalmaqqum. - W. YUHONG et S. DALLEY, “The Origins of the Manana Dynasty at Kish, and the Assyrian King List", Iraq 52, 1990, p. 159-165: les aa. étudient les implications possibles de la réception du culte de Nanna, dieu sumérien de la lune, chez les Amorrites. La mention de serments prêtés par deux rois successivement ou en même temps, dans certains récits, se justifierait par la coexistence de deux souverains à la tête d'une même région, et expliquerait pourquoi la liste assyrienne contient deux lignages séparés.
Z - Y. ZHI, “The king Lugal-ane-mundu", JAC 4, 1989, p. 55-60: l'a. se penche sur l'une des trois attestations de ce roi d'Adab fournie par l'inédit CBS 342. Ce texte fragmentaire remonte à la période d'Isin-Larsa, pour laquelle aucune donnée archéologique ni épigraphique ne documente la puissance d'Adab. L'inscription constitue alors soit une fiction littéraire, soit l'œuvre d'un des premiers rois paléo-babyloniens en quête de célébrité. - N. ZIEGLER, "A questionable Daughter-in-Law", JCS 51, 1999, p. 55-59: éd. d'une lettre de Mari qui montre que Yasmah-Addu, roi de Mari, n'hésita pas à disposer des filles de son prédécesseur et ennemi Yahdun-Lim pour les marier à des fils de grandes familles. – EADEM, "Le harem du vaincu", in: Traditions amorrites, p. 1-26: étude de l'appropriation du harem royal du vaincu par le vainqueur d'après les textes de Mari. L'a. développe l'exemple de Zimri-Lim avec Mari (Yasmah-Addu), Burundum, Kahat, Ašlakka, examine la structure des harems et les listes de déportations. Ces informations sont mises en parallèle avec les témoignages bibliques des harems de David et de Salomon. Réédition de la tablette présentant la liste des femmes prises comme butin par le roi de Mari à Ašlakka.
A - M. ANBAR, “ARMT VII.219", NABU 1992/100: la relecture de la tablette ARMT VII, 219 permet à l'a. de restituer le toponyme Za-an-an-nimKI, antérieurement lu Za-an-na-nimKI. - M. C. ASTOUR, "The North Mesopotamian Kingdom of Ilânsura", in: Mari in Retrospect, p. 1-33: d'après les sources épigraphiques et archéologiques, le royaume d'Ilânsura devrait se situer à l'extrême nord de la Mésopotamie. L'ordalie de Hâya-sûmu, étudiée par G. Dossin, apporte des informations sur l'organisation politique de cette région, gouvernée par un roi vassal de Zimri-Lim, et sur la localisation géographique de ce royaume, établi sur la rive du Tigre, dans les hauteurs du Tûr Abdin.
C - D. CHARPIN, “Le point sur les deux Sippar", NABU 1992/114: nouvelles informations venant confirmer l'existence des villes jumelles de Sippar, l'une à Abu Habbah (Sippar Yahrurum) et l'autre à Tell ed-Dêr (Sippar Amnânum). - IDEM, “Tell Munbaqa, Ekallâtum-sur-l'Euphrate", NABU 1993/32: la lettre ARM I 91+ révèle l'existence d'une autre ville d'Ekallâtum, proche du Yamhad et non pas sur la rive du Tigre. C'est un nouvel exemple de la “toponymie en miroir" de l'époque amorrite. - IDEM, “Le toponyme ADKirum", NABU 1995/82: la relecture d'ARM XXII 123 fait apparaître un nouveau toponyme jusqu'ici inconnu, dans l'expression lú aD-KI-ri-imki. - IDEM, “Centre et périphérie", NABU 1995/86: à propos d'un usage épistolaire consistant à citer les toponymes du plus éloigné au plus proche de Mari. - IDEM, "Toponymie amorrite et toponymie biblique: la ville de Sîbat/Sobah", in: Traditions amorrites, p. 79-92: éd. et étude d'une tablette inédite de Mari permettant de localiser la ville de Sîbat dans la vallée de la Beqa'a. Elle doit être identifiée à la ville citée dans les sources néo-assyriennes comme Supat/Supite et avec la Sobah de la Bible. - IDEM, “Sapîratum, ville du Suhûm", MARI 8, 1997, p. 341-366: la ville de Sapîratum était connue par des textes du Ier millénaire et a été identifiée avec le site de l'île de Bêgân sur l'Euphrate. Elle est désormais attestée au début du IIe millénaire et l'a. a réuni le dossier des différentes attestations disponibles dans la documentation de Mari, de l'époque de Yahdun Lîm à celle de Zimrî Lîm. - IDEM, "L'énumération des villes dans le prologue du “Code de Hammurabi" ", NABU 2003/3: reprise de l'analyse de V. A. Hurowitz sur l'ordre d'énumération des villes dans le prologue du Code, conforté par les travaux de Steinkeller sur la topographie du sud babylonien: les sept villes de la périphérie orientale sont situées sur le Tigre et présentées d'aval en amont. - E. N. COOPER, “Trade, Trouble and Taxation along the Caravan Road of the Mari Period", in S.E. Orel éd., Death and Taxes in the Ancient Near East, 1992, p. 1-15: sur les dangers des transports par caravane, quel que soit l'itinéraire, le long de l'Euphrate (ou sur le fleuve lui-même) ou par les steppes syriennes de Mari à Qatnâ, puis au-delà Byblos ou Hazor.
D - J. -M. DURAND et M. GHOUTI, “Ville fantômes de Palestine", NABU 1991/90: les toponymes mentionnés dans ARM VI, 23 ne sont pas les différentes étapes d'une route vers l'ouest mais les principales villes occidentales que rencontre un voyageur venu de l'est. - J. -M. DURAND et B. LAFONT, “Karanâ dans les textes de Mari", NABU 1991/35: toutes les attestations de Karanâ dans les tablettes de Mari font référence à la ville du Sinjar et non à celle du Zab inférieur.
E - J. EIDEM, “Some Upper Mesopotamian Topomyms", NABU 1996/6: rectificatifs et nouveautés sur les toponymes de Haute Mésopotamie.
G - B. GRONEBERG, "Le Golfe arabo-persique vu depuis Mari", in: Fs Fleury, p. 69-80: regroupement de tous les documents de Mari se rapportant à Tilmun (Koweit) et attestant les liens existant entre le Moyen-Euphrate et les régions du Golfe au temps des rois de Mari.
H - W. HEIMPEL, “Ša mušen.há = Ša Hi/ussurâtim", NABU 1997/114: c'est une ville Yaminite des environs de Mari.
J - F. JOANNES, “Routes et voies de communication dans les Archives de Mari", Amurru 1, p. 323-361: synthèse sur les routes et les voies de communication d'après par les sources de Mari. Les conditions générales d’utilisation de la route, ainsi qu’une vue d’ensemble du réseau des routes empruntées à l’époque sont présentées. Corrélativement, la localisation de certaines villes est proposée. Enfin, à travers l’exemple du sud Sindjar, l’a. tente de définir les critères propres à une délimitation régionale.
S - A. SKAIST, “The Sale Contracts from Khafajah", in: Fs Artzi, p. 255-276: les contrats de vente de cette ville (ancienne Tutub, près d'Ešnunna) remontant au XIXe s. attestent le caractère particulier de cette région, zone de transition entre le centre, constitué par la basse-Mésopotamie, et la périphérie. Les divers modèles de contrat répertoriés et les formules juridiques qu'ils contiennent témoignent, sur le plan juridique, de cette interaction politique et historique. - P. STEINKELLER, “More on Ha-LAM = Ha-labx", NABU 1993/10: confirmation de l'identification du toponyme Ha-LAM = Ha-labx= Alep grâce à l'onomastique paléo-babylonienne d'Isin. - M. STOL, “Der altbabylonische Stadt Halhalla", in: Fs Römer, p. 415-445: l'étude se fonde sur les textes de Sippar mentionnant la ville de Halhalla ou des lieux et des personnes en lien avec cette localité. L'a. s'intéresse à la géographie de la ville (porte, canaux) et à son peuplement (Anciens et maire, affaires judiciaires, pratiques cultuelles, notables).
V - G. VAN DRIEL, “Old Babylonian Nippur", BiOr 47, 1990, p. 559-577: compte rendu de E. Stone, Nippur Neighborhoods, 1987. Le recenseur discute l'histoire socio-économique reconstituée dans cet ouvrage et conteste la méthodologie employée par E. Stone consistant à partir de théories modernes pour les vérifier dans les textes et sur le terrain. Ainsi l'absence de textes pour la période comprise entre Iddin-Dagan et Ur-Ninurta résulte-t-elle peut-être moins d'une réelle crise que des hasards de l'archéologie. - P. VILLARD, “Une nouvelle attestation d'Ekallâtum de l'Euphrate?", NABU 1993/120: le texte administratif ARM 24, 152 confirme l'existence d'une Ekallâtum sur l'Euphrate, à l'emplacement du site actuel de Tell Munbaqâ.
W - M. WÄFLER, “Kahat, Tâdum und Ilansurâ", NABU 1995/31: l'a. conteste la localisation des trois villes de Kahat, Tâdum et Ilansurâ proposée par M. Guichard (Gs Birot, 1994). La topographie historique fournie par les sources elles-mêmes est douteuse; l'archéologie ne confirme pas les identifications proposées; la localisation de Tâdum à Tall al-Samîdîya n'est pas argumentée. - Y. WU, “The locality of the four cities in ARM I 138 and 131 and the date of the two letters", JAC 4, 1989, p. 49-53: à propos de deux lettres d'Išme-Dagan à Yasmah-Addu mentionnant la victoire sur quatre villes, dont on retrouve mention sur une stèle de Daduša d'Ešnunna. L'a. tente de localiser les quatre cités et de dater les textes, en se référant à l'expédition conjointe “assyro"-ešnunnéenne. - IDEM, “The Extent of Turukkean Raids during the Reign of Šamši-Adad I", JAC 8, 1993, p. 114-126: à l'aide de onze textes de Mari présentés en translittération et traduction, l'a. reconstitue la progression géographique des Turukkéens en Haute-Mésopotamie, et propose de localiser Amursakkum, dont l'occupation par les Turukkéens menace Šubat-Enlil, dans le nord du Jebel Sinjar.
Y - W. YUHONG, "Yakaltum=Ekalte=Tell Munbaqa on the east bank of the Euphrate", NABU 1992/51: l'itinéraire de Zimri-Lim en route vers Halab suggère que l'ancienne Ekalte (Tell Munbaqa) s'écrivait et se prononçait Yakaltum à l'époque paléobabylonienne. - IDEM, “The Localisation of Nurrugum and Ninet=Ninuwa", NABU 1994/38: l'a. propose de lire en TH 72-2 la séquence a-lum-ma Ni-ne-et!ki, “la ville est Ninet/Ninive", prise par Išme-Dagan pendant la campagne de Nurrugum. Cette attestation s'ajoute aux deux autres mentions de cette ville dans les sources de Mari. - IDEM, “Mebbidum of Hab(b)a’um in the tablets of Yahdun-Lim and Hab(b)’um (not Haššum!) of Membida in ARM 1, 37", NABU 1994/67: il y a bien deux villes de Habba’um, l'une attestée en ARM 1, 37 dans l'expression “la Habba’um de Membida", peut-être l'ancienne Chagar Bazar (MARI 4, 318), et l'autre située dans le Yamhad.
Z - N. ZIEGLER, "A propos de l'itinéraire paléo-babylonien UIOM 2134 iv:2'-4' ", NABU 2002/48: restitutions d'une partie de l'itinéraire UIOM 2134, avec notamment la restauration l. 2' de Situllum. Le parcours comporte des étapes d'une quarantaine de kilomètres par jour, effectuées par voie terrestre et non fluviale.
B - D. BONNETERRE, “Surveiller, punir et se venger: la violence d'Etat à Mari", MARI 8, 1997, p. 537-561: analyse anthropologique de la violence pratiquée ou encouragée par le roi de Mari, dans le cadre judiciaire mais aussi politique. La substitution de l'Etat à la victime dans la punition des crimes a conduit à un système pénal répressif. La société se structure sur la coercition sous couvert de sanctions religieuses purifiant la communauté. La violence devient ainsi un mode de relations sociales, entretenu par l'Etat et pratiqué ouvertement ou clandestinement. - E. BOUZON, “Die soziale Bedeutung des simdat-šarrim-Aktes nach den Kaufverträgen der Rim-Sin-Zeit", in: Fs von Soden, p. 11-30: les contrats datés du règne de Rîm-Sîn mentionnant une simdat šarrim, rendent licite la contestation par le vendeur d'une transaction foncière antérieure. Le revendiquant obtient l'annulation de la vente, ou une indemnité ou enfin un bien foncier équivalent. L'a. suit les conclusions de Kraus (RA 13, p. 58) sur l'évolution sémantique de l'expression simdat šarrim, dont le sens technique d'intervention royale à teneur socio-économique (époque de Larsa) glisse vers un sens général, synonyme de mîšarum. Le contexte récurrent de crise et de paupérisation des petits propriétaires fonciers explique ces actes de la royauté, destinés à ramener la paix sociale. - T. BRECKWOLDT, “Management of Grain Storage in Old Babylonian Larsa", AfO 42-43, 1995/1996, p. 64-88: à partir de l'éd. complète de 10 tablettes datées du règne de Rîm-Sînles, l'a. se penche sur les mécanismes de stockage des céréales à Larsa. Les récoltes étaient acheminées une ou deux fois par an depuis les villes de province vers la capitale, sous le contrôle d'agents du pouvoir central, notamment Silli-Šamaš, qui rendait compte de sa gestion à Balmunamhe. Le grain était transporté par bateau, sous le contrôle conjoint des agents royaux et des marchands. Il arrivait directement dans les greniers de Larsa grâce à deux canaux internes à la ville, les surplus étant stockés dans des greniers privés mis sous scellés. Une partie de la production était distribuée aux temples. Les terres céréalières appartenaient sans doute au palais ou à l'Etat qui recevait ainsi la production réalisée par ses tenanciers. Les greniers servaient de banques, les stocks de grains représentant la richesse de l'Etat et pouvant servir à consentir des prêts. - W. BURGGRAAFF, “Belijatum: an agricultural entrepreneur in the Old Babylonian Period", AuOr 13, 1995, p. 161-167: analyse d'un lot de textes mentionnant l'iššakkum Beliyatum. Ce personnage louait des champs à taux fixe auprès de particuliers, assumant ainsi les risques des opérations agricoles alors que le propriétaire/tenancier de la terre assurait ses propres revenus. L'a. considère l'iššakkum comme un libre entrepreneur et non un cultivateur de l'État.
C - Y. CALVET,"Remarques sur l'urbanisme de Larsa à l'époque paléo-babylonienne", in: Fs Huot, p. 57-68: l'observation des photos aériennes du site de Larsa montre qu'un canal reliait la ville à l'Euphrate, passant à proximité de Larsa et non pas dans l'agglomération elle-même. - D. CHARPIN, “qabbâ’um ‘délateur'?", NABU 1993/23: le terme qabbâ’um désigne non pas un délateur occasionnel, mais une fonction proche de celle d'accusateur public. - IDEM, “A propos des contrats d'embauche pour la moisson", NABU 1993/58: la multiplication des contrats saisonniers pour la moisson, à la fin de l'époque paléo-babylonienne, reflète peut-être la volonté des créanciers d'échapper aux décrets-mîšarum, en déguisant un prêt en contrat d'embauche. - IDEM, "Une alliance contre l'Elam et le rituel du lipit napištim", in: Fs Perrot, p. 109-118: à propos du traité entre Zimri-Lim et Hammurabi de Babylone contre le sukkal d'Elam. L'alliance politique conclue à distance reposait sur la rédaction de deux écrits identiques et non sur un texte bilatéral. L'exemplaire conservé en l'occurrence est celui de Hammurabi. Il éclaire le déroulement de la cérémonie, comportant les gestes symboliques du "toucher de la gorge" (lipit napištim) et de la "main levée" (nîš qâtim) lors de la prestation du serment devant la statue de Šamaš. Ces rites disparaissent lorsque les deux parties sont présentes: on a alors recours à l'immolation d'un ânon effectuée en commun devant témoins. - IDEM, "La mîšarum d'Hammu-rabi après la conquête de Larsa: un nouvel indice", NABU 1991/102: une tablette récemment publiée (RA 85, p. 17), prévoyant l'annulation d'une dette le jour où le texte de la créance sera retrouvé, confirme l'hypothèse de Kraus d'une mîšarum proclamée par Hammurabi après sa conquête de Larsa, dans la 31e ou la 32e année de son règne. Une telle pratique s'apparente aux proclamations effectuées lors de l'avènement du roi. - IDEM, "L'application des édits de mîšarum: traces documentaires", NABU 1992/76: la publication récente de 3 séries de contrats de prêts consignés sur des tablettes (Sigrist, AUCT IV) laisse supposer que les créances ont été annulées, en application de mîšarum datées de Hammurabi et de Samsu-iluna. Une étude statistique pourrait montrer l'augmentation des sources dans les mois précédant la proclamation d'un tel édit. - IDEM, "Immigrés, réfugiés et déportés en Babylonie sous Hammu-rabi et ses successeurs", RAI 38, p. 207-218: l'étude du peuplement de la Babylonie hammurabienne révèle un mélange de cultures issu des immigrations de mercenaires kassites, des afflux d'intellectuels venus de Sumer se réfugier en Babylonie du nord, et des déportations de paysans hourrites. Les degrés d'assimilation de ces diverses populations varient selon leur statut social et les modalités de leur implantation. - IDEM, “Maisons et maisonnées en Babylonie ancienne de Sippar à Ur. Remarques sur les grandes demeures des notables paléo-babyloniens", RAI 40, p. 221-228: la gestion des grandes maisons privées repose sur l'écrit, notamment sur une documentation administrative comparable à celle des palais (repas, activités textiles), qui n'avaient donc pas l'exclusivité de ce type d'archive. Dans ces maisons cohabitent parfois deux générations ou deux frères et leurs familles, ainsi que les serviteurs et parfois les animaux. - IDEM, "Le juste prix", NABU 1999/79: à propos de CT 45 37, où un individu revendique une esclave possédée par une religieuse-nadîtum, laquelle a acheté la servante en période de crise à un prix très inférieur à sa valeur (cf. ll. 17-18). - IDEM, " 'Ein umherziehender Aramäer war mein Vater'. Abraham im Lichte der Quellen aus Mari", in: R. G. Katz et T. Nagel (éd.), “Abraham, unser Vater". Die gemeinsamen Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam, 2003, p. 39-52: les tablettes de Mari documentent plusieurs thèmes évoqués dans les récits des patriarches de la Bible et reflètent une culture commune autour du nomadisme. - M. CHAVALAS, “Nasbum in the Khana Contracts from Terqa", in: Fs Astour, p. 179-188: la clause nasbum ša lâ baqrim u lâ andurârim figurant dans les contrats de vente foncière de Terqa désigne une situation irrévocable, autrement dit un droit de propriété incontestable par réclamation privée (baqârum) ou par édit royal (andurârum). - G. COLBOW, "Priestesses, either Married or Unmarried, and Spouses without Title: Their Seal Use and their Seals in Sippar at the Beginning of the Second Millennium BC", RAI 47, p. 85-90: étude de la pratique des scellements par les femmes dans les archives d'Ur-Utu à Sippar, montrant que les femmes avaient les mêmes droits de propriété et d'usage des sceaux que les hommes, du moins à l'intérieur de l'élite sociale représentée par cette archive familiale. En présence d'un frère ou du père, les femmes s'abstenaient d'apposer leur sceau, tout comme les jeunes frères ou fils.
D - K. DE GRAEF, “Ana tab-ba: qui scelle la tablette de qui?", NABU 1999/34: les pratique sigillographiques dans les baux à ferme comportant deux preneurs (ana tab-ba), et consistant pour chacun à dérouler son sceau sur la tablette de l'autre, permettent de retrouver l'archive à laquelle appartient un contrat. - IDEM, "An Account of the Redistribution of Land to Soldiers in Late Old Babylonian Sippar-Amnânum", JESHO 45/2, 2002, p. 141-178: analyse du document administratif MHET II 6 894 contenant une liste de terrains attribués à des soldats de Sippar. L'a. étudie la localisation des tenures, les mécanismes de redistribution conduisant à l'amenuisement des parcelles d'origine, et le rôle essentiel du général dans l'attribution des terres aux soldats. - L. DEKIERE, “La généalogie d'Ur-Utu, gala-mah à Sippar-Amnânum", in: Fs de Meyer, p. 125-141: étude prosopographique de la famille d'Ur-Utu, grand lamentateur du temple de Sippar, à partir de données pour la plupart inédites. - I. M. DIAKONOFF, “Old Babylonian Ur", JESHO 38, 1995, p. 91-94: review-article de M. Van de Mieroop, Society and Enterprise in Old Babylonian Ur, 1992, qui fait aussi de larges références à D. Charpin, Le clergé d'Ur, 1986. Le recenseur souligne que le travail de Van de Mieroop aurait pu être enrichi grâce aux apports de l'archéologie, et que d'autre part, il traite principalement de la population masculine, délaissant les femmes. - E. DOMBRADI, Die Darstellung des Rechtsaustrags in den altbabylonischen Prozessurkunden, 2 vol., FAOS 20, 1996: minutieuse étude terminologique et littéraire des textes de procès paléo-babyloniens et tableau de l'organisation du procès civil. L'a. montre qu'il existe un formalisme judiciaire contraignant, tout comme dans les contrats. Les minutes de procès comportent un certain nombre de mentions obligatoires, figurant toujours dans le même ordre. Les actes de procédure sont décrits dans un style impersonnel et traduisent une technique juridique, tandis que les faits propres à une affaire sont exposés dans un discours direct personnalisé exprimant la part subjective de chaque dossier. - EADEM, "Studien zu mithârum/mithâriš und die Frage des Duplums: I. Zum semantischen Feld von mithârum in juristischen Kontext", ZA 90/1, 2000, p. 40-69: l'étude sémantique et juridique du terme mithârum/mithâriš dans CT 6 34b montre que l'expression désigne une restitution simple et non pas au double. – EADEM, "Studien zu mithârum/mithâriš und due Frage des Duplums: II. Poenaler Zweck oder sozio-ökonomisch motivierte Regulierung des Vertragsbruch?", ZAR 6, 2000, p. 16-34: suite de l'étude précédente, menée ici autour de l'expression ša ibaqqaru kù-babbar mithâriš liddin figurant dans les textes d'Emar. Il ne s'agit pas d'une clause pénale puisque son but n'est pas de garantir l'exécution du contrat par la menace d'une peine, mais d'une clause gouvernant les modalités du retrait dans des transactions impliquant un transfert de propriété sur des biens ou d'autorité sur des personnes dans un contexte d'antichrèse. - J. -M. DURAND, “Précurseurs syriens aux protocoles néo-assyriens. Considérations sur la vie politique aux Bords-de-l'Euphrate", in: Fs Garelli, p. 13-71: étude des serments politiques prêtés par les devins ou les agents administratifs lors de leur entrée en fonctions, par les intendants (abû bîtim) et par les gouverneurs (šâpitum) pour écarter les suspicions de malversations et d'abus de fonctions, et enfin par la population assurant le roi de sa fidélité dans des époques troublées. Le serment politique n'est donc pas une innovation tardive des Assyriens (adê), mais plutôt une invention syrienne, qui s'accompagne dès l'origine d'un cortège de dénonciations et de calomnies envahissant la vie publique. - IDEM, “Vindicatio in libertatem", NABU 1993/25: à propos d'un texte publié par M. Sigrist (Old Bab. Account Texts in the Horn Archaeological Museum, n° 89) concernant une contestation de servitude, et mentionnant le toponyme Ya’iltum. - IDEM, "Fourmis blanches et fourmis noires", in: Fs Perrot, p. 101-108: éd. d'un texte de Mari attestant la conscience d'une altérité ethnique fondée sur la couleur de la peau. Les Elamites y sont qualifiés de "fourmis noires" face aux "fourmis blanches" amorrites. - IDEM, "L'emploi des toponymes dans l'onomastique d'époque amorrite (1) Les noms en mut", SEL 8, 1991, p. 81-97: dans le cadre d'un inventaire général de l'onomastique amorrite d'après les sources mariotes, l'a. dresse une première liste des noms de personnes composés en mutum + NG. - IDEM, "Unité et diversités au Proche-Orient à l'époque amorrite", RAI 38, p. 97-128: à l'époque amorrite, il n'y a plus de "centre" ni de "périphérie", mais un ensemble proche-oriental à la fois diversifié et homogène. La documentation de Mari illustre cette double caractéristique, mettant en relief des constantes (toponymie, médecine, divination, pratique de l'écrit...) et des différences (divisions claniques et tribales, formes d'affrontements guerriers...). - IDEM, "Réalités amorrites et traditions bibliques", in: Traditions amorrites, p. 3-39: présentation et justification du colloque mentionné ci-dessus. La première partie de l'article procède à l'examen des rapports entre documentation mariote et texte biblique et des problèmes méthodologiques qu'ils posent. Diverses illustrations sont proposées: mise en parallèle de Gen. 12, 20, 26, avec la lettre de Mari A.582, ou encore Jos. 2 et ARM XXVII 116, sur le thème du statut de l'étranger. Recherche des échos que livre la Bible d'événements historiques anciens (Amraphel, roi d'Elam Kedorla‘omer, "épopée" de Nemrod, etc.) La seconde partie de l'article est consacrée au culte des pierres, bétyles et autres pierres levées à l'époque amorrite. Étude des termes sikkanum (en parallèle avec la notion biblique de massêbâh), humûsum et râmum. Comparaison entre la lettre de Mari A.3592 et l'épisode biblique de la rencontre de Jacob et de Laban (Gn. 31: 45-52) à propos d'alliances où il est question de pierres levées. - IDEM, "Zimrî-Lîm achète la ville d'Alahtum", Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 2002, p. 11-30: le dossier de l'acquisition d'Alahtum, une ville de la région d'Alep, est représentatif d'une pratique royale attestée pour d'autres villes dans la même région. Il ne s'agit pas d'un achat mais d'une concession, visant à permettre la “réunion" (hib/psum) des tribus concernées par la transaction, les Benjaminites et les Bensimalites. Le roi de Mari s'engage à remettre en valeur les terres concédées et en recueille la production; le roi d'Alep conserve son droit de convocation à l'ost sur les populations installées sur ces territoires. A terme, cette acquisition représente un investissement du roi en dehors de son royaume: il se procure une source de revenus supplémentaire, tout comme certains dignitaires qui augmentent leurs richesses grâce à des immeubles situés à l'étranger.
E - J. EIDEM, “Hiti-pânam", NABU 1996/7: ce NP assez rare, attesté à Mari, apparaît aussi dans les sources de Tell Rimah, où il pourrait désigner le même personnage, témoignant des contacts intenses entre les villes du Sinjar.
F - R. W. FISCHER, "The Mubassirû Messengers at Mari", in: Mari in Retrospect, p. 113-120: les mubassirû, attestés trois fois seulement, sont des courriers militaires apportant la nouvelle de la victoire (cf. le sémantisme identique de l'hébreu mebaśśer). - J. FLEISHMAN, “The Authority of the Pater Familias according to CH 117", in: Fs Artzi, p. 249-253: l'expression ana kaspim désigne en principe une vente juridiquement complète, comme l'indique son occurrence dans le § 117 CH, où elle désigne un transfert complet de la propriété. Il y a dès lors une incohérence dans cette loi: la protase envisage le cas où un père vend (ana kaspim) ou donne en servitude (ana kiššatim) pour dette un membre de sa famille, puis l'apodose prévoit la libération du parent après 3 ans. En réalité, le code interdit d'aliéner complètement l'un des siens en remboursement d'une dette et autorise seulement à effectuer un prêt d'une durée limitée. Les expressions ana kaspim et ana kiššatim ont donc le même sens dans ce texte. - IDEM, "Legal Continuation and reform in Codex Hammurabi Paragraphs 168-169", ZAR 5, 1999, p. 54-65: postulant que les filiations adoptive et légitime peuvent être contestées de la même manière et qu'elles sont susceptibles des mêmes sanctions, l'a. interprète les §§ 168-169 du CH comme une interdiction faite aux parents de nier arbitrairement leur lien de parenté avec l'enfant rebelle. La protase de ces lois s'inspirerait de la pratique juridique sur la contestation de filiation (YOS I 28; ana ittišu), supposant toujours un manquement de l'enfant (biologique ou adopté) à ses obligations familiales, et l'apodose introduirait une innovation du législateur, limitant le droit d'exhérédation à la constatation judiciaire d'une seconde faute lourde. - IDEM, "Child Maintenance in the Laws of Eshnunna", ZAR 7, 2001, p. 374-383: les §§ 32-35 des LE montrent que les parents ont envers leurs enfants une obligation d'entretien et d'éducation. S'ils n'assurent pas cet entretien, en manifestant leur autorité parentale, en payant notamment les frais de nourrice, ils perdent leurs droits sur l'enfant au profit de la personne qui a assumé à leur place la charge de son éducation. Ce principe est inapplicable lorsque l'enfant à été obtenue par des moyens illicites (§ 33-35: cas de l'enfant d'une servante d'un particulier, d'un muškênum ou du palais, confié frauduleusement à un tiers). La parentalité n'est donc pas fondée sur le seul lien biologique entre l'enfant et ses père et mère, dont l'autorité est révocable en cas de défaillance grave et volontaire de leur part. - IDEM, "Legal Sanctions Imposed on Parents in Old Babylonian Legal Sources", JAOS 121, 2001, p. 93-97: les sources paléo-babyloniennes (actes de la pratique, textes scolaires) montrent qu'un parent ne pouvait rompre sans motif le lien juridique l'unissant à son enfant. Cette conclusion, fondée sur les clauses pénales des actes d'adoption, est étendue à la filiation légitime, les deux statuts étant juridiquement identiques et procurant aux enfants les mêmes droits. En général, le père qui renie son fils sans pouvoir lui imputer de faute perd sa maison et ses biens. Il incombe aux juges d'établir l'absence de faute à la charge de l'enfant, après quoi s'opère un partage anticipé du patrimoine, pour remettre à l'enfant évincé la part qui lui revient sans léser les autres héritiers. - D. FLEMING, “Counting Time at Mari and in Early Second Millenium Mesopotamia", MARI 8, 1997, p. 675-692: à partir des habitudes de notation du temps dans les prédictions des devins de Mari, l'a. étudie le comput du temps en jours/mois/années à Mari par comparaison avec le système attesté par les lettres de Babylonie et la correspondance des marchands paléo-assyriens. - IDEM, "Mari and the Possibilities of Biblical Memory", in: Traditions amorrites, p. 41-78: étude historiographique et méthodologique sur les rapprochements possibles entre l'époque amorrite et la Bible. L'a. constate que le scepticisme l'a largement emporté jusqu'à présent sur les possibilités de tels rapprochements. Deux axes de recherche sont proposés: 1) l'étude des parallèles entre tribus amorrites et tribus d'Israël; l'a. discute les thèses de Rowton, Thompson et Lemche (ces 2 derniers sous-estimant le l'intérêt potentiel de Mari); l'interférence d'éléments tribaux et sédentaires est constatée dans les formes de la monarchie et les structures sociales aussi bien à Mari que dans la Bible. Plutôt qu'une opposition nomades/sédentaires, on constate dans les deux cas une forte intégration de la population nomade dans des ensembles plus vastes régis par des liens de nature tribale. L'a. souligne les différences, à Mari, entre Sim'alites et Yaminites, les premiers étant moins sédentarisés; ces différences sont visibles dans le vocabulaire et les schémas d'organisation sociale (sugâgum, gayum, hibrum, kadûm, lîmum). 2) L'a. réévalue ensuite certaines comparaisons entre les traditions patriarcales de la Genèse et les textes de Mari, à propos de Harran et de la tribu de Benjamin notamment. Il est possible qu'il y ait des réminiscences des traditions yaminites dans la Genèse.
G - P. GENTILI, “Tabelle razionarie da Mari", EVO 19, 1996, p. 89-120: à partir des archives royales de Mari, l'a. présente sous forme de tableaux, issus de sa thèse de doctorat, les modes de rétribution et de redistribution des biens pour les travailleurs du palais, depuis l'époque des šakkanakku jusqu'au règne de Zimri-Lim. - T. GÖTZELT, "Descent, private and public: Social environment in early Mesopotamia", AOF 29/2, 2002, p. 339-354: étude des représentations spatiales de la société paléo-babylonienne autour des notions généalogiques de temps (parenté) et d'espace (résidence), ainsi que d'après les différenciations segmentaires (tribalisme/étatisme). - S. GREENGUS, "Redifining “Inchoate Marriage" in Old Babylonian Contexts", in: Fs Jacobsen, p. 123-140: la formation du mariage babylonien ne se réduit pas à 2 étapes (mariage inchoatif/mariage complet) mais comporte 5 stades: délibératif, pré-nuptial, nuptial, conjugal et familial. - M. GUICHARD, “Le sel à Mari (III). Les lieux du sel", in: Gs Barrelet, p. 167-200: étude des divers emplois du sel par sites géographiques. L'un des textes (n°16) évoque la mise en gage d'une femme, enfermée dans l'ergastule tant que l'agriculteur (ikkarum) dont elle dépend n'aura pas livré les pains de sel. La pratique semble être courante puisque la lettre signale que toutes les autres femmes détenues en gage pour la même raison ont été libérées. L'a. fait le point sur le lexique du sel, les salines (à Ha††â et Îâbâtum), et le rôle prépondérant du palais dans la production et la distribution de sel. - C. GÜNBATTI, "Eski Babil devrinde Timar ve devlet arazısının tahsisi hakkında bazı görüşler (= Certaines vues concernant la destination de la terre publique et du Timar à l'époque paléobabylonienne)", Belleten 212, 1991, p. 1-12.
H - R. HAASE, "Inzestuöse Beziehungen im Codex Hammurapi", ZAR 5, 1999, p. 66-70: synthèse sur l'inceste dans le droit hammurabien, n'intégrant pas les travaux récents sur ce thème. - W. HEIMPEL, "Disposition of Households of Officials in Ur III and Mari", ASJ 19, 1997, p. 63-82: réponse à l'article de Maekawa (ASJ 16) à partir des sources de Mari. L'a. explique les confiscations des biens des dignitaires administratifs mariotes par leur statut d'esclaves du roi, lequel ne fait qu'exercer son droit de propriété. Même si les gouverneurs d'Ur III n'avaient pas le statut d'esclaves du souverain, ils ne faisaient que restituer à leur départ des biens appartenant à l'administration centrale. Ni à Mari ni à Ur III, on ne peut donc parler valablement de confiscation. - J. -G. HEINTZ, “‘Dans la plénitude du cœur'. A propos d'une formule d'alliance à Mari, en Assyrie et dans la Bible", in: Ce Dieu qui vient. Mélanges offerts à Bernard Renaud, Lectio divina 159, 1995, p. 31-44: la documentation de Mari invalide les théories bibliques rejetant la notion d'alliance avant le milieu du IIe millénaire. Les traités et la correspondance diplomatique de Mari utilisent le même vocabulaire que les passages bibliques sur l'alliance de Dieu avec son peuple, insistant sur la sincérité du cœur. La tradition néo-assyrienne des adê reprise par l'Ancien Testament semble donc provenir d'un fonds commun sémitique remontant à l'époque amorrite. - IDEM, "Genèse 31, 43 – 32, 1. Un récit de pacte bipartite: son arrière-plan rituel et sa cohérence narrative", in: J. -D. Macchi et Th. Römer (éd. ), Jacob. Commentaire à plusieurs voix de Genèse 25-36, Mélanges offerts à Albert de Pury, Genève, 2001, p. 163-180: étude du rite d'alliance entre Laban et Jacob. L'exégèse biblique traditionnelle attribue deux sources documentaires à cet épisode, correspondant à une alliance personnelle et une alliance collective. Les textes de Mari incitent à reconsidérer cette question pour admettre l'unité d'inspiration du récit biblique, qui se fait l'écho d'une époque où les pactes d'alliance étaient, comme l'a montré J.-M. Durand, de structure binaire, consistant à la fois à ériger une stèle et à prêter un serment. - P. HOSKISSON, "The Nîsum ‘Oath' in Mari", in: Mari in Retrospect, p. 203-210: analyse du serment parlé à Mari, des gestes rituels accomplis (lipit napistim, tabou-asakkum), des expressions de la soumission du vassal et de la force particulière de l'engagement accepté sous la foi du serment. - V. A. HUROWITZ, Inu Anum sîrum. Literary Structure in the Non-Juridical Sections of Codex Hammurabi, Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 15, Philadelphie, 1994, xiii + 108 : étude des parties dites littéraires du CH. L'a. conteste la division tripartite traditionnelle du Code en prologue/corps de lois/épilogue, et les dénominations mêmes de “prologue" et “épilogue". L'analyse stylistique de ces deux éléments révèle une structure en chiasme et souligne que l'œuvre, qui appartient au genre des inscriptions royales, a été composée par le roi en exécution d'un ordre divin. La comparaison des diverses versions du CH et des textes littéraires contemporains du Code (hymnes et inscriptions royaux, noms d'années) permet de reconstituer l'histoire de sa composition et de montrer son principal objectif: inscrire le règne de Hammurabi dans les mémoires.
J - C. JANSSEN, “Samsu-iluna and the Hungry nadîtums", NAPR 5, 1991, p. 3-40: éd. d'un rescrit de Samsu-iluna, copié en 4 exemplaires et réglant deux points obscurs de droit concernant les religieuses du temple de Šamaš à Sippar: leur entrée dans le cloître est subordonnée à l'existence d'un patrimoine; elles échappent alors aux créanciers de leur père, de même qu'à l'ilkum si un bien grevé de ce service leur est attribué. - EADEM, “Inanna-mansum et ses fils: relation d'une succession turbulente dans les archives d'Ur-Utu", RA 86/1, 1992, p. 19-52: éd. de deux lettres des archives d'Ur-Utu rapportant un conflit successoral qui dura sept ans. Le défunt, Inanna-mansum, avait gratifié son fils Ur-Utu d'un avancement d'hoirie et menacé ses autres enfants d'exhérédation. Le partage eut lieu cependant après la mort du père, mais les frères, sans doute défavorisés, pillèrent deux fois l'une des maisons revenant à Ur-Utu, lequel saisit alors la justice. - F. JOANNÈS, “La culture matérielle à Mari (V): les parfums", MARI 7, 1993, p. 251-270: étude des nombreuses attestations de fabrication et d'utilisation du parfum dans la documentation mariote. Ces textes permettent de déterminer quels produits aromatiques étaient employés (cyprès, cèdre, myrte et genévrier), éclairent les techniques de macération et de distillation, et les divers usages des parfums (toilette, banquets, cérémonies religieuses, cadeaux). - IDEM, “L'eau et la glace", in: Gs Birot, p. 137-151: étude de 8 tablettes améliorant nos informations sur l'alimentation des habitants du Moyen-Euphrate: le captage de l'eau est destiné aux besoins alimentaires mais aussi à l'irrigation; utilisation, modes de conservation et de transport du šurîpum, “neige/glace", ramassée en montagne ou recueillie lors des chutes de grêle.
K - G. KALLA, article “Nachlass B/ Altbabylonisch", RlA 9, 1998, p. 36-42: sur les diverses coutumes successorales, la typologie des documents de partage (inventaire des part, clauses du partage, dispositions particulières, clause de non-revendication, témoins, date) et le contenu des patrimoines successoraux (maisons et terrains, champs et vergers, prébendes, esclaves, meubles et ustensiles, animaux, moyens de transport, argent et denrées). - S. KOSHURNIKOV, "Prices and Types of Constructed City Lots in the Old Babylonian Period", RAI 40, p. 257-260: l'a. établit une échelle des prix de vente foncière dans les contrats de Dilbat. Les terrains bâtis se vendent entre 10 et 30 sicles d'argent le sar; les maisons en ruine tournent autour de 2 à 4 sicles par sar; les terrains non construits coûtent 1 sicle le sar. - N. V. KOZYREVA, "Sellers and Buyers of Urban Real Estate in South Mesopotamia at the Beginning of the 2nd Millenium BC", in: Urbanization, p. 353-362: la grande majorité des ventes foncières du sud babylonien au début de l'époque paléo-babylonienne concerne un cercle restreint d'individus, principalement des nouveaux arrivants, rattachés au personnel du temple. - J. -R. KUPPER, “Le bois à Mari", BSA VI, 1992, p. 163-170: typologie des espèces d'arbres attestées à Mari et de leurs emplois (mobilier, architecture, plus rarement armement).
L - B. LAFONT, “Un homme d'affaires à Karkemiš", in: Fs Garelli, p. 275-286: éd. complète de 3 tablettes documentant la personnalité et les activités commerciales de Sidqum-Lanasi, “homme de Karkemiš" et non pas Mariote, peut-être grand vizir (sukkal) du roi Aplahanda et fournisseur du palais de Mari, auquel il livre des céréales, du bois, des moutons et du vin. - IDEM, "Nuit dramatique à Mari", in: Fs Fleury, p. 93-105: à partir de l'éd. d'une lettre d'un gouverneur de Mari relatant l'effondrement nocturne de la digue d'un canal, l'a. tente de restituer une cartographie des canaux mariotes, montrant leur utilisation pour l'irrigation et la navigation. De nouvelles hypothèses sont en outre présentées sur la valeur des unités de longueur à Mari. - IDEM, "Messagers et ambassadeurs dans les Archives de Mari", RAI 38, p. 167-183: à propos des mâr šiprim, messagers et ambassadeurs. Les sources de Mari permettent de reconstituer le déroulement des audiences, soulignent l'importance de l'étiquette, du protocole et des festivités officielles, et illustrent le caractère itinérant de la diplomatie. L'ambassade têhîtum est celle qui "s'approche" du palais pour être reçue, tandis que la mission êtiqtum est en transit. L'âlik idim n'est pas un simple "escorteur" mais un "accompagnateur" témoignant de la véracité des informations rapportées par les diplomates à leur retour de mission. - IDEM, "Irrigation Agriculture in Mari", in: Rainfall, p. 129-145: présentation du milieu naturel, des sols et des moyens de contrôle de l'eau, des techniques d'irrigation, des formes d'exploitation agricole et des types de production. Il ressort de ce tableau que le rendement des sols ne suffit pas à nourrir toute la population, constamment menacée de pénurie, d'où la surveillance étroite et l'entretien des réseaux d'irrigation d'une part et les importations de denrées d'autre part. - IDEM, “Le fonctionnement de la poste et le métier de facteur d'après les textes de Mari", in: Fs Astour, p. 315-334: il y a des porteurs de tablettes professionnels et occasionnels. L'essentiel de la correspondance étant officielle, la transmission du courrier se faisait à travers les structures administratives, par un système de relais postaux. L'a. étudie le métier de facteur (rémunération, conditions de travail) et les pratiques de réception et d'ouverture du courrier au palais, à divers moments de la journée. - S. LAFONT, "Le roi, le juge et l'étranger à Mari et dans la Bible", in: Traditions amorrites, p. 161-181: réflexions sur trois institutions documentées avec beaucoup de similitudes dans les sources de Mari et dans la Bible. La royauté bédouine repose sur le sacre et la justice, et est symbolisée par l'âne. La figure du juge permet de distinguer ceux qui exercent cette fonction par tradition, par fonction ou par profession. La notion d'étranger enfin est difficile à définir, les statuts personnels changeant selon que l'on est étranger de l'intérieur ou de l'extérieur, de passage ou installé, privilégié ou non. - EADEM, “Un ‘cas royal' à l'époque de Mari", RA 91, 1997, p. 109-119: la publication d'une lettre inédite de Mari, dans laquelle un bédouin réclame la peine de mort contre son esclave fugitif, est l'occasion de faire le point d'une part sur les droits dont dispose le maître sur son serviteur, et d'autre part sur la compétence exclusive du roi paléo-babylonien pour prononcer la peine capitale. - W. F. LEEMANS, compte rendu de F.R. Kraus, Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit, 1984, JESHO 34/1, 1991, p.116-122: le recenseur propose une nouvelle interprétation de AS 19: le soldat ou le pêcheur qui a pris en métayage un champ à défricher pour trois ans peut rester sur la terre à l'expiration du bail s'il paye la quote-part normale d'un métayage. - B. LION, “ARM XXVII, 2: trace d'une andurârum au début du règne de Zimri-Lim?", NABU 1993/111: la plainte adressée par Ilušu-nasir à Zimri-Lim à propos d'un retrait lignager exercé pendant son absence sur la maison mariote qu'il avait acquise, renvoie sûrement à l'application d'une andurârum proclamée au début du règne de ZL. Le bien acheté à très bas prix à une famille endettée serait ainsi rendu à son propriétaire. - EADEM, "Les enfants des familles déportées de Mésopotamie du nord à Mari en ZL 11'", in: Enfance, p. 109-118: les listes inventoriant les populations déportées à la suite de deux campagnes de Zimrî-Lîm dans le nord de la Mésopotamie montrent que les bébés et les petits enfants ne sont pas identifiés mais seulement comptés, ne représentant pas une force de travail utile. L'a. évalue la place quantitative qu'occupent les enfants parmi les déportés, environ un tiers du total. - EADEM, “Andurârum de printemps à Mari ou à Burundum?", NABU 1997/116: une nouvelle mention d'andurârum se trouve dans M.8161, publiée par P. Marello dans MARI 8, 1997, p. 455 459. Si cette andurârum a été décrétée dans le royaume de Burundum (Haut Tigre), cela montrerait l'étendue de cette pratique. - EADEM, “Reniement d'adoption dans le royaume de Hana: RBC 779:6'", NABU 1998/28: la clause pénale de ce contrat d'adoption prévoit que, si l'adopté renie ses parents, on lui versera de l'asphalte sur la tête et on le vendra comme esclave (l. 6': a+na kù-babbar in-na-an-sum, plutôt que 1 gun kù-babbar in-na-an-sum, “il payera un talent d'argent" comme l'a lu A. Podany). - EADEM, "Dame Inanna-ama-mu, scribe à Sippar", RA 95, 2001, p. 7-32: étude des activités d'une femme-scribe de Sippar, auteur de 19 tablettes juridiques concernant des religieuses-nadîtum du temple de Šamaš. - EADEM, "Nadîtum de Šamaš et nadîtum de Marduk face aux dettes paternelles", NABU 2001/43: en dépit du prestige de leur fonction ou de leur condition de femme mariée, les nadîtums de Marduk n'ont pas bénéficié du rescrit de Samsu-iluna en faveur des nadîtums de Šamaš L'affaire du divorce de Geme-Asalluhi (cf. M. Jursa, RA 91, 1997, p. 135-145) en apporte une preuve. – EADEM, "Divorces du nord et du sud", NABU 2001/97: le contraste entre pratiques du nord et du sud en matière de divorce, souligné par R. Westbrook (OBML p. 83-84) est confirmé par 2 nouveaux textes. SAOC 44 (Nippur) prévoit que la femme qui divorce sera vendue comme esclave; BM 16764 (Sippar), un jugement rendu par des juges de Larsa en faveur d'une nadîtum (sans doute originaire de Larsa elle aussi) qui demande et obtient le divorce et la restitution de sa dot. - B. LION et C. MICHEL, “Criquets et autres insectes à Mari", MARI 8, 1997, p. 707-724: étude du corpus des textes de Mari relatifs aux invasions de criquets, pour dater ces phénomènes et les situer géographiquement. Pour lutter contre ces dévastations, les autorités procédaient au remplissage des canaux ou à la destruction des insectes par la population mobilisée pour la circonstance. Préventivement, on pouvait aussi accélérer les récoltes. Enfin, ces insectes étaient cuisinés dans diverses préparations, et utilisés notamment à la cour royale. L'étude se conclut par une présentation des autres insectes attestés dans la documentation de Mari. - H. LIMET, “Contrats de travail à l'époque paléo-babylonienne", RHD 75, 1997, p. 357-375: analyse des conditions générales du louage des personnes, et des deux types de baux ruraux les plus courants, le bail à ferme et le métayage. - M. LIVERANI, “'Half-Nomads' on the Middle Euphrates and the Concept of Dimorphic Society", AOF 24/1, 1997, p. 44-48: l'a. fait l'historique du concept ethnologique de “dimorphisme" emprunté à Mauss et appliqué à l'assyriologie pour désigner en général abusivement l'état intermédiaire entre nomades et sédentaires, résumé dans l'expression “semi-nomades". L'assyriologie introduit un élément évolutionniste (stade transitoire entre deux styles de vie) là où le structuralisme décrivait la double morphologie d'une société, rassemblée ou dispersée selon les saisons. - O. LORETZ, "Mari-Amurriter und Israeliten ohne die amurritischen Traditionen Ugarits", UF 31, 1999, p. 323-332: recension de la table ronde sur "Les traditions amorrites et la Bible". Le recenseur regrette d'une manière générale que les contributions aient omis les liens entre l'héritage amorrite à Ugarit et la Bible, et développe en particulier ses commentaires autour de la contribution d'E. Otto, s'opposant à son hypothèse selon laquelle les dispositions du Deutéronome ont pour origine les serments de loyauté néo-assyriens (cf Otto). - M. LUCIANI, “Some Hypotheses on Text ARMT XXIII 69", NABU 1997/25: cette tablette incomplète recenserait le rendement de champs de la région de Dûr Yahdun Lîm et non pas du district de Saggarâtum.
M - A. MALAMAT, "The Cultural Impact of the West (Syria-Palestine) on Mesopotamia in the Old Babylonian Period", AOF 24/2, 1997, p. 310-319: l'a. examine l'influence de la culture ouest-sémitique sur le monde mésopotamien à travers l'exemples des relations diplomatiques, concrétisées par des mariages ou des voyages “éducatifs" des princes dans les cours étrangères. Il analyse également la diffusion du mythe du combat entre l'orage et la mer, le phénomène du prophétisme, et la trace amorrite subsistant dans le récit du combat de Gilgameš contre Huwawa. - M. MALUL, “On Nails and Pins in Old Babylonian Legal Praxis", ASJ 13, 1991, p. 237-248: l'aiguille, si/ullûm, fixée dans un mur symbolise un transfert de droits complet sur le bien ainsi désigné. Il matérialise donc une donation. - G. MAUER, "Vergangenheits- und Rechtsbewältigung in der altbabylonischen Zeit", ArOr 60/4, 1992, p. 339-346: sur la notion de passé dans les lois et la syntaxe juridique. L'a. compare la littérature ominale et les LE, qui ont en commun de consigner des observation naturelles ou juridiques du passé en les généralisant. Le but de tels recueils est d'entériner une vérité objective. Au contraire, le CH est un corpus étatique, uniforme, qui synthétise le droit commun par son vocabulaire et son style. - IDEM, “Regelungen zur Landvergabe unter Hammurapi", RIDA 40, 1993, p. 57-75: étude des dispositions du CH et de la correspondance administrative de Šamaš-hasir et Sîn-iddinam consacrées aux concessions de terres. L'a. distingue deux catégories: 1/ les terres rémunérant un service pour le palais et pouvant être louées en fermage (a-šà šuku, champs alimentaire; sibtum, champs gevé d'une obligation) et les champs à redevance (a-šà gú-un), sans fermage et concédés par le roi comme personne privée. - C. MICHEL, “Le commerce dans les textes de Mari", Amurru 1, p. 385-426: synthèse sur le commerce élaborée à partir des textes de Mari actuellement publiés, qui décrit les divers produits commercialisés, l’acheminement de ces denrées et tente de cerner le statut du marchand qui semble agir de façon indépendante vis-à-vis du Palais.
O - J. OELSNER, “Zweisprachige Gesetze Hammurabis oder sumerische Fluchformeln?", NABU 1993/70: à propos de la tablette CBS 1511 publiée par A. Sjöberg (Aula Orientalis 9, p. 219ss) contenant une version sumérienne d'un extrait de l'épilogue du CH. Contrairement à l'éditeur du texte, l'a. considère qu'il s'agit non pas d'une traduction de l'akkadien en sumérien, mais de l'original sumérien qui a servi de source d'inspiration aux formules de malédiction du CH. - H. OLIVIER, “Restitution as Economic Redress: the Fine Print of the Old Babylonian mîšarum Edict of Ammisaduqa", JNSL 24/1, 1998, p. 83-99: l'a. propose une traduction (sans transcription) de l'édit d'Ammisaduqa et un commentaire sur la pratique de la mîšarum paléo-babylonienne qui témoignent d'une vision incomplète de la documentation sur ce thème. S'il est évident que les édits royaux n'avaient pas pour vocation de changer le système économique mais de l'alléger temporairement (p. 97), on ne saurait ignorer que ces actes étaient invoqués dans la pratique pour récupérer un bien familial aliéné à cause d'une pression économique trop forte. L'a. semble croire que ces mesures ne profitaient qu'aux tenanciers de l'Etat, réputé être seul propriétaire de la terre (p.95-96). L'interprétation de la mîšarum comme moyen d'affermir la position idéologique et fiscale du palais auprès des producteurs de denrées (p. 95) relève d'une position plus dogmatique que scientifique. - E. OTTO, "Der reduzierte Brautpreis. Ehe- und Zinsrecht in den Paragraphen 18 und 18a des Kodex Esnunna", ZSSRA 109, 1992, p. 475: le § 17 LE (tabl. A ii 2-5) envisage la restitution complète de la dot en cas de mort de l'un des époux avant la conclusion du mariage, tandis que le § 18 (tabl. B i 13-18 + tabl. A ii 6-7) prévoit le versement à l'épouse survivante d'une somme (watrum, "surplus") calculée d'après la durée de l'union matrimoniale, abstraction faite de la dot dont il n'est pas question dans cette disposition. - D. OWEN et R. WESTBROOK, “Tie Her Up and Throw her into the River! An Old Babylonian Inchoate Marriage on the Rocks", ZA 82/2, 1992, p. 202-207: éd. complète d'une tablette datée de la 15e année de Hammurabi et concernant la rupture d'un mariage inchoatif. Le document, très elliptique, expose la réponse du beau-père à une revendication implicite du fiancé sur une maison, qu'il aurait apportée comme terhatum. Le serment du défendeur écarte cette prétention. Maintenant son refus du mariage, le fiancé demanderait que la jeune fille soit noyée, peut-être à cause de l'inconduite dont il la soupçonne, et espérant obtenir une rançon rachetant la mort de l'intéressée.
P - L. PECHA, "Die igisûm-Abgabe in den altbabylonischen Quellen", ArOr 69/1, 2001, p. 1-20: les nombreuses attestations de la taxe-igisûm dans les lettres et les textes administratifs du sud mésopotamien, montrent qu'elle était payée en argent une fois par an par certains membres du personnel du temple, des officiers locaux (šakkanakkum, šâpirum) et peut-être aussi des marchands. L'argent était collecté dans des centres provinciaux, (e.g. Sippar), d'où il était acheminé vers la capitale et utilisé au profit des services de l'administration centrale. - H. PETSCHOW, “Aussereheliche Lebensgemeinschaften? YOS 8, 141; §§ 27, 28 CE; 161 CH", NABU 1990/118: le concubinage est illustré par YOS 8, 141, un acte de donation daté de Rîm-Sîn, qui illustre la règle théorique formulée par LE 27 et CH 128: le donateur gratifie sa compagne pour compenser la déchéance successorale de la femme, qui a fui le domicile familial pour habiter, contre l'avis de son père, avec l'homme qu'elle voulait épouser. Les deux partenaires vivent ainsi en concubinage et non pas maritalement. Ce document se rapproche aussi, par sa formulation, du § 161 CH. Ainsi peut-on constater l'unité de la réglementation en matière d'union libre à Ešnunna, Larsa et Babylone. - A. PODANY, “Some Shared Traditions between Hana and the Kassites", in: Fs Astour, p. 417-432: la comparaison du formulaire des concessions foncières kassites (kudurru) et des contrats de vente de Terqa paléo-babylonienne montre que les rois médio- et néo-babyloniens ont emprunté la terminologie des actes de Terqa pour décrire les parcelles octroyées par les kudurru. La pratique des gratifications royales sous forme de terres accordées à des dignitaires de la cour est également bien attestée dans la région de Terqa. - J. N. POSTGATE, “Archaeology and the Texts. Bridging the Gap", ZA 80/2, 1990, p. 228-240: à propos de E. Stone, Nippur Neighborhoods, 1987. Le recenseur s'attache surtout aux problèmes d'interprétation des données archéologiques et historiques quant aux pratiques funéraires, à l'usage domestique des pièces d'une maison et aux correspondances possibles entre les groupes sociaux et les quartiers de Nippur.
R - J. RENGER, “Formen des Zugangs zu den lebensnotwendigen Gütern: die Austauschverhältnisse in der altbabylonischen Zeit", AOF 20/1, 1993, p. 87-114: l'a. s'interroge sur l'existence d'une économie de marché à l'époque paléo-babylonienne, et donne une réponse négative fondée sur les témoignages des quelque 600 lettres documentant cette question. - IDEM, “Zu den Besitzverhältnissen am Ackerland im altbabylonischen Uruk. Bemerkungen zu den Texten aus dem ‘Archiv' W 20038, 1-59", AOF 22/1, 1995, p. 157-159: les “textes de champ" paléo-babyloniens du palais de la dynastie Sînkâšid à Uruk (publiés dans BagM 18) constituent une archive administrative palatiale. Le roi attribue au personnel du palais ou du temple des parcelles de terres prélevées sur le domaine qu'il gère. La taille parfois très élevée des superficies est à mettre en rapport avec les proportions importantes du site lui-même. Comme à Larsa, le palais d'Uruk détient la grande majorité des terres cultivables, la propriété privée jouant un rôle très réduit dans l'économie. - IDEM, "Royal Edicts of the Old Babylonian Period – Structural Background", in: Debt, p. 139-162: les décrets royaux de la période paléo-babylonienne répondent à des objectifs différents. A Isin (Išme-Dagan), il s'agit d'exempter les habitants de Nippur et d'Isin de la corvée et du service au temple, dans la perspective d'une transition de l'économie domestique héritée de l'empire néo-sumérien vers un système plus "privatisé". Les décrets de Larsa interviennent plus tardivement, (à partir de Rîm-Sîn), peut-être en raison de la persistance du modèle économique d'Ur III dans cette région. Le fait que les décrets de Larsa concernent seulement les maisons et les vergers confirme la tendance observée dans les contrats de vente, où la rareté des transactions portant sur les champs est remarquable. - IDEM, “Noch einmal: Was war der ‘Kodex' Hammurapi - ein erlassenes Gesetz oder ein Rechtsbuch?", in H. -J. Gehrke (éd.), Rechtskodifizierung und soziale Normen im interkulturellen Vergleich, ScriptOralia 66, Reihe A: Altertumswissenschaftliche Reihe Bd 15, s.d., p. 27-58: après avoir fait un point bibliographique sur la question controversée de la valeur normative du Code de Hammurabi, l'a. conclut que l'œuvre a un but commémoratif et non pas législatif, et qu'elle s'enracine dans le milieu intellectuel des scribes. L'ignorance de la date de promulgation du Code signifie peut-être qu'il s'agit d'une publication posthume. - J. F. ROBERTSON, “The Temple Economy of Old Babylonian Nippur: the Evidence for centralized Management", RAI 35, p. 177-188: la gestion centralisée du système de redistribution des ressources entre les différents temples de Nippur, relevée par M. Sigrist, trouve confirmation et illustration dans un lot d'environ 500 tablettes administratives et économiques de cette ville, présentées et brièvement commentées par l'a. - E. ROBSON, "The Tablet House: A Scribal School in Old Babylonian Nippur", RA 95, 2001, p. 39-67: étude sur la formation des scribes à partir des 1400 tablettes retrouvées dans la maison F de Nippur, permettant de confronter les informations tirées de la littérature scolaire sumérienne avec la réalité archéologique et épigraphique. Il en ressort que l'enseignement est dispensé dans un espace assez réduit, aux proportions domestiques. L'absence d'un vaste corpus scribal s'explique par le recyclage sur place des tablettes. Il n'y a pas de cursus homogène entre toutes les écoles de Nippur mais plutôt un fonds commun et composite dans lequel puisaient les enseignants selon leurs préférences pédagogiques, le sumérien en ce qui concerne la maison F. - M. ROTH, "The Priestess and the Tavern: LH § 110", in: Fs Renger, p. 445-464: le § 110 CH punit un délit économique et non pas une atteinte aux mœurs (prostitution d'une religieuse). La nadîtum ou l'ugbabtum non cloîtrées qui ouvrent une taverne ou y entrent pour y prêter de la bière (ou du grain) à intérêt sont passibles de la peine du bûcher, car elles portent atteinte au monopole de la cabaretière pour les débits de boisson, et du tamkarum pour les activités bancaires (prêts à court terme). - O. ROUAULT, “Cultures locales et influences extérieures: le cas de Terqa", SMEA 30, 1992, p. 247-256: étude des diverses traditions (mariote, hanéenne, babylonienne, mitanienne) dont l'influence se fait sentir dans les sources juridiques de la ville: contrats de mariage, concessions de terres prises sur le domaine royal et servant de base à la fortune des grandes familles locales, procès. L'a. reconstitue la généalogie des rois de Hana d'après cette documentation, qui illustre également la vile sociale et politique (e.g. l'association au trône à l'époque de la domination mitanienne) de Terqa.
S - J. SASSON, "Oath-taking formulae", NABU 1992/21: restitution du serment destiné à être prêté par Hammurabi de Babylone, et dont les brouillons ont été édités par J.-M. Durand dans Fs Stève. - H. SAUREN et V. DONBAZ, "Ni 2553+2565, a missing link of the Hammurabi Law-Code", OLP 22, 1991, p. 1-26: éd. d'une tablette fragmentaire dupliquant plusieurs passages du CH, et apportant des parallèles aux dispositions des LE. Les omissions constatées sur le document prouvent l'existence d'une autre stèle, en plus de celle du Louvre, portant une version lacunaire du Code. Ainsi s'expliquent les nombreuses variantes dans les copies du CH. D'autre part, la tablette améliore la compréhension du § F du code, qui protège le muskenum dans l'exercice de ses fonctions de collecteur de taxes: il peut vendre au locataire (wasbum) une maison pour le compte du propriétaire (awîlum), sauf si ce dernier est à l'étranger. - M. SAUVAGE, “Le contexte archéologique et la fin des archives à Khirbet ed-Diniyé - Harâdum", RA 89, 1995, p. 41-55: étude du contexte archéologique de la trouvaille épigraphique faite sur le site de l'ancienne Harâdum. Il permet de comprendre comment s'opérait le choix de ce que l'on souhaitait archiver, les conditions de stockage des documents dans les différentes maisons et ce qui s'est passé lors du soudain abandon de ces dernières. - A. SKAIST, “Pre- and Post-Hammurapi Loan Contracts from Nippur", RAI 35, p. 227-233: la conquête du sud mésopotamien par Hammurabi en 1763 a eu une incidence sur les formulaires des contrat de prêt de Nippur: les clauses concernant le paiement des intérêts et le remboursement apparaissent, sous l'influence d'une décision royale. - IDEM, The Old Babylonian Loan Contract. Its History and Geography, Bar-Ilan, 1994, 292 p., index, bibliogr.: typologie des diverses sortes de contrat de prêt paléo-babyloniens, présentés d'après leur répartition géographique et leur contenu. La répartition géographique des différentes catégories de prêts, d'après leur formulation, et leur échelonnement chronologique ne permettent pas de brosser un tableau homogène du prêt paléo-babylonien. Les variations ou les changements observés d'une région et d'une époque à l'autre ne sont pas expliqués. - M. STOL, “Eine Prozessurkunde über ‘falsches Zeugnis'", in: Fs Garelli, p. 333-339: éd. d'un texte de Sippar relatant un procès en diffamation, où les femmes témoins convaincues de faux témoignage sont marquées sur la joue et humiliées par l'arrachement du voile couvrant leur tête. L'a. rapproche cette tablette des sources légales sur ce thème et sur celui du mensonge, sarrâtum (§§ 28 CUN, 33 LE, 3-4 CH). - IDEM, "Old Babylonian Personal Names", SEL 8, 1991, p. 191-212: analyse des noms sumériens, des noms théophores et du lien entre le statut personnel et le nom. - IDEM, “The Care of the Elderly on Mesopotamia in the Old Babylonian Period", in: Care of the Elderly, p. 59-117: après une étude terminologique et quantitative de l'obligation alimentaire, l'a. présente de nombreux textes attestant le devoir d'entretien des enfants envers leurs parents ou beaux-parents, du mari envers sa femme ou de l'esclave envers son maître (paramone). Le cas de l'entretien de la nadîtum est examiné en détails, sans doute parce que son entretien dépend, comme pour les personnes âgées, des dispositions prises par son entourage. - IDEM, “Die Übernahme eines Nachlasses", AOF 24/1, 1997, p. 68-74: à propos de la lettre PBS 7, 55, dont le contenu doit être examiné à la lumière du contexte général fourni par deux autres documents concernant le même genre d'affaire. En CT 45, 25, le patrimoine d'une religieuse-qadištum prédécédée est attribué à ses deux frères. En OLA 21, n° 65, l'un d'eux a reçu la part successorale de sa mère, en échange de son entretien, et la vend cinq ans après à sa nièce, nadîtum de Šamaš, qui s'engage à entretenir sa grand-mère. Dans la lettre PBS 7, 55: 1-16 (AbB 11 55), un litige survient entre deux ayants droit d'une femme sans doute décédée, ayant racheté successivement la part de la défunte. Dans le contexte de Sippar, le verbe nabalkutum signifierait non pas “rompre une convention", mais “transmettre (un droit et/ou une obligation) à un autre". - IDEM, “Old Babylonian Corvée (tupšikkum)", in: Fs Houwink ten Cate, p. 293-309: recherche sur le lien entre la corvée-tupšikkum et des notions proches: 1/ le service-ilkum, à partir notamment de CT48 64, un texte de Babylone trouvé à Sippar, où la corvée semble décrite comme étant, au moins en partie, “l'ilkum du roi"; 2/ les louages de personnes, effectuant la corvée à la place du titulaire de l'obligation, et attestant une durée d'un mois; 3/ le harran šarrim, “service militaire", durant aussi un mois; 4/ les contrats d'engagement pour la moisson. - E. STONE, "Houses, Households and Neighbourhoods in the Old Babylonian Period: the Role of Extended Families", RAI 40, p. 229-236: reconstitution des structures et des relations familiales à partir du modèle pré-islamique d'Alep. Les systèmes paléo-babylonien et ottoman présentent des similitudes quant à l'organisation de l'habitat familial urbain, divisé en 2 catégories: les petites maisons accueillent des familles nucléaires; les grandes demeures abritent des familles élargies. - E. STONE et D. OWEN, Adoption in Old Babylonian Nippur and the Archive of Mannum-mesu-lissur, Mesopotamian Civilizations 3, Winona Lake, 1991, vii +149 p.: étude de l'adoption d'après 53 textes de Nippur présentés en éd. complète. L'aspect économique est prédominant dans les sources, comme le montrent les cas d'Ur-Pabilsag et de Mannum-mesu-lissur. Le premier est guidé par l'ambition et profite de la rare descendance d'adoptants riches pour réaliser ses projets. Le second monnaye son soutien financier à une famille en difficulté pour augmenter son patrimoine, notamment par l'obtention de prébendes.
T - M. TANRET et C. JANSSEN, "ana qabê. Qui remplace qui?", NABU 1992/85: l'étude des baux à ferme et des actes d'emprunt dans les archives d'Ur-Utu montre que l'expression ana qabê signifie "remplacé par" et non pas "représenté par". - S. TINNEY, "On the curricular Setting of Sumerian Literature", Iraq 41, 1999, p. 159-172: l'a. complète les recherches actuelles sur la formation des scribes de Nippur au début de l'époque paléo-babylonienne, montrant que l'apprentissage de la littérature sumérienne inclut plusieurs compositions absentes des catalogues scolaires. - W. TYBOROWSKI, "Šêp-Sîn, a private businessman of the Old Babylonian Larsa", WO 33, 2003, p. 68-88: les activités de Šêp-Sîn l'homme d'affaires montrent qu'il est impliqué dans plusieurs entreprises commerciales et qu'il consent des prêts. Les lettres de ses archives illustrent le fonctionnement d'une firme commerciale dans la Babylonie du XVIIIe s.
V - M. VAN DE MIEROOP, “Reed in the Old Babylonian Texts from Ur", BSA VI, 1992, p. 147-162: sur la coupe des roseaux à Ur. Les groupes de travailleurs, au nombre et au nom indéterminés, étaient encadrés par deux catégories d'officiers, les nu-banda et les ugula, rendant eux-mêmes des comptes au temple de Nanna. - IDEM, “Wood in the Old Babylonian texts from southern Babylonia", BSA VI, 1992, p. 155-162: étude typologique des diverses sortes de bois attestées et de leurs usages. - IDEM, "Credit as a Facilitator of Exchange in Old Babylonian Mesopotamia", in: Debt, p. 163-173: de nombreux contrats ayant formellement l'aspect d'un prêt et conclus dans un cadre institutionnel sont en réalité des transactions à crédit, par lesquelles les surplus de production du palais ou du temple sont confiés à des marchands, qui s'engagent à reverser à terme l'équivalent en argent. Le même schéma s'applique aux tenanciers royaux, dont les arriérés envers le palais sont parfois payés par un marchand, lui-même débiteur du palais; l'annulation de la dette du tenancier par une mîsarum dispense le marchand du paiement de sa propre dette envers le palais (§ 11 édit d'Ammi-Saduqa). Entre particuliers, le formulaire du prêt permet aussi de réaliser des ventes à crédit de denrées et d'objets manufacturés. - IDEM, Society and Enterprise in Old Babylonian Ur, BBVO 12, Berlin, 1992, xviii + 328: l'exploitation des archives publiques et privées d'Ur fournit l'image d'une cité florissante aux XIXe-XVIIIe s., aux ressources économiques multiples (agriculture, pêche, élevage, mais surtout commerce). Le système essentiellement étatique à l'époque d'Ur III évolue à partir de l'époque d'Isin-Larsa, où se développe le rôle des particuliers dotés de prébendes héréditaires, et des entrepreneurs privés chargés de superviser l'exploitation des biens du temple. L'activité de ces hommes d'affaires grandit sous les règnes de Rîm-Sîn et de Hammurabi de Babylone, pour s'étendre à l'ensemble de la vie économique locale. Le transfert des compétences administratives d'Ur vers Larsa, à l'époque de Rîm-Sîn, puis la centralisation hammurabienne ont provoqué le lent déclin économique du sud mésopotamien. - IDEM, “Old Babylonian Interest Rates: Where they Annual?", in: Fs Lipinski, p. 357-364: contre les conclusions de W. Leemans, l'a. soutient que les taux d'intérêt paléo-babyloniens n'étaient pas annuels. Si le droit positif se borne à énoncer les taux (20% pour l'argent, 33 1/3% pour l'orge), les contrats spécifient eux le délai de remboursement, toujours inférieur à un an, souvent un mois voire quelques jours. Du coup, les prêteurs apparaissent comme de véritables usuriers, faisant payer très cher le risque représenté par les édits de mîšarum. - F. VAN KOPPEN, “Abum-waqar Overseer of the Merchants at Sippar", NABU 1999/80: Abum-waqar, chef des marchands, mentionné dans le procès en restitution de dot édité par M. Jursa (cf. supra), est bien connu dans les textes de Sippar. Sa présence dans ce litige intervenu à Larsa indique qu'un groupe de réfugiés de Larsa s'est installé à Sippar au début du règne d'Abi-ešuh, et perpétue ses institutions locales à travers des juges et un temple de Šamaš. - IDEM, "The Organisation of Institutional Agriculture in Mari", JESHO 44/4, 2001, p. 451-504: l'utilisation des terres domaniales par le palais dépendait des moyens de production et de considérations politiques. L'administration centrale fournissait les ressources et la main d'œuvre supplémentaire; les équipes travaillant avec les charrues étaient dirigées par les cultivateurs (ikkarum), et devaient produire une récolte dont la quantité était fixée par le palais. Etant employé par plusieurs propriétaires fonciers à la fois, l'ikkarum pouvait investir ses propres fonds privés et ceux de l'Etat dans cette activité lucrative. Cette marge d'initiative privée permettait d'assouplir l'organisation centralisée de la production agricole à Mari. - K. VEENHOF, “Two šilip-rêmim Adoptions from Sippar", in: Fs De Meyer, p. 143-157: étude de deux nouvelles tablettes d'adoption pour des enfants “extraits de l'utérus", venant s'ajouter aux 4 textes de cette catégorie déjà connus. Quelle que soit la signification de cette désignation, encore débattue, elle se rapporte à un enfant qui a perdu sa mère, soit en couches, soit parce qu'il a été confié à l'extérieur. - IDEM, "The Relation between Royal Decrees and ‘Law Codes' of the Old Babylonian Period", JEOL 35-36, 1997-2000, p. 49-83: étude sur les liens entre les deux catégories de décrets royaux (décrets de mîšarum, annulant rétroactivement les dettes non commerciales et les ventes d'immeubles familiaux; simdat šarrim, réglant des aspects particuliers du droit, notamment sous la forme de rescrits, semblables à celui de Samsu-iluna à propos des “hungry nadîtums") et les codes de lois, pour déterminer si – et dans l'affirmative jusqu'où – les seconds s'inspirent du contenu des premiers. Les références aux actes législatifs dans les lettres, les contrats et les articles des codes sont regroupées en 3 catégories: 1/ les dispositions des décrets absentes des codes; 2/ celles qui recoupent certains paragraphes des codes et ont pu y être incorporées; 3/ les mentions explicites des décrets royaux dans les codes. L'a. en conclut que les codes sont par nature descriptifs, énonçant les principes généraux du droit en vigueur et s'inscrivant dans la tradition du "roi de justice" exprimée notamment à travers les pétitions adressées au souverain; les décrets ont au contraire un objectif plus pratique et donc un impact immédiat dans la vie juridique. Après Hammurabi, la royauté semble avoir privilégié cette seconde technique législative, précisément parce qu'elle permettait une adaptation plus facile et plus rapide du droit aux attentes des justiciables. - P. VILLARD, "Les déplacements des trésors royaux d'après les archives royales de Mari", RAI 38, p. 195-205: au cours de ses voyages, le souverain mariote se déplace avec "le coffre du roi", pour assurer la distribution de cadeaux, et avec des pièces du mobilier précieux du palais, afin de montrer sa richesse et sa puissance à ses sujets et à ses voisins.
W - N. WASSERMAN, “CT 21, 40-42. A Bilingual report of an Oracle with a Royal Hymn of Hammurabi", RA 86/1, 1992, p. 1-18: étude d'une inscription monumentale bilingue, probablement rédigée après la victoire de Hammurabi sur Rim-Sîn de Larsa (Ham. 31), et constituant l'une des sources d'inspiration du prologue du CH, via une tablette à usage scribal interne (AO 10237). - R. WESTBROOK, "The Adoption Laws of Codex Hammurabi", in: Gs Kutscher, p. 195-204: nouvelle interprétation des §§ 185-193 CH, qui concerneraient tous l'adoption d'un enfant abandonné ou perdu, autrement dit une convention unilatérale de l'adoptant. L'a. propose notamment de comprendre le § 191 comme un tempérament au droit de rompre le lien adoptif: l'homme sans enfant qui adopte un fils, puis obtient sa propre descendance, ne peut deshériter totalement l'adopté qu'il renie. - IDEM, “The Old Babylonian Term naptarum", JCS 46, 1994, p. 41-46: dans les sources paléo-babyloniennes, le naptarum est un “visiteur" et le bît naptarim la “maison/quartier des visiteurs", où ils sont logés. Les deux termes sont formés sur patârum, “partir". Ces sens sont confirmés par les listes lexicales (l'équivalence naptarum/susapinnu suggère que le “paranymphe" agit comme un visiteur accompagnant le fiancé chez la fiancée) et les textes juridiques. Le § 41 LE oblige la cabaretière à vendre au cours du moment la bière confiée par un ubarum, “résident", un naptarum, “visiteur" ou un mudûm, “connaissance", tous trois plus exposés aux fraudes de par leur statut d'“étranger." Le § 36 LE retient la responsabilité du naptarum “visiteur" (et non de l'aubergiste) auquel sont confiés des biens qu'il perd par sa propre négligence. - IDEM, "Codex Hammurabi and the Ends of the Earth", RAI 44, p. 101-103: l'a. utilise les travaux de M. Liverani sur l'idéologie royale en matière de conquête territoriale (Prestige and Interest, 1990) pour interpréter la vocation universelle du Code de Hammurabi exprimée dans l'épilogue (xlviii:3-19), contrastant avec les lacunes évidentes de la législation elle-même. De même que le roi héroïque contrôle tous les territoires qu'il a traversés pour atteindre les confins du monde connu, le législateur opère une "codification des extrêmes" (W. Hallo) en délimitant les contours conceptuels d'un sujet. Il délaisse les situations intermédiaires, déduites par extrapolation des extrêmes. - IDEM, "The Old Babylonian Period", in: Security, p. 63-92: la documentation paléo-babylonienne sur les moyens de garantir un prêt, quoique limitée en quantité, est très variée (codes de lois, contrats, édits royaux et lettres privées). Le créancier dispose de plusieurs techniques: gage, sûreté et responsabilité solidaire des co-débiteurs. La saisie personnelle du débiteur (ou d'un membre de sa famille) intervient à défaut d'accord sur l'un des moyens précités. Elle ne constitue pas un mode de paiement de la dette mais un moyen de pression pour obtenir l'exécution de l'obligation. Les autorités publiques interviennent pour limiter les initiatives unilatérales de saisie par le créancier sur les biens du débiteur défaillant, et pour réduire, voire annuler, les garanties de remboursement du créancier. - IDEM, "Hard Times: CT 45 37", in: Fs Veenhof, p. 547-551: le procès CT 45 37 porte sur la vente d'une esclave par une nadîtum de Šamaš 15 ans plus tôt. Le demandeur, neveu de la venderesse, admet que le prix complet a bien été versé, ina maruštim ina mêsirim. Cette clause fait allusion aux difficultés économiques de la venderesse, qui aurait dû céder son esclave sous la contrainte, à un prix inférieur à sa valeur réelle, ouvrant ainsi aux héritiers un droit de rachat. Le procès aboutit à un compromis, la défenderesse refusant de prêter serment mais versant un sicle d'argent au neveu (sur ce texte et cette interprétation, voir déjà D. Charpin, NABU 1999/79 et "Lettres et procès paléo-babyloniens" in: F. Joannès (éd. ), Rendre la justice en Mésopotamie, Saint-Denis, 2000, p. 107-108). - IDEM, "The Case of the Elusive Debtors: CT 4 6a and CT 6 34b", ZA 93/2, 2003, p. 199-207: relecture de deux textes judiciaires appartenant au même dossier, et concernant les démêlés d'un créancier contre ses deux débiteurs. Le premier réclame une indemnisation pour rupture abusive de contrat (fourniture d'un bélier); les seconds tentent d'échapper au paiement par des manœuvres dilatoires, facilitées par l'absence de responsabilité solidaire. Les trois occurrences de l'expression x se kù-babbar mithârsu, “le mithârum de x sicle(s) d'argent", sont comprises en référence à un “montant équivalent" additionnel.
Y - R. YARON, “kurrum sibtam ussab, ‘das Kor wird Zins hinzufügen'. Weiteres zum § 18 A der Gesetze von Ešnunna", ZA 83/2, 1993, p. 206-218: l'a. maintient que le § 18 A, énonçant les taux d'intérêt de l'argent et des céréales, doit être séparé de la disposition précédente (§ 17/18) qui règle le sort de la terhatum en cas de décès de l'un des conjoints. L'argument grammatical opposé par Landsberger et Kraus, selon lequel la racine wsb ne peut avoir qu'un sujet personnel, est démenti par les sources de la Diyala. - IDEM, “Gesetze von Ešnunna 38: Das Versagen der Rechtshistoriker", ZSSRA 111, 1994, p. 403-413: l'a. reprend les diverses traductions du mot qablitum, renvoyant au prix dû par le frère qui exerce son droit de préemption lors de la vente d'un bien familial. La traduction usuelle “moitié (prix)", d'après l'editio princeps de Goetze, pénalise injustement le vendeur c'est pourquoi il faut lui préférer le sens de “prix moyen", déjà retenu par l'a. dans sa seconde édition des LE (Jérusalem, 1988). - N. YOFFEE, "Law Courts and the Mediation of Social Conflict in ancient Mesopotamia", in: J. Richards et M. van Buren (éd. ), Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient States, Cambridge, 2000, p. 46-63: l'a. analyse CT 47 63 comme un exemple de résolution pacifique d'un conflit successoral par le kârum de Sippar autour des biens d'une religieuse nadîtum de cette ville. Plutôt que d'y voir un exemple de médiation supposant un litige, il semble plutôt que l'assemblée ait été saisie d'un recours gracieux pour dresser à la fois un nouvel acte de propriété remplaçant le titre perdu et un double authentique du verdict antérieur, perdu lui aussi. L'autorité de l'institution lui permet de délivrer des actes officiels en matière de propriété et de droits successoraux.
Z - N. ZIEGLER, “Les enfants du palais", in: Enfance, p. 45-57: sur la naissance des enfants royaux, le choix de leur nom, leur éducation par des nourrices en dehors du palais, la mortalité infantile et enfin leur accès au trône à un âge parfois très jeune.
A - P. AKKERMANS, F. ISMAIL, L. SENIOR, M. VAN DE MIEROOP, H. WEISS, "An Administrative Building of Andarig at Šubat-Enlil", NABU 1991/99: les fouilles de Leilan ont permis de dégager un bâtiment public contenant des restes de vaisselle et 590 tablettes administratives, dont 3 sont publiées ici, et concernant des distributions de bière et des reçus de céréales. - K. AL-'ADAMI, “King Apil-Sîn confirms the judgment of Sumulael", Iraq 59, 1997, p. 73-76: éd. de la tablette IM 85928 et de son enveloppe découvertes à Sippar lors de la première saison de fouilles en 1978. Il s'agit d'un document juridique. Nûr-ilišu revendique la propriété d'une maison octroyée par Sumulael. L'affaire est portée devant le roi de Babylone Apîl-Sîn qui maintient la décision de son grand-père. La tablette comporte une liste de témoins et un nom d'année. - F. AL-RAWI et S. DALLEY, Old Babylonian Texts from Private Houses at Abu Habbah Ancient Sippir, É-DUB-BA-A 7, 2000, iv+ 168 p., 64 pl.: copie, trs et trd de 135 tablettes de Sippar, couvrant les règnes d'Immerum jusqu'à Samsu-iluna. La plupart des textes concernent des prêts (hubullu ou hubuttatum principalement) et documentent le commerce avec Ešnunna et Suse (une colonie de marchands de Sippar s'est installée à Suse), ainsi que des liens avec le commerce caravanier assyrien. - M. ANBAR, "La ‘petite tablette' et la ‘grande tablette'", NABU 1991/98: confirme l'existence de préliminaires écrits avant la rédaction d'un traité d'alliance politique, la "petite tablette" servant de modèle contraignant pour l'établissement de la "grande tablette". - IDEM, “La critique biblique à la lumière des Archives royales de Mari", Biblica 75/1, 1994, p. 70-74: le récit de la conquête de la ville de Aï par Josué (Jos. VIII, 1-29) fait mention d'un javelot brandi par Josué vers la cité à conquérir. On retrouve ce motif dans les lettres de Mari, où le geste symbolise un acte de révolte ou d'attaque militaire. La mention du javelot n'est donc pas secondaire; elle fait partie de la version d'origine dans l'épisode biblique. - IDEM, “Une reprise rédactionnelle dans une lettre de Mari (FM II 67)", NABU 1994/85: étude stylistique de FM II 67, où le scribe intercale dans une lettre dictée par l'expéditeur (Yarîm-Hammû) une liste de NP recopiée d'une autre tablette. - IDEM, “Formule d'introduction du discours direct au milieu du discours à Mari et dans la Bible", VT 47, 1997, p. 530-536: à Mari, le discours dans le discours n'est qu'un procédé stylistique utilisé dans un souci de clarté alors que l'Ancien Testament l'utilise aussi comme procédé rédactionnel, pour introduire une pause “dramatique" dans le récit. - IDEM, “Addendum au “Discours direct"", NABU 1997/59: l'a. ajoute un nouvel exemple (ARM II 33) à son étude parue dans VT. - M. ANBAR et M. STOL, “Textes de l'époque babylonienne ancienne III", RA 85/1, 1991, p. 13-48: éd. complète de 23 textes paléo-babyloniens documentant diverses transactions (prêts, achats et ventes, gages), la responsabilité du chef d'équipe pour le gros œuvre, et quelques aspects du droit familial (donation, tutelle, droit aux aliments). - D. ARNAUD, Altbabylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden, BBVO Texte 1, Berlin, 1989, 18 p., 63 pl.: copie de 176 tablettes paléobabyloniennes de Sippar, conservées au Louvre. Le lot se compose de lettres, contrats (ventes et achats de terrains, locations, prêts, partages successoraux), et de documents comptables et administratifs.
B - G. BECKMAN, Catalogue of the Babylonian Collection at Yale 2: Old Babylonian Archival Texts in the Nies Babylonian Collection, YBC 2, 1995: catalogue indiquant le numéro d'inventaire, la date et le contenu des textes administratifs paléo-babyloniens se trouvant dans le collection Nies à Yale. Indication du contenu; publications ou mentions du texte dans d'autre sources, présence de sceaux. Concordance organisée par villes, et à l'intérieur de chaque ville, par date. - J. A. BELMONTE MARÍN, “Old Babylonian Administrative and Legal Texts from the Monserrat Museum", AuOr 15, 997, p. 99-137: trs et trd des 25 tablettes juridiques paléo-babyloniennes de la collection du Musée de Monserrat. Le lot comporte des listes de ration ou de personnes, des reçus de paiement partiel de dette, des pièces comptables, des contrats de prêt, de louage de personne, une pièce de procédure (n°13: administration de la preuve d'un litige foncier devant les armes de Šamaš) et un fragment de procès (n°15: seule la clause de non-revendication et les témoins sont conservés). - M. BIROT, Correspondance des gouverneurs de Qattunân, ARM XXVII, Paris, 1993: éd. de 177 textes concernant les activités des quatre gouverneurs de la province de Qattunân à l'époque de Zimri-Lim. Les tablettes documentent surtout l'administration rurale (élevage, irrigation, invasions de sauterelles, pénuries de main d'œuvre et de grain), plus rarement les questions de religion ou d'ordre public, et enfin les missions hors de la circonscription, notamment celles de Zimri-Addu en Babylonie - à l'occasion de campagnes militaires - et à Karana. Les textes illustrent par ailleurs la place et le rôle du gouverneur dans l'appareil administratif (contrôles par le pouvoir central, rapports avec les merhû qui gèrent les relations avec les Hanéens. - B. BÖCK, "Homo mesopotamicus", in: Fs Renger, p. 53-68: étude des structures grammaticales et de la lexicographie de la série paléo-babylonienne lú (MSL XII), contenant des classifications du genre humain. Le texte contient de nombreux termes péjoratifs et insultants, et s'inspire de la langue orale et populaire, qui serait devenue démodée ou inutile, ce qui expliquerait l'absence de "canonisation" de la série, restée sans postérité littéraire. - W. R. BODINE, "A Model Contract of an Exchange/Sale Transaction", RAI 45, p. 41-54: éd. complète de YBC 8623, un modèle de contrat de vente foncière. Plusieurs éléments indiquent qu'il ne s'agit pas d'une transaction réellement effectuée: l'absence de témoins et de date; le revers totalement anépigraphe; l'absence de sceau. L'occurrence du verbe šám qualifie une vente, mais le prix est payé sous forme d'esclaves, ce qui rappelle plutôt l'échange. L'a. en conclut d'une manière générale que les sources mésopotamiennes, toutes époques confondues, ne distinguaient pas clairement la vente de l'échange. - M. BONECHI, “Conscription à Larsa après la conquête babylonienne", MARI 7, 1993, p. 129-164: éd. complète d'une longue liste de tisserands de Larsa, datée de la prise de cette ville par Hammurabi (Ham. 31). Il s'agit semble-t-il d'une conscription exceptionnelle en vue d'une opération militaire ponctuelle, sans doute la guerre qui opposa le roi de Babylone à Silli-Sîn d'Ešnunna. - IDEM, "Relations amicales syro-palestiniennes: Mari et Hazor au XVIIIe siècle av. J.C.", in: Fs Fleury, p. 9-22: l'éd. complète de 5 tablettes de Mari permet de montrer que Hazor, important centre caravanier, a toujours entretenu avec Mari d'excellentes relations diplomatiques. L'existence de deux villes de Hazor confirme l'hypothèse d'une toponymie en miroir proposée par D. Charpin pour l'époque amorrite. - M. BONECHI et A. CATAGNOTI, “Compléments à la correspondance de Yaqqim-Addu, gouverneur de Saggarâtum", in: Gs Birot, p. 55-82: éd. complète de 24 tablettes enrichissant le dossier de la correspondance de Yaqqim-Addu (ARM XIV), en attendant la synthèse prochaine sur les activités de ce gouverneur. - EIDEM, “Deux nouvelles lettres de Yaqqim-Addu, gouverneur de Saggarâtum", MARI 8, 1997, p. 777-780: éd. de deux textes à ajouter au complément donné par les aa. dans FM II à propos du gouverneur de Saggarâtum. Le premier, lacunaire, contient des informations rapportées à Yaqqim-Addu au sujet de rois de Haute-Mésopotamie. Le second ordonne la distribution d'une partie du budget du gouverneur à des supplétifs, et évoque l'avancement de travaux entamés sur un canal. - R. BORGER, “Die Stadtmauer von Nippur zur Zeit Samsuilunas", NABU 1995/7: relecture d'une inscription royale relatant la construction de la muraille de Nippur. Le nom de la fortification doit être lu °ú-sur-ma-ta-t[im], “Protège les pays". - N. BRISCH, “Eine Išme-Dagân-zeitliche Siegelabrollung aus Uruk", BaM 29, 1998, p. 29-34: éd. d'un fragment de tablette de la 13e campagne de fouilles d'Uruk, où figurent deux empreintes du même sceau mentionnant Išme-Dagan d'Isin et dont la légende porte la séquence AN.AN.INANNA, lue soit “Inanna d'Uruj", soit “An (et) Inanna".
C - D. CADELLI, “Lieux boisés et bois coupés", in: Gs Birot, p. 159-173: éd. de 4 tablettes en relation avec le bois et les arbres (commandes de bois, régions forestières, coupe du bois butmun, liste de fûts). - A. CATAGNOTI, "Le royaume de Tubâ et ses cultes", in: Fs Fleury, p. 23-29: éd. de 5 tablettes de Mari documentant pour la première fois les relations entre Alep et la ville de Tubâ. L'attestation dans ces sources du culte de la déesse Estar de Tubâ, déjà connue à Ebla, renforce la localisation de cette cité à l'ouest, entre le Balih et Alep. - A. CAVIGNEAUX, Uruk. Altbabylonische Texte aus dem Planquadrat Pe XVI-4/5, AUWE 23, 1996: trs, trd et commentaire d'environ 300 tablettes d'Uruk. Le lot comporte des documents administratifs et économiques, des lettres, des textes littéraires, lexicaux et scolaires, des textes mathématiques, des lentilles et des inscriptions). - A. CAVIGNEAUX et F. AL-RAWI, “New Sumerian Literary Texts from Tell Haddad (Ancient Meturan): a First Survey", Iraq 55, 1993, p. 91-105: présentation des textes littéraires sumériens découverts sur le site de Meturan. Le lot, qui sera prochainement édité dans un volume de TIM, comporte des textes religieux (prières, incantations, textes magiques) et mythologiques (Gilgameš, Adapa). Ed. de deux tablettes hémérologiques bilingues et d'un texte médical akkadien. - G. CHAMBON et L. MARTI, "Sur le sens de uppusum", NABU 2003/5: le verbe uppusum signifie "calculer" et "faire une estimation", et indique une conversion métrologique d'un système (de poids ou de capacité) vers un autre. - D. CHARPIN, “Kakkikum et autres titres babyloniens dans un texte de Mari", NABU 1992/122: éd. d'une tablette de Mari relatant un litige fiscal entre Babyloniens, et mentionnant trois catégories de fonctions désignées par leurs titres: le šandabakkum, “archiviste" (D. Charpin) ou “commissaire" (W. Leemans); le kakkikum, “chef du cadastre"; le wakil bâbtim, “chef de quartier". - IDEM, “A boire!", NABU 1993/57: relecture de la lettre ARMT XIII, 149, qui conduit à écarter une référence improbable au tahtamum à Šubat-Enlil. - IDEM, “Données nouvelles sur la poliorcétique à l'époque paléo-babylonienne", MARI 7, 1993, p. 193-203: deux documents de Mari, dont un joint, apportent de nouvelles informations sur le travail de fortification dans la ville basse, et sur les circonstances du siège de Razamâ par Atamrum. - IDEM, “Les malheurs d'un scribe ou de l'inutilité du sumérien loin de Nippur", RAI 35, p. 7-27: éd. complète d'une lettre-prière bilingue sumérien-akkadien de Mari, envoyée à Zimri-Lim, et dans laquelle le scribe décrit sa misérable situation en dépit de ses compétences linguistiques. - IDEM, “Une campagne de Yahdun-Lîm en Haute-Mésopotamie", in: Gs Birot, p. 177-200: un dossier de textes comptables comportant 6 inédits publiés par l'a.,et enregistrant des dépenses diverses (vêtements, huile, cadeaux), permet de reconstituer l'itinéraire suivi par Yahdun-Lîm dans sa campagne pour la prise de Nagar et de mesurer la puissance du roi de Mari à l'étendue des territoires qu'il domine, par la conquête ou la soumission politique. - IDEM, "Les champions, la meule et le fleuve ou le rachat du terroir de Puzurrân au roi d'Esnunna par le roi de Mari Yahdun-Lim", in: Fs Fleury, p. 29-38: éd. complète d'une liste de champs comportant un récit d'ordalie atypique à propos d'une revendication d'un terrain situé en bordure du fleuve. Les serviteurs des deux litigeants doivent traverser le fleuve lestés chacun d'une meule. - IDEM, “La version mariote de l'‘insurrection générale contre Narâm-Sîn'", in: Gs Barrelet, p. 9-18: éd. complète d'une tablette sans doute composée à l'époque de Samsî-Addu, et évoquant un épisode de l'histoire paléo-akkadienne. L'original ayant servi à composer ce texte pourrait être la statue de Narâm-Sîn elle-même. La version mariote mentionne le retour au pays (andurârum) des gens de Kish, prisonniers à Uruk, grâce à la victoire de Sargon, et permet également de reconstituer la liste des rois coalisés contre Narâm-Sîn. - IDEM, “‘Lies natürlich...' A propos des erreurs de scribes dans les lettres de Mari", in: Fs von Soden, p.43-55: deux inédits de Mari publiés par l'a. documentent une confusion du scribe antique dans la notation erronée de noms propres. Dans la première lettre, le ministre responsable des pâtures (merhûm) Ibâl-pî-El indique à Zimrî-Lîm que la ville tombée aux mains de son adversaire Bunûma-Addu est Hadurahâ et non pas Aparhâ comme il l'avait écrit dans un courrier précédent, envoyé par le scribe sans l'avoir relu à haute voix. L'emploi de la racine RSB “se tromper" pour désigner l'erreur du scribe est attesté dans un autre texte édité par l'a., et au § 206 CH, où l'expression ina risbatim signifie non pas “dans une rixe" mais “par mégarde". Dans le second document, Zimrî-Lîm reproche à Yaqqîm-Addu, chef de district de Saggâratum, de s'être trompé sur l'identité de l'individu qu'il convoquait et d'avoir dès lors échoué dans ses recherches. Le fonctionnaire se défend en invoquant d'une part l'erreur dans la transmission orale du message qui lui a été délivré, et d'autre part la mauvaise volonté des habitants de la région, qui devaient se douter de la confusion mais n'en ont rien dit. - IDEM, “La fin des archives dans le palais de Mari", RA 89, 1995, p. 29-40: étude exhaustive des étiquettes de paniers à tablettes utilisés par les Babyloniens lorsqu'ils classèrent et trièrent les archives royales de Mari après leur conquête de la ville. - IDEM, “Le rôle du roi dans les inscriptions votives", NABU 1997/93: la compréhension d'ARMT XVIII 16 a été améliorée par un joint et montre l'intervention du roi dans le choix d'une inscription votive. – IDEM, “Emplois politiques du terme ebbum", NABU 1999/77: plusieurs occurrences du terme ebbum à Mari montrent qu'il ne s'agit pas toujours de “prudhommes" ayant une fonction économique, mais parfois aussi d'hommes de confiance ayant des attributions politiques. - IDEM, "Hagalum, šakkanakum de Râpiqum, et ses serviteurs", in: Fs Renger, p. 95-108: un contrat de Sippar (CT 47 30) daté du règne de Hammurabi et contenant la liste des biens donnés en dot par un père à sa fille, religieuse-nadîtum de Šamaš, comporte dans la liste des témoins 4 personnes décrites comme "serviteurs de Hagalum". Ce personnage est connu par la documentation de Mari comme étant šakkanakum de Râpiqum, c'est-à-dire fonctionnaire territorial, dépendant du royaume d'Ešnunna puis de Babylone. Le texte confirme que la formule "serviteur de" n'est pas réservée au service du roi. La nadîtum et son père appartenaient sans doute à la bourgeoisie de Râpiqum. - IDEM, "L'archivage des tablettes dans le palais de Mari: nouvelles données", in: Fs Veenhof, p. 31-38: éd. des étiquettes de coffres à tablettes retrouvées dans le palais de Mari. Sept d'entre elles indiquent le contenu du coffre: tablettes de recensement, de dépenses de bronze, etc… Une autre, trouvée dans un contexte secondaire, peut être associée à un lot de tablettes précis qui concerne le paiement de la taxe- miksum des Soutéens, sous le règne de Yahdun-Lîm. Il en va de même d'une étiquette du chantier A scellée par le fils d'Asqudum, trouvée à côté de reçus de laine et d'étoffe pour la maison d'Asqudum. Enfin, un scellement de paquet porte juste le nom du destinataire, Zimrî-Lîm, et le sceau de l'expéditeur, Hammurabi de Babylone, qui se donne les titres de roi d'Amurrum et roi d'Akkad. Il s'agit là de la seule empreinte connue à ce jour du sceau de Hammurabi. - IDEM, "De la bière pour une femme qui vient d’accoucher", NABU 2004/80 : sur le sens « accoucher » du verbe šalâmum et un compte rendu administratif qui mentionne une forte ration de bière pour une femme venant de mettre au monde un enfant. L’a. rappelle que la bière favorise la lactation, ce qui explique l’attribution de bière aux nourrices à Mari. - D. CHARPIN et J. -M. DURAND, "Des volontaires contre l'Elam", in: Fs Wilcke, p. 63-76: éd. d'une lettre de Sunurha-halû, le secrétaire du roi, à Zimrî-Lîm, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation mariote contre l'Elam en ZL 9'. L'expéditeur assure le roi de l'approbation des dieux, manifestée par les prophéties, et du soutien de la famille Igmil-Sîn, se faisant ainsi l'écho d'une "opinion publique" qui s'exprime assez rarement dans les sources antiques. Ces propos rassurants sont sans doute destinés à conforter Zimrî-Lîm dans sa difficile décision de combattre un roi qu'il reconnaissait jusque-là comme "père". - D. CHARPIN et N. ZIEGLER, “Mekum, roi d'Apišal", MARI 8, 1997, p. 243-247: édition de A.877 (copie, trs. et trd.), lettre de Yatarum à Yasmah Addu, qui a été envoyée depuis Karkémiš. Ce texte rapporte l'échec de la tentative que fit Yasmah Addu pour nouer des relations diplomatiques avec un dénommé Mekum, roi d'Apišal, royaume qui serait situé à l'ouest de Karkémiš. - M. CIVIL, “A New Lipit Eštar Inscription", NABU 1997/98: l'a. donne la trs. d'un cône se trouvant dans une collection privée américaine. - E. COHEN, "Focus marking in Old Babylonian", WZKM 91, 2001, p. 85-104: analyse syntaxique des façons grammaticales de marquer l'insistance sur un sujet donné, à travers le corpus des lettres paléo-babyloniennes (AbB et ARM). - G. COLBOW, “Ein gesiegelter Umschlag aus Kâr Šamaš und neue Aspekte zur Herkunft einiger Dokumente aus dem Ur-Utu-Archiv von Sippar-Amnânum", NAPR 9, 1996, p. 51-61: l'a. déduit d'une analyse glyptique que les documents Di 200 et Di 201 n'ont pas été rédigés à Sippar-Amnânum mais à Kâr-Šamaš. Leur découverte à Tell ed-Dêr suppose l'existence d'un acte de vente aujourd'hui perdu, appartenant à la famille Ur-Utu, et ayant peut-être transité par les archives d'Innana-mansum à Sippar Yahrurum. La présence d'un même sceau sur deux documents géographiquement distants s'explique par leur lieu d'origine commun. - EADEM, “Zu einigen besonderen Siegelbildern aus spätbabylonischer Zeit", Akkadica 99/100, 1996, p. 36-44: analyse de l'iconographie de 10 empreintes de sceaux apposées sur des tablettes publiées ou inédites de Sippar, datées entre Ammiditana 5 (1679 av. J. C.) et Samsu ditana 3/4 (1623/2 av. J. C.). - EADEM, “Altbabylonische Abrollungen in der Ecole pratique des Hautes Etudes", RA 90, 1996, p. 61-78: éd. d'une quinzaine d'empreintes de sceaux-cylindres paléo-babyloniens, appartenant aux archives de Šêp-Sîn de Larsa.
D - S. DALLEY et N. YOFFEE, Old Babylonian Texts in the Ashmolean Museum. Texts from Kish and Elsewhere, OECT 13, Oxford, 1991, 53 p.: copies de 291 textes économiques, administratifs, épistolaires et juridiques (ventes et achats fonciers, prêts, partages, contrats). - M. DE JONG ELLIS, “Notes on Some Family Property in Old Babylonian Sippar", AOF 24/1, 1997, p. 57-67: présentation de la publication à venir, avec V. Donbaz, des tablettes paléo-babyloniennes de Sippar conservées à Istanbul et issues des fouilles de Scheil en 1894. Plusieurs de ces documents appartiennent à la même archive de la nadîtu Šat-Aya, et remontent au règne de Sîn-muballit. Il s'agit de documents successoraux (appelés par l'a. “listes de biens patrimoniaux") détaillant la “part" (zittu) de la religieuse et le nom de ses héritiers. On relèvera que certaines tablettes ont un format “scolaire", ce qui ne remet pas en cause la réalité des situations et des personnages évoqués dans ces sources. - L. DEKIERE, Pre-Hammurabi documents, MHET II/1,1994, 293 p.: trs. sans trd. et commentaire de 129 textes issus de la collection du British Museum, provenant de la région de Sippar et antérieurs au règne de Hammurabi. Ces documents concernent la propriété au sens large. Catalogue et index. - IDEM, Documents from the Reign of Hammurabi, MHET II/2, 1994, 343 p.: trs. sans trd. et commentaire de 98 textes issus de la collection du British Museum, provenant de la région de Sippar et datés du règne de Hammurabi. Le lot contient des contrats de location, de vente et d'échange de champs, des partages successoraux et des donations, des listes de champs, quelques contrats d'adoption et récits de procès. - IDEM, Documents from the Reign of Samsu-iluna, MHET II/3, 224 p.: contrats de vente foncière, de location de champs ou de magasins, partages fonciers et successoraux, adoption, procès. - IDEM, Post-Samsu-iluna Documents, MHET II/4, 1995, 153 p.: louage de champs, prêt, vente de terres, un jugement, le tout daté de Abi-ešuh, Ammi-ditana, Ammi-Saduqa et Samsu-ditana. - IDEM, Documents without Date or with Date Lost, MHET II/5, 1996, 362 p.: contrats de vente, de louage et de fermage de champs, ventes de maisons, deux adoptions (dont l'une a un formulaire atypique), des procès et des partages successoraux. - IDEM, Old Babylonian real estate documents from Sippar in the british Museum, documents without date or with date lost, MHET II/5, 1996, 362 p.: trs sans trd ni commentaire de 279 tablettes issues du British Museum et provenant de la région de Sippar. Dans ce volume ont été regroupés tous les documents qui ne comportent pas d'éléments de datation. Ce lot contient essentiellement des contrats de vente et de location. - IDEM, Documents from the Series 1902-10-11, MHET II/6,1997: trs, catalogue et index de 89 tablettes de droit privé. Le lot comporte des actes de vente foncière, de louage, de rachat, des partages successoraux, deux procès immobiliers, une adoption et un échange. - M. DELOY PACK, "LÚ ebbum as a Professional Title at Mari", in: Mari in Retrospect, p. 249-264: l'a. conteste le sens de "prud'homme" proposé pour ce terme et suggère la traduction "comptable". - M. DIETRICH, "Zu den Urkunden aus dem Land Hana. Bemerkungen zu A. H. Podanys Buch über die Geschichte und Kultur eines mitteleuphratischen Regionalskönigtums im 2. Jt. v. Chr.", UF 33, 2001, p. 641-656: review-article de A. Podany, The Land of Hana. Kings, Chronology and Scribal Traditions, 2002. Le recenseur propose notamment de traduire le terme nasbum dans la clause nasbum ša lâ baqrim u lâ andurârim par “document contractuel / monument commémoratif (de la conclusion du contrat)". - E. DOMBRADI, “baqâru: Ein Fall von lexikalischem Transfer infolge von Plurilingualismus?", WO 28, 1997, p. 31-57: la racine ouest-sémitique BQR, “(re)chercher", a acquis en akkadien le sens technique de “faire valoir ses droits (sur une chose/personne)" sous l'influence du plurilinguisme et des contacts linguistiques et culturels entre l'akkadien et le sumérien (inim-gar). - D. DUPONCHEL, “Les comptes d'huile du palais de Mari datés de l'année de Kahat", in: Gs Barrelet, p. 201-262: éd. et étude d'un lot de 107 tablettes documentant l'activité du bureau de l'huile, dirigé par Balumenamhe, placé sous l'autorité de l'intendant du palais Šûb-Nalû. L'a. s'intéresse au personnel administratif, à la production et au stockage de l'huile, et aux faits historiques servant de toile de fond à certains textes (envoi de la terhatum de Šibtu à Alep, visite du roi numhéen Simah-ilânê). - J. -M. DURAND, "lû ittum", NABU 1992/35: la traduction "c'est un fait avéré que..." proposée par l'a. pour cette expression peut être affinée en "te souviens-tu de...", à la lumière notamment des textes de Tuttul. - IDEM, “Enclos-purrusâtum", NABU 1993/55: proposition d'interprétation du terme purrusâtum, “enclos", à la lumière d'un protocole de serment administratif inédit. - IDEM, “L'empereur d'Elam et ses vassaux", in: Fs de Meyer, p. 15-22: éd. d'une lettre de Zimri-Lim contenant la copie d'une lettre du sukkal d'Elam à Hamurabi de Kurda. Celui-ci doit rompre avec Babylone car il a fait allégeance à Atamrum d'Andarig. Ce document montre que les rapports hiérarchiques entre Amorrites sont désignés avec le vocabulaire de la parenté (“père", “fils", “frère") tandis que les termes “maître" (bêlum) et “serviteur" (wardum) qualifient les relations entre Elamites et Amorrites. Par ailleurs, la tablette atteste l'existence d'un verbe še’êrum, “souffler en tempête". - IDEM, “Administrateurs de Qattunân", in: Gs Birot, p. 83-114: éd. de 25 tablettes de la correspondance de plusieurs administrateurs de la province de Qattunân, en amont du Habur, venant compléter le dossier d'ARM XXVII. Ces textes révèlent l'instabilité du début du règne de Zimrî-Lîm, la multiplicité des fonctionnaires en poste dans cette région et la nature de leurs compétences. - IDEM, “Sâhum, sa'âqum = ‘crier'", NABU 1995/48: la documentation de Mari montre qu'il y a deux verbes sâhum, l'un signifiant “rire" (shq), l'autre “crier" (s’q). - IDEM, “Urpatum = ‘tente'", NABU 1995/49: le mot urpatum utilisé dans le langage littéraire (huruppatum à Mari) désigne non pas la “chambre à coucher" mais l'endroit bâché protégeant du soleil ou de la pluie et affecté à des fonctions militaires (tente) ou domestiques et familiales (repas). - IDEM, “Le sacrifice pîdum et le nom du jeune bouc à Mari", NABU 1995/80: dans le texte ARM XXII 291, le mot pîdum, litt. “rachat", ne désigne peut-être pas un sacrifice mais une taxe payée par les Bédouins. Le terme kapasum y figure pour désigner le jeune bouc, à côté d'autres noms de petit bétail. La même racine apparaît à Nuzi, où elle est glosée par le hurrite šihuru. Il faut donc éliminer l'entrée kapšušihuru des dictionnaires. - IDEM, "Apologue sur des mauvaises herbes et un coquin", in: Fs Del Olmo Lete, p. 191-196: éd. complète d'une lettre adressée au roi par le merhum Ibâl-El, et débutant par une série d'apophtegmes mettant en garde le souverain s'il néglige les signes avant-coureurs de mécontentement en Ida-Maras. - IDEM, “Etudes sur les noms propres d'époque amorrite, I: les listes publiées par G. Dossin", MARI 8, 1997, p. 597-673: nouvelle éd. des trois tablettes contenant des listes de NP publiées par G. Dossin, augmentée de joints et de collations, et enrichie de commentaires sur l'onomastique de l'époque amorrite et les habitudes d'écriture des scribes de Mari. - IDEM, Documents épistolaires du palais de Mari, 3 vol., 1997-2000, LAPO 16, 17, 18: nouvelle éd. commentée par dossiers des lettres du palais de Mari publiées soit dans la série ARM jusqu'à 1981, soit hors collection jusqu'en 1993. Pour le 1er volume de l'ouvrage (= LAPO 16), cf. le compte rendu de J. Eidem, Syria 76, 1999, p. 296-297, où le recenseur cite notamment en traduction un texte spectaculaire de Šehna/Šubat-Enlil (= Tell Leilan) décrivant un rite d'alliance par le sang. - IDEM, "Une alliance matrimoniale entre un marchand assyrien de Kanesh et un marchand mariote", in: Fs Veenhof, p. 119-132: éd. de l'inédit A. 2881 et nouvelle éd. d'ARM XIII 101, deux lettres envoyées par Habdu-malik, un important marchand d'Aššur et de Kaneš, à Iddin-Numušda, le chef des marchands de Mari. Les lettres proposent un échange de présents entre les deux correspondants ainsi que le mariage de leurs enfants. Les graphies et la facture ne sont évidemment pas mariotes, mais ne ressemblent pas non plus à celles des documents de Kaneš. Ed. en annexe d'une lettre de l'époque de Yahdun-Lîm mentionnant la ville anatolienne de Purušhattum comme lieu de provenance de pistaches. - IDEM, "sagûm = 'émigrer pour des motifs économiques' ", NABU 2003/30: le sens du verbe sagûm pourrait être rapproché de sugû "famine" et signifierait "quitter son chez-soi, poussé par le besoin", par rapport à habârum "quitter son chez-soi, poussé par des raisons politiques".
E - J. EIDEM, "Jakûn-Ašar (?) at Tell Brak", NABU 1991/108: la relecture d'un fragment d'inscription de Brak permet de restituer le nom du dernier roi de Leilan, Yakûn-Ašar(ca. 1745-1728), et montre les liens existant entre l'ancienne Subat-Enlil et Tell Brak. - IDEM, "The Tell Leilan Archives 1987", RA 85, 1991, p. 109-135: présentation des quelques 800 tablettes de Leilan, qui comblent le vide documentaire pour cette partie de la Mésopotamie, entre la fin du commerce cappadocien et le début du 2e millénaire. Ces textes confirment l'influence prépondérante d'Alep dans les rivalités politiques entre les villes du Habur et du Sinjar. Ils nuancent d'autre part l'état de semi-anarchie souvent décrit dans cette région et illustrent, à travers les textes juridiques et diplomatiques, une société structurée malgré un contexte politique agité. L'a. publie enfin une tablette attestant l'existence d'une cavalerie militaire dès cette époque. - IDEM, The Shemshâra Archives 2. The Administrative Texts, Historisk-filisofiske Skrifter 15, 1992, 165 p.: éd. complète de 146 tablettes de l'ancienne Šušarrâ concernant la circulation des produits agricoles et les mouvements de personnels. Les textes sont contemporains du règne de Samsi-Adad, à l'époque de la vice-royauté de Kuwari sur Shemshâra. Etude onomastique et ethnographique des documents. - IDEM, “Raiders of the lost Treasure of Samsî-Addu", in: Gs Birot, p. 201-208: éd. complète d'une lettre écrite par un haut fonctionnaire à Zimri-Lîm et rendant compte des mouvements de troupes effectués par l'armée royale dans le pays d'Apum. Les habitants de cette région ont en effet offert au roi le trésor de Samsi-Addu, caché à Šubat-Enlil, en échange d'une aide militaire contre Samiya qui s'est rendu maître de leur capitale. - J. EIDEM et J. LASSØE, The Shemshara Archives 1, The Letters, Historisk-filosofiske Skrifter 23, 2001, 185 p., 88 pl.: éd. des 100 lettres découvertes sur le site en 1957, précédée d'une présentation historique et chronologique. Les textes documentent les conflits internes au Zagros opposant Hourrites, Goutis et Elamites aux projets expansionistes de Šamši-Adad, et corrigent l'image, persistante mais inexacte à bien des égards, d'une société nomade à l'organisation rudimentaire, ou au mieux dimorphique d'après les travaux anthropologiques de Rowton.
F - W. FARBER, "Dr. med. Apil-ilišu Mârat-Anim-Strae (am Ebabbar-Temple) Larsa", in: Fs Renger, p. 135-150: éd. complète d'une tablette de Larsa conservée au musée de Brême, et contenant un contrat de vente foncière daté de Samsu-iluna. L'a. rapproche ce texte d'un contrat similaire du Louvre impliquant les mêmes acheteurs et les mêmes témoins. Le terrain est situé à proximité de l'Ebabbar, dans un quartier regroupant des membres du clergé, dont plusieurs apparaissent comme témoins et donnent sans doute leur accord à la transaction. La clause ezêbum, habituelle dans ce genre de texte, est ici formulée de manière atypique, et prévoit que les vendeurs doivent laisser une surface de terrain ana harrânim "pour le service militaire" (plutôt que "pour la route" i.e. le cadastre, selon J.-M. Durand et D. Charpin). - D. R. FRAYNE, Old Babylonian Period (2003-1595 B.C.), RIME 4, 1990, xxxi + 853 p.: corpus des inscriptions royales paléobabyloniennes, depuis Išbi-Erra (première dynastie d'Isin) jusqu'à la mort de Samsu-ditana (dernier roi de la première dynastie de Babylone). Les textes sont présentés dans l'ordre chronologique, par dynastie et par roi, ce qui permet de suivre l'évolution des titulatures royales et de regrouper les sources relatant un même événement.
G - H. GASCHE et L. DEKIERE, “A propos de la durée de vie d'une maison paléo-babylonienne en briques crues", NABU 1991/20: éd. d'une tablette des archives d'Ur-Utu provenant de Tell ed-Dêr (Sippar Amnânum) mentionnant l'achat de poutres pour la construction d'une maison. Le bâtiment, remontant à 1655, fut rénové en 1630 et détruit par un incendie en 1629. - O. D. GENSLER, “Mari Akkadian IŠ “to, for" and Preposition Hopping in the Light of Comparative Semitic Syntax", Or 66/2, 1997, p. 129-156. - A. R. GEORGE, "Another Piece of Abîešuh", NABU 1992/75: éd. d'un fragment d'inscription royale provenant de Sippar, venant s'ajouter au mince corpus de 4 textes connus pour Abîešuh. - M. GHOUTI, "Témoins derrière la porte", in: Fs Fleury, p. 61-68: éd. d'une lettre de Mari dans laquelle deux scheiks s'entretiennent d'une affaire de trahison politique. L'un des deux interlocuteurs jure de garder le secret, mais a pris soin de cacher 3 témoins qui écoutent la conversation, dont ils pourront confirmer la teneur par la suite. - A. GODDEERIS, "An Adoption Document from the Kisurra Collection in the British Museum", in: Fs Walker, p. 93-98: éd. complète d'une tablette d'adoption de Kisurra, concernant probablement une esclave car la clause de reniement de la part de l'adoptante n'entraîne pas de compensation pour l'adoptée. Le fait qu'il s'agisse d'une adoption entre femmes laisse supposer que l'adoptante a un statut cultuel. - B. GRONEBERG, “Les meilleurs vœux d'Alfred", NABU 1993/44: relecture de ARM XXVI/1 5 et 6. Zimri-Lim reproche à l'un de ses fonctionnaires son avarice en utilisant une métaphore canine. - EADEM, “Dam-hurâsim, Prinzessin aus Qatna und ihr nûbalum", in: Gs Birot, p. 133-136: éd. complète d'une lettre de Zimri-Lim demandant au chef des artisans de réparer à Mari le nouveau char-nûbalum d'une princesse de Qatnâ. - EADEM, “Eine altbabylonische Erbteilunsurkunde aus der Sammlung Dr. Martin", AOF 24/1, 1997, p. 49-56: éd. d'une “quasi-enveloppe" (Wilcke) de Sippar portant cinq empreintes de sceau sur la face et confirmant l'hypothèse de C. Wilcke d'une généralisation des tablettes-enveloppes dès le règne d'Abi-ešuh. Contrairement aux autres documents de ce type, contenant des transactions foncières ou des Aussteuerung de filles, le texte édité ici est un partage d'ascendant en échange d'une rente viagère. L'analyse prosopographique montre qu'il s'agit d'une famille riche et connue à Sippar. Il s'agit en outre du second partage intervenu dans cette famille, le précédent ayant été réalisé après le mariage du premier fils. - M. GUICHARD, “Flotte crétoise sur l'Euphrate?", NABU 1993/53: éd. d'une tablette administrative mentionnant la livraison de lapis-lazuli pour la décoration d'une barque crétoise, en vue sans doute d'un rite religieux. - IDEM, “Au pays de la Dame de Nagar", in: Gs Birot, p. 235-272: éd. de 4 lettres de Huzîrî, roi de Hazzikkannum, dans l'Ida-Maras. Cette correspondance illustre la complexité des relations politico-diplomatiques de l'époque, sur fond de guerre et de pillages. L'a. joint au dossier 3 lettres concernant la félonie d'Akîn-Amar, roi de Kahat, évoquée dans la correspondance de Huzîrî. - IDEM, “Lamassatum ša ašta’i", NABU 1995/22: l'expression désigne “l'ange-gardien du trône", une statuette décorative. - IDEM, “A la recherche de la pierre bleue", NABU 1996/36: la collation d'ARMT XXVII 161:19 fait apparaître le toponyme Suse et non pas Ur. La Mésopotamie s'approvisionnait en lapis-lazuli en Elam, qui fournissait déjà de l'étain. - IDEM, "Ma‘arabâ, ville voisine d'Ugarit, mentionnée dans les archives de Mari?", NABU 2003/7: commentaires sur un petit texte administratif atypique par sa forme, son contenu et son écriture, mentionnant le toponyme Ma‘arabâ (i-na ma-ah <<ah>>-ra-ba-a) et peut-être représentatif d'une tradition scribale propre à cette ville. – IDEM, "Divinité des salines mentionnée à Terqa", NABU 2003/8: relecture du nom d'une divinité mentionné sur un contrat de Terqa et son enveloppe, qui devient Annunîtum "du sel" ou "de Îabâtum (ville du sel)". – IDEM, "La lettre de Yassi-Dagan M. 7630", NABU 2003/9: nouvelle éd. de cette lettre après collations sur photo. - I. GUILLOT, “Les gouverneurs de Qattunân: nouveaux textes", in: Gs Barrelet, p. 271-290: addition de nouveaux textes au corpus d'ARM XXVII. On notera un cas de désertion (n°136) d'un Bédouin, définie par le verbe patârum, et pour laquelle on réclame la confisaction de ses biens.
H - W. W. HALLO, “The Royal Correspondence of Larsa: III. The Princess and the Plea", in: Fs Garelli, p. 377-388: lettre en forme de prière adressée à Rîm-Sîn par la princesse Ninšatapada, fille de Sîn-kašid d'Uruk. Il s'agit d'un véritable hymne à Rîm-Sîn, louant les bienfaits de ce roi pour la ville d'Uruk et implorant la même attitude magnanime pour Durum, conquise en 1804, et dont la princesse est originaire. - IDEM, "A Model Court Case Concerning Inheritance", in: Gs Jacobsen, p. 141-154: éd. de la copie paléo-babylonienne d'un texte original remontant sans doute au XXe s. et appartenant au groupe des textes juridiques scolaires de Nippur. Il s'agit d'un procès en matière successorale: 2 frères avaient partagé le patrimoine paternel, mais une dizaine d'années plus tard, les fils de l'aîné se plaignent de ce que leur oncle ne leur a rien transmis de la part qui leur revenait. Les parties trouvent un arrangement et les neveux jurent de ne plus revenir sur cette affaire. - W. HEIMPEL, "Lakûm, to feel secure", NABU 1995/87: à propos de trois exemples mariotes du verbe lakûm, “se sentir en sécurité", confondu avec la racine alâkum, “aller". - IDEM, “Salâlum, to be sleepless", NABU 1995/93: l'a. propose pour le verbe salâlum rencontré notamment dans le récit du siège de Razama (MARI 7, p. 197-203), le sens de “être éveillé", “se réveiller". - IDEM, “Boundaries in space and time", NABU 1996/13: le mot “tête" dans les expression rêš eqlim et rêš warhim désigne une “limite/frontière" géographique ou temporelle. - IDEM, “More light on the dark fate of Qarni-Lim", NABU 1996/47: l'expression “enterrer habillé" utilisée à propos de la fin tragique de Qarni-Lim d'Andarig, dont le corps décapité est jeté au fleuve, indique l'absence de toute cérémonie funéraire habituelle. Quant à la tête détenue par Bahdi-Lim, celui-ci se demande s'il doit l'enterrer dans un simple trou rond ou dans une sépulture rappelant la forme d'un corps. - IDEM, “Maroccan Locusts in Qattunan", RA 90, 1996, p. 101-120: tentative d'identification des différents types de sauterelles dont les lettres de Mari documentent les invasions et les ravages. - IDEM, “A case of BA = pá", NABU 1997/5: l'a. réinterprète un passage d'ARM V 39, en établissant un parallèle avec l'épilogue du code d'Hammurabi (XXVI r 28). Il arrive à la conclusion que le son /pa/ peut être écrit avec le signe BA. - IDEM, “My Father is my Rock", NABU 1997/2: l'akk. kâpum, “roc", se retrouve dans la composition de nombreux noms propres, ainsi que plusieurs exemples de Mari le montrent. - IDEM, “Mushrooms", NABU 1997/3: à Mari, kam'um, “truffe" ou “champignon du désert", a deux pluriels, kam'û et kam'âtum (comme le terme similaire en arabe). Sa consommation est associée à la vie de la steppe. - IDEM, “Cases of Belated and Premature Initiative", NABU 1997/113: l'a. suggère que les expressions qâtam bâ'îtam epêšum et šakânum soient traduites par “prendre l'initiative". - IDEM, “Termite and Ants", NABU 1997/102: (cette note remplace NABU 1997/63), l'a. interprète le terme rimmâtum, cité dans A.3080 (cf. J. M. Durand, Fs Perrot, p. 101-108), comme désignant des termites. Ensuite, il considère M.7857, publié par M. Guichard, MARI 8, 1997, p. 315, comme un exercice scolaire sur la notations des grands nombres. - IDEM, “The Defense of Hiritum", NABU 1997/103: malgré la publication de D. Lacambre dans MARI 8, 1997, p. 431-454, la méthode de défense employée par les Babyloniens contre les Elamites reste obscure. - IDEM, “Crack of dawn", NABU 1997/4: l'expression tirik šadîm désigne le lever du jour. - IDEM, “A.2741", NABU 1998/59: relecture de cette lettre et nouvelles interprétations. Voir la réponse de J. -M. DURAND, NABU 1998/94. – IDEM, “Minding an oath", NABU 1999/42: zakârum désigne la déclaration du serment, qui le rend opérationnel, tandis que hasâsum évoque la mémoire du serment dans les actes postérieurs, qui maintient le serment opérationnel. - W. HOROWITZ et A. SCHAFFER, "An Administrative Tablet from Hazor: A Preliminary Edition", IEJ 42, 19-92, p. 21-33: éd. complète d'une sorte de feuille de paye fragmentaire, contenant l'attribution de sommes d'argent à plusieurs personnes. La facture de la tablette souligne l'influence de la tradition scribale de Mari. L'étude onomastique permet de dater le texte des années 1760. - V. HUROWITZ, “An Old Babylonian Bawdy Ballad", in: Fs Greenfield, p. 543-558: translitt., trad. et commentaire d'un précurseur féminin du “Mille e tre" de Don Giovani, relatant les frasques d'une nommée Ištar avec 120 jeunes gens.
I - K. S. ISMA'EL, "A New Table of Square Roots", Akkadica 112, 1999, p. 18-26: édition (trs. et copie) d'un prisme triangulaire mathématique paléo-babylonien (IM 52001) retrouvé à Tell Harmal (l'ancienne Šaduppum). Ce document donne la liste des racines carrées de 1 à 90. - IDEM, "A New Mathematical Text in the Iraqi Museum", Akkadica 113, 1999, p. 6-12: trs. et copie d'une tablette mathématique (table de multiplications) paléo-babylonienne provenant de Tell al-Seeb (l'ancienne Me-Turan) dans le bassin du Hamrim. - IDEM, "Two Old Babylonian Texts from Sippar", Akkadica 122, 2001, p. 59-63: éd. complète de deux textes (une tablette et une enveloppe) de Sippar trouvés dans le quartier du cloître et appartenant à l'archive d'un nommé Aqbû, qui paye une taxe foncière (mas a-sà) pour des champs qu'il loue. Dans un cas, le bailleur est une religieuse-nadîtum. Le dieu Samas apparaît comme témoin dans les deux documents.
J - A. JACQUET, "Echanges de présents entre Šubat-Enlil et Mari", NABU 2003/44: commentaire de ARM X 20 et XII 385, avec une mise au point sur les termes Šehlatum et Šahlatum. - C. JANSSEN, “When the House is on Fire and the Children are Gone", RAI 40, p. 237-246: étude combinée des informations archéologiques et textuelles concernant la famille d'Ur-Utu. Le locus de découverte des tablettes permet de déterminer les critères de classification d'archives, en particulier les tris et réorganisations opérées dans la documentation. Le corpus des textes relatifs aux biens fonciers se divise en sept dossiers, établis d'après des chaînes de transmission des titres de propriété pour chaque bien, depuis les tuppât ummâtim, “tablettes d'origine" jusqu'aux contrats de vente récents. La destruction de la maison par le feu semble résulter d'une catastrophe extérieure, peut-être une invasion de tribus nomades. - C. JANSSEN, H. GASCHE et M. TANRET, “Du chantier à la tablette. Ur-Utu et l'histoire de sa maison à Sippar-Amnânum", in: Fs de Meyer, p. 91-123: étude qui combine les informations archéologiques et épigraphiques pour reconstituer l'histoire de la maison d'Ur-Utu, Grand Lamentateur de la déesse Annunitum. Achetée en ruine par son père, Inanna-mansum, qui la restaura et l'occupa pendant 12 ans, elle abrita une partie des archives familiales triées. Ur-Utu la reçut en héritage, y fit des travaux de rénovation, et commença le classement de ses archives (environ 2000 tablettes) pour les entreposer dans une seule pièce. Un incendie détruisit la maison avant la fin du travail, ce qui explique l'éparpillement des textes à l'intérieur du bâtiment. - F. JOANNES, “Le traité de vassalité d'Atamrum d'Andarig envers Zimri-Lim de Mari", in: Fs Garelli, p. 167-177: éd. complète d'une tablette dans laquelle Atamrum s'oblige à être loyal et honnête envers Zimri-Lim, reprenant une formulation bien attestée dans les serments de vassalité syro-hittites du milieu du IIe millénaire et dans les sources néo-assyriennes. - IDEM, "La femme sous la paille", in: Fs Fleury, p. 81-92: éd. d'une lettre de Mari évoquant les affaires de gestion du personnel relevant du palais et les conflits entre fonctionnaires. Un intendant se plaint ainsi à Yasmah-Addu, vice-roi de Mari, qu'un de ses collègues cherche à s'emparer d'une femme qu'il a vainement tenté de cacher sous la paille d'un grenier. - IDEM, "Une mission secrète à Esnunna", RAI 38, p. 185-193: éd. complète d'une lettre rapportant l'itinéraire suivi par des Benjaminites pour se rendre secrètement du Sinjar à Esnunna. Outre les informations géographiques qu'elle contient, cette tablette documente les contacts politiques noués par Esnunna contre Zimri-Lim. - IDEM, “Palmyre et les routes du désert au début du deuxième millénaire av. J. C.", MARI 8, 1997, p. 393-415: l'a. édite 7 lettres (copie, trs. et trd.) de l'époque de Samsî Addu et de Zimrî-Lîm et analyse le rôle de Palmyre dans les relations entre Mari et Qatna. Une étude sur les Sutéens, qui étaient établis dans la région de Palmyre, est aussi fournie. - M. JURSA, “Zu Edubba 1, 10", NABU 1994/65: trad. et commentaire d'une tablette avec enveloppe de tell Haddad (publiée par A.K. Muhamed, Old Babylonian Cuneiform Texts from the hamrin Basin n° 10). Il s'agit d'une convention par laquelle le maître d'un esclave renonce à toute revendication sur les enfants et l'épouse (libre) du serviteur. - IDEM, “‘Als König Abi-ešuh gerechte Ordnung hergestellt hat': eine bemerkenswerte altbabylonische Prozessurkunde", RA 91, 1997, p. 135-145: éd. complète d'une tablette du British Museum, provenant sans doute de la région de Sippar, et relatant un procès en revendication de dot intenté par une femme en instance de divorce. Les témoins certifient que la demanderesse a bien reçu une dot, mais sont incapables d'en déterminer le contenu exact, sans doute à cause de l'ancienneté des faits. La tablette énumérant les biens dotaux ne pouvant être produite, les juges défèrent finalement le serment au mari, lequel préfère transiger au dernier moment.
K - M. A. KALIL, Old Babylonian Cuneiform Texts From the Hamrin Basin. Tell Haddad, Edubba 1, Londres, 1992, 69 + 52 pl.: éd. de 24 tablettes paléo-babyloniennes provenant de tell Haddad, l'ancienne Mê-Turân. Le lot comporte plusieurs contrats de vente foncière: champs (n° 1-2, 5-9); maison en totalité (n° 4) ou en partie (n° 3, précisant que la maison est voisine de celle du “seigneur de Mê-Turân"). Un contrat de mariage (n° 10) entre une femme libre et un esclave prévoit que le propriétaire de l'esclave n'aura pas de droit sur les enfants (voir NABU 1994/65). Plusieurs catégories de prêts sont documentées: prêt sans intérêt (hubuttâtum; n° 12-13); prêt d'huile que le débiteur rendra à son retour de voyage (n° 14); prêt d'argent (n° 15 et 17). Le reste du lot concerne le droit pénal (n° 11: affaire d'un cambriolage) ou commercial (n°16: arrangement d'une entreprise commune illatum), et comporte diverses notices (n°18- 19: notice sur du blé; n°20: notice sur de l'huile), deux lettres (n° 21-22) et des textes administratifs (n° 23-24). On notera aux n° 2, 6 et 8 la clause selon laquelle le forgeron (simug) doit peser l'argent, et aux n° 2 et 8 le sceau ou la présence d'un préposé au cadastre (šassukkum). - E. KELLENBERGER, "têbibtum in den Archiven von Mari und Chagar Bazar", UF 32, 2001, p. 243-260: sur les emplois du terme têbibtum, “recensement", et l'explication possible du mot, qui pourrait renvoyer à un rituel d'onction. - K. KESSLER, "Das spätbabylonische Tempelarchiv vom Tell Egraineh", AfO 44-45, 1997-1998, p. 131-133: catalogue de 63 tablettes de la fin de l'époque paléo-babylonienne, provenant d'un site au nord de Babylone et conservées au British Museum. Il s'agit d'une partie des archives administratives du temple d'Uraš. La plupart des textes concerne des prêts d'orge effectués par le temple devant 2 ou 3 témoins, quasiment toujours les mêmes. - H. KLENGEL, “Richter Sippars in der Zeit des Ammišaduqa: ein neueur Text", in: Fs de Meyer, p. 169-174: éd. d'une tablette en forme d'enveloppe contenant un contrat de vente d'un terrain à Sippar-Amnânum. Transmise par voie de succession à deux hommes qui meurent sans héritiers, la terre est vendue par leurs neveux. L'a. approfondit l'étude prosopographique des 5 juges figurant en tête de la liste des témoins de la vente. - IDEM, “Eine altbabylonische Kaufurkunde betreffend Feld von ‘Stiftsdamen' des Gottes Šamaš in Sippar", in: Fs Röllig, p.163-170: étude de la tablette VAT 632 de Sippar, datée de Ammisaduqa, appartenant au type des “quasi-enveloppes" (Wilcke) et contenant une vente de champ appartenant à une religieuse-nadîtum. Le texte mentionne la remise du contrat des précédents propriétaires (tuppi šimâtim), et montre une remarquable stabilité des prix dans l'immobilier à Sippar. Le document confirme l'équivalence Sippar-Yahrurum = Sippar de Šamaš (Charpin). - M. KREBERNIK, “Die Textfunde aus Tall Bi’a", MDOG 122, 1990, p. 67-87: éd. complète de 23 tablettes datées de l'époque de Yasmah-Addu et contenant des listes diverses (bière, étoffes, rations, personnel) ainsi qu'un fragment de texte littéraire. - J. -R. KUPPER, “Zimri-Lim et ses vassaux", in: Fs Garelli, p. 179-184: examen du vocabulaire d'allégeance et de soumission employé par les vassaux du roi de Mari, et synthèse sur les différentes étapes de l'entrée en vassalité, les obligations réciproques des deux parties. - IDEM, “Kirrum dans les textes de Mari", RA 90, 1996, p. 97-100: l'a. propose pour ce terme, à distinguer de girrum, la traduction “commando". - IDEM, “Les différents moments de la journée d'après les textes de Mari", in: Fs Limet, p. 79-85: étude du vocabulaire désignant le matin, le midi, l'après-midi (ou l'heure de la sieste), le crépuscule et la nuit. - IDEM, Lettres royales du temps de Zimri-Lim, ARM XXVIII, 1998, vii + 401 p.: éd. de 180 lettres échangée entre Zimri-Lim et ses vassaux ou ses alliés, surtout dans la région de l'Idamaras. Les textes sont présentés par ville ou pays, ou par nom de roi quand on ignore la localisation de leur royaume. - IDEM, "sikkatam ana pîm mahâsum", NABU 2000/50: l'a. accepte la correction proposée par W. Heimpel pour ARM XXVIII 67:21-22, où giš-šitax est remplacé par giš-kak, désignant le piquet planté dans la bouche d'un condamné. Mais il refuse d'y voir une illustration de la peine capitale, y voyant plutôt une peine réfléchissante. L'a. fait le point sur les diverses attestations de cette expression dans les sources de Mari. - IDEM, "De l'usage frauduleux des poids et mesures", Akkadica 121, 2001, p. 1-4: l'inscription portée sur un vase-étalon de 5 litres comporte, de manière tout à fait atypique, une malédiction rappelant les allusions des textes littéraires et juridiques aux usages frauduleux des poids et mesures. - IDEM, "L'akkadien des lettres de Shemshâra", RA 95, 2001, p. 155-173: review-article de J. Eidem et K. Lassoe, The Shemshâra Archives 1, 2001. - IDEM, "Niggallum 'moisson' ", NABU 2003/14: relecture de Eidem, Shemsâra Archives 1 n° 42:40-41, i-nu-ma ni-gal-lum, i-ma-aq-qú-tù "lorsque la faucille tombera" = "lorsque la moisson surviendra".
L - D. LACAMBRE, “L'enlèvement d'une fillette", in: Gs Birot, p. 275-284: éd. d'une lettre du devin Haqba-Hammû qui nie auprès de Zimrî-Lîm avoir enlevé une jeune fille pour se l'approprier et prétend l'avoir réservée au roi, ayant remarqué l'intérêt qu'il lui portait. - IDEM, “La gestion du bronze dans le palais de Mari: collations et joints à ARMT XXII", in: Gs Barrelet, p. 91-123: éd. complète de 7 tablettes comptables relatives au travail du bronze ou du cuivre. - B. LAFONT, “L'admonestation des Anciens de Kurdâ à leur roi", in: Gs Birot, p. 209-220: éd. de 2 lettres concernant Simah-ilânê, roi de Kurdâ, qui s'obstine à vouloir traiter Zimrî-Lîm comme son égal (“frère" dans la langue diplomatique), ainsi que le lui recommandent les Anciens, au lieu de reconnaître la supériorité du roi de Mari (“père"). Ces deux tablettes illustrent d'une part la stratégie politique de Zimrî-Lîm, qui rétablit au pouvoir les familles royales évincées par Samsi-Addu, et d'autre part la conception tribale plutôt que territoriale de la royauté. - IDEM, “Nouvelles lettres de Sidqum-Lanasi, vizir du royaume de Karkémish", MARI 8, 1997, p. 781-784: éd. complète d'une nouvelle lettre du vizir d'Aplahanda de Karkémiš, et rééd. d'une lettre déjà publiée dans Fs Garelli. Dans le premier texte, Sidqum-Lanasi demande à Habdu-Malik d'intervenir en sa faveur auprès du roi de Mari, pour une requête qui reste ignorée. Dans la seconde lettre, le vizir envoie à Zimrî-Lîm deux esclaves qu'il a achetés à sa demande. - IDEM, “Techniques arboricoles à l'époque amorrite. Transport et acclimatation de figuiers à Mari", in: Gs Barrelet, p. 263-268: éd. complète d'une lettre de Sammêtar montrant la haute qualification des jardiniers mariotes, capables d'acclimater à Mari des espèces végétales lointaines. - J. LASSØE et T. JACOBSEN, "Šikšabbum again", JCS 42/2, 1990, p. 127-178: éd. complète de 11 lettres de Semshera documentant le rôle de la ville de Šikšabbum dans la politique d'expansion territoriale de Samsi-Adad Ier. - W. F. LEEMANS, “Textes paléo-babyloniens commençant par une liste de personnes", in: Fs Garelli, p. 307-331: étude d'une soixantaine de textes paléo-babyloniens énumérant pour commencer une liste de témoins (šîbû). Il ne s'agit pas de récits de procès, ni systématiquement de contrats. Il est en fait impossible de les ranger sous une dénomination spécifique et constante. La plupart sont des “réglements de différents", les autres sont des déclarations, des rapports, des procès-verbaux, des contrats et des ordres. Tant sur la forme que sur le fond, des différences importantes séparent les sources du Nord et celles du Sud. - B. LION, “Un contrat de vente de maison daté du règne d'Enlil-bâni d'Isin", RA 88, 1994, p. 129-133: éd. d'une tablette paléo-babylonienne appartenant à une collection privée, dans laquelle une sœur achète à son frère une petite surface de maison, peut-être des pièces attenantes pour agrandir sa propre demeure. - EADEM, “Des princes de Babylone à Mari", in: Gs Birot, p. 221-234: éd. de 4 lettres attestant le passage à Mari de deux fils de Hammurabi de Babylone, Sûmû-ditana et Mutu-Numaha, jusqu'ici inconnus.
M - A. MALAMAT, “A Recently Discovered Word for ‘Clan' in Mari and Its Hebrew Cognate", in: Fs Greenfield, p. 177-179: l'a. souligne le parallèle sémantique entre le mot lîmum, “clan tribu, multitude" attesté à Mari et à Ugarit (l’im), et l'hébreu le’ôm, dont un synonyme est ‘elep, “mille, multitude, clan". - IDEM, “Is There a Word for the Royal Harem in the Bible? The Inside Story", in: Fs Milgrom, p. 785-787: l'hébreu penîmâ “dans, à l'intérieur", tout comme le mariote tubqum "coin", désignent le harem. Il s'agit dans les deux cas non pas d'un terme technique mais d'une expression informelle, renvoyant en l'espèce à la localisation du harem, dans les tréfonds du palais. - P. MANDER et F. POMPONIO, "A Minor Old Babylonian Archive about the Transfer of Personnel", JCS 53, 2001, p. 35-67: éd. complète de 12 tablettes du British Museum, toutes datées de l'année 39 de Hammurabi, rédigées selon le ductus du sud et concernant le remplacement de soldats transférés d'un lieu à l'autre. Ces textes proviennent sans doute de Lagaš, et leur comparaison avec d'autres sources administratives ou épistolaires contemporaines montre que le gouvernement central agissait en ce domaine de manière identique dans toutes les provinces, y compris celles du sud, récemment conquises. - P. MARELLO, "Vie nomade à Mari", in: Fs Fleury, p. 115-125: éd. d'une lettre adressée à Yasmah-Addu, pleine de métaphores et de proverbes, stigmatisant les défauts de la vie sédentaire (oisiveté, mauvaises dépenses, puérilité) et exaltant les valeurs authentiques de la vie nomade. - IDEM, “Esclaves et reines", in: Gs Birot, p. 115-129: éd. complète de deux tablettes administratives, contenant une liste de femmes prises comme butin à Ašlakkâ et déportées à Mari. Ces deux documents illustrent directement les lettres d'ARM X 123-126. - IDEM, “Liqtum, reine du Burundum", MARI 8, 1997, p. 455-459: l'a. édite M.8161 (copie, trs. et trd.), lettre que Liqtum envoya à Zimrî Lîm pour lui réclamer un présent. Cette lettre confirme que Liqtum était bien la femme d'Adal šenni, roi de Burundum (Haut Tigre), et peut être une des sœurs du roi de Mari. Une andurârum est mentionnée dans ce texte, mais il n'est pas possible de savoir si c'est à Mari ou à Burundum qu'elle a eu lieu (cf. aussi B. Lion, NABU 1997/116). - L. MARTI, "Tablette d'accompagnement", NABU 2001/106 : collation de ARM XXVI/2 466. -IDEM, "L'union fait la force", NABU 2001/107: collation de ARM XXVI/2 528. - IDEM, "Les papiers du père Scheil", NABU 2002/25: éd. d'une tablette de fondation en pierre de Rim-Sin (duplicat de Shileiko, VN, p. 23-24), accompagnée d'une reproduction de la copie et de la trs autographes du père Scheil. - IDEM, "Le mois ú-wa-rum", NABU 2003/10: il faut maintenir l'existence d'un mois uwârum dans les textes ARM IX 97 et XXVI 248. – IDEM, "Le mariage de la princesse Tizpatum, princesse de Mari", NABU 2003/40: relecture de ARM IX 246 après collations. Le texte concerne le mariage de Tizpatum avec Ilî-Istar de Sunâ. Le document énumère d'abord l'argent, les esclaves et les moutons apportés pour sceller les fiançailles (ll. 4-5, sa dabâbim sa ina panîtim ubluni, "ce dont il avait été question, ce qu'on a apporté dans un premier moment"), puis une autre série de biens en quantités plus grandes constituant "la dot qu'ensuite on a apportée" (ll. 10-11, nidittum sa warkanu ublunim). Le terme nidittum fonctionne ici comme équivalent de terhatum, désignant ce que le futur époux apporte à sa femme au stade du mariage commencé. - S. M. MAUL, “Die Korrespondenz des Iasîm-Sûmû. Ein Nachtrag zu ARMT XIII 25-57", in: Gs Birot, p. 23-54: éd. complète de 20 tablettes complétant le dossier d'ARMT XIII concernant le šandabakkum Iasîm-Sûmû. Ces textes illustrent, outre les activités administratives de ce haut fonctionnaire, ses attributions diplomatiques. - W. R. MAYER, "Ein Hymnus auf Ninurta als Helfer in der Not", Or 61/2, 1992, p. 17-57: un hymne à Ninurta d'époque paléobabylonienne accorde aux animaux sauvages, soumis par l'homme pour son seul plaisir, un droit à la liberté protégé par la divinité elle-même. - A. MILLET ALBÀ, "Les noms propres avec préformative en me- et mu- des archives de Mari", in: Fs Del Olmo Lete, p. 205-214: analyse morphologique et prosopographique des NP à forme participiale à Mari. - A. K. MOHAMMAD, "Texts from Šišîn", Akkadica 123, 2002, p. 1-10: trs et copie de 7 textes de Šišîn, à 50 km au nord de Hît, qui a appartenu à la sphère d'influence d'Esnunna comme en témoigne une lettre datée d'Ipiq-Adad II. Le lot comporte 3 lettres, 2 prêts d'argent, 2 listes de personnes, un reçu, une tablette d'exercice et un fragment de texte littéraire.
N - S. B. NOEGEL, “Yasîm-El's sophisticated Rhetoric: A Janus Cluster in ARMT XXVI, 419, l. 10'", NABU 1995/90: à propos de jeux de mots amphibologiques dans quelques textes du corpus de Mari.
O - G. OZAN, “Viandes et poissons: transport et conservation", in: Gs Birot, p. 151-157: éd. de 3 tablettes documentant le transport et la conservation de la viande et du poisson. Une lettre signale l'arrivée de viande à Mari en provenance de Mardamân, une autre, très abimée mentionne la réception de viande avariée, et une troisième justifie l'impossibilité d'envoyer au roi du poisson, la pêche n'ayant pu être pratiquée dans de bonnes conditions. - IDEM, “Les lettres de Manatân", in: Gs Barrelet, p. 291-305: éd. de 16 lettres de l'un des chefs de service (wedûm) du palais de Mari. La plupart des textes informent le roi de l'arrivée de caravanes commerciales ou diplomatiques.
P - O. PEDERSÉN, “Zu den altbabylonischen Archiven aus Babylon", AOF 25, 1998, p. 328-338: reconstitution des groupes d'archives de tablettes trouvées à Babylone par les fouilles allemandes. - R. PIENTKA-HINZ, "Ein spätbabylonischer Kaufvertrag aus Babylon", in: Fs Walker, p. 201-214: joint de 2 fragments d'une “quasi-enveloppe" concernant un achat de bien immobilier sous Samsu-ditana. Le texte a été rédigé par le scribe du roi et porte une formule de datation atypique. La tablette comporte plusieurs impressions de sceaux, dont 2 du vendeur.
R - K. REITER et H. WAETZOLDT, “Neue Lesevorschläge und Kollationen zu den altbabylonischen Texten aus Uruk", BagM 27, 1996, p. 401-409: collation des textes du palais de Sînkâšid, effectuées par les aa. à Bagdad en 1994. - W. H. Ph. RÖMER, “Ein a-da-ab-Lied auf Ningublaga mit Bitten für König Iddindagân von Isin um Hilfe gegen Feinde wie etwa die Mardubeduinen (Sumerische Hymnen III)", UF 28, 1996, p. 527-546: trs, trd et commentaire d'un hymne à Iddin-Dagan d'Isin, qui illustre les démêlés du roi avec les Bédouins à la frontière nord de son royaume et contredit l'hypothèse d'un règne tranquille et pacifique de ce souverain. - A. ROSITANI, Rîm-Anum Texts in the British Museum, NISABA 4, 2003, 249 p.: éd. de 154 tablettes du British Museum, provenant du bît asîrî, "maison des 'prisonniers de guerre' " à Uruk sous le règne de Rîm-Anum, et s'inscrivant dans le contexte agité de la révolte des villes du sud mésopotamien contre l'autorité de Samsu-iluna durant la 8e année de son règne. Le lot comporte des attributions de farine, l'enregistrement de mouvements de personnel servile et divers textes administratifs. La datation de tous ces textes permet de reconstituer une trame événementielle de la situation historique d'Uruk et des grandes villes du sud entre les années 8 et 10 de Samsu-iluna.
S - W. SALLABERGER, “Zu einigen Jahresdaten Enlil-bânis von Isin", ZA 86/2, 1996, p. 177-191: étude d'un lot de textes administratifs d'Isin relatifs à des versements quotidiens de farine et de grains, tous datés d'Enlil-bâni. L'a. reconstitue une séquence de 8 des 18 noms d'années connus pour ce roi et propose une actualisation de la chronologie traditionnelle. - S. SANATI-MÜLLER, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast, zweiter Teil. Fischtexte und Bürgschaftsurkunden", BagM 20, 1989, p. 225-313: suite du travail du même auteur sur les textes du palais de Sînkâšid (cf. BagM 19, 1988, p. 471-538, à propos des documents sur les céréales et les livraisons de farine); catalogue, copies, transcriptions et commentaires philologiques de 24 tablettes sur les poissons; analyse des méthodes de préparation et de conservation des poissons; copies et transcriptions de 19 contrats de cautionnement; index des noms de personne. - EADEM, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast, Sechster Teil, Texte verschiedenen Inhalts III (Taf. 45-50)", BagMitt 24, 1993, p. 137-184. - EADEM, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast. Siebender Teil. Texte verschiedenen Inhalts IV (Taf 7-11), BagMitt 25, 1994, p. 309-340: éd. de deux tablettes récapitulant des attributions de laine et de textiles (à rattacher au dossier déjà publié dans BagMitt 23). - EADEM, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast. Achter Teil. Texte im Zusammenhang mit Skelettresten (Taf 13-16)", BagMitt 26, 1995, p. 65-84: éd. complète de 4 tablettes d'Uruk datées, pour deux d'entre elles, d'Irdanene. Le lot comporte une liste de noms de femmes (n° 211), le paiement de divers objets en métal et en tissu (n° 210) et un long texte récapitulatif de la production de plusieurs champs apportée à Uruk (n° 208). Le n° 209 est incompréhensible. - EADEM, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast", BagM 26, 1995, p. 65-84: éd. complète de quatre tablettes paléo-babyloniennes. Outre une liste de biens en métal et de tissus et une liste de noms de femmes, le lot comporte une tablette inintelligible et un long texte sur 5 colonnes énumérant les céréales et les dattes produits par divers champs et consignant l'attribution d'une part de bière aux troupes d'Isin, et d'autre part de céréales, farine et argent aux dieux et aux fonctionnaires. - EADEM, “Texte aus dem Sînkâšid-Palast. Neunter Teil. Rohrtexte", BagM 17, 1996, p. 365-399: éd. de 141 tablettes concernant les roseaux ou le bois, et remontant au règne de Rîm-Anum. - C. SAPORETTI, “Texti da Tell Yelkhi del periodo Isin-Larsa I", Mesopotamia 30, 1995, p. 1-38: copie de 53 tablettes administratives (le lot comporte trois lettres). Catalogue et index des NP. - IDEM, “Cinque note dai testi di Ešnunna", Mesopotamia 33, 1998, 147-166: 1/ le nom d'année d'Ibal-pî-El II mentionnant l'entrée d'une araire (aratro) d'or au temple de Tišpak d'Ešnunna fait référence à un acte propitiatoire en lien avec la proclamation d'une mîšarum à Dûr-Rîmuš pour l'ensemble du royaume; 2/ remarques sur les toponymes cités parfois dans ce nom d'année; 3/ Sîn-abûšu serait roi de la ville de Mankisum, d'après relecture d'une chronique assyrienne de Mari; 4/ le signe TIŠPAK figurant dans une forme verbale d'une tablette de Harmal (JCS 24 71:16) aurait la valeur bel, l'ensemble étant lu tu-ša-belx; 5/ analyse des diverses graphies de Sîn (den-zu) et d'Enlil (den-líl) et proposition de lecture systématique. - IDEM, Un testo di Ishchali con un interesse particolare", EVO 19, 1996, p. 83-87: trs et trd d'un texte de vente de sésame à crédit. Le prix total est payable en deux fois, ce qui justifie un “intérêt" de 4%. L'a. fait une rapide synthèse des pratiques du prêt à intérêt dans la Diyâla. - A. W. SJÖBERG, “CBS 11319+. An Old-Babylonian Schooltext from Nippur", ZA 83/1, 1993, p. 1-21: éd. complète d'une tablette bilingue rejointe mais encore fragmentaire, sans doute utilisée dans l'Edubba pour l'enseignement du sumérien. - IDEM, “Sumerian Texts and Fragments in the University of Pennsylvania Museum Related to Rulers of Isin", in: Fs Römer, p. 345-378: éd. en trs et commentaire de 7 fragments inédits complétant les hymnes royaux de l'époque d'Isin publiés par Römer. - M. STOL, “A Cultivation Contract", BSA V, 1990 (Irrigation and Cultivation in Mesopotamia, Part II), p. 197-200: éd. d'un contrat daté d'un roi de Larsa et provenant du sud de l'Irak. Le contrat précise les conditions d'exploitation d'un champ d'environ 48 ha (135 iku), notamment le type de culture pratiqué et la date à laquelle le travail doit être accompli. - IDEM, "Das Heiligtum einer Familie", in: Fs Wilcke, p. 293-300: éd. d'un texte de Sippar concernant un partage successoral effectué "dans le temple du dieu de leur ville et de leur(s) dieu(x)", ce qui laisse supposer que les intéressés viennent d'une autre ville. Les dieux familiaux évoqués ici pourraient être Sullat et Hanis. - IDEM, "A rescript of an Old Babylonian Letter", in: Fs Veenhof, p. 457-466: éd. d'une lettre de Yale se rattachant aux archives de Larsa. Il s'agit d'une copie d'une lettre de Lu-Ninurta à Šamaš-hâzir et Marduk-nâsir, qui enregistre l'attribution de champs à diverses personnes; elle est datée du 28-vi-Ha 35.
T - P. TALON, Old Babylonian Texts from Chagar Bazar, Akkadica Suppl. 10, 1997: éd. de 124 tablettes administratives contenant des listes de recensement, de distribution de rations et de travailleurs, et des reçus de denrées. Index complets. Introduction détaillée sur le recensement évoqué dans plusieurs textes, et sur les listes de travailleurs. - O. TAMMUZ, “Old Babylonian Bullae in the Israel Museum", NABU 1994/52: éd. complète de deux bulles administratives appartenant aux archives de Lagaba et datées de Samsu-iluna. - IDEM, “Two small archives from Lagaba", RA 90, 1996, p. 121-133: éd. de deux petits lots de textes paléo-babyloniens (lettres d'affaires et textes administratifs) provenant de Lagaba et datés du règne de Samsu-iluna. - M. TANRET, "As Years Went by in Sippar-Amnânum…", RAI 45, p. 455-466: étude des 4 textes chronologiques de l'archive d'Ur-Utu, concernant le règne d'Ammi-Saduqa. 2 listes allant respectivement jusqu'à AS 16 et 17 montrent une pratique consistant à recopier le nom de chaque nouvelle année de règne précédé de l'abréviation du nom de l'année précédente, la méthode permettant à Ur-Utu de classer les tablettes de son père Inanna-mansum. - S. TINNEY, The Nippur Lament, Royal Rhetoric and Divine Legitimation in the Reign of Išme Dagan of Isin (1953 1935 B.C.), Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 16, Philadelphie, 1996, xxii + 276 p., 26 fig. et 28 pl.: éd. complète d'une lamentation sur la ville de Nippur, de 323 ll., rédigé en sumérien, et connu par le biais de plusieurs copies d'époque paléo-babylonienne. La première partie rapporte la destruction de Nippur et les souffrance endurées par sa population. Dans la seconde partie, Enlil et Išme-Dagan sont louangés pour le retour de la paix et de la prospérité à Nippur et dans le pays de Sumer. Ce texte a été rédigé à l'époque d'Išme Dagan d'Isin, afin de légitimer l'extension de son hégémonie sur le pays de Sumer. - A. TSUKIMOTO, “From Lullû to Ebla. An Old Babylonian Document Concerning a Shipment of Horses", in: Fs Röllig, p. 407-412: éd. complète d'une tablette rédigée à Nihria et concernant l'envoi de 51 chevaux depuis le pays de Lullû jusqu'à Ebla. Les trois hommes chargés du transport n'ont pas dû acquitter la taxe lors de leur passage à Nihria, et furent traduits en justice, où ils durent jurer par “le poignard d'Aššur" et donner l'un des chevaux à la ville. - Ö. TUNCA, “Cylinder seal inscriptions of Šamši-Adad I and his officials from Acem höyük", in: Fs Özgüç, p. 481-483: éd. de cinq empreintes de sceaux figurant sur des bulles, quatre concernant Šamši-Adad et une de Lîter-šarrussu, serviteur du Šamši-Adad.
V - M. VAN DE MIEROOP, “Some New Texts From the Early Isin Craft Archive", ASJ 16, 1994, p. 201-205: éd. de trois tablettes de la New York Public Library, complétant le dossier des archives d'Isin, et signalées dans des notes de lecture de L. Oppenheim. - F. VAN KOPPEN, “L'expédition à Tilmun et la révolte des bédouins", MARI 8, 1997, p. 417-429: l'a. édite A.1333 (copie, trs. et trd.), lettre de Yasmah Addu à Hulâlum, qui s'ajoute au dossier relatif aux contacts diplomatiques entre le Royaume de Haute Mésopotamie et Tilmun, située dans le golfe arabo-persique. Ces contacts se placent durant les éponymats d'Awîliya et d'Addu bâni (1779 1778 av. J. C.), alors que le Royaume de Haute Mésopotamie devait faire face à une révolte de bédouins et de Turukkéens. - IDEM, "Sweeping the court and locking the gate: the Palace of Sippir-Sêrim", in: Fs Veenhof, p. 211-224: éd. de 4 textes de Sippar relatifs aux activités de fonctionnaires de Sippir-Sêrim (Abu-Habbah): 2 reçus d'argent compensant les absences de balayeurs (kisal-luh et munus-kisal-luh) de la cour du palais, une liste d'objets (apparemment les diverses parties d'un système de fermeture de porte) livrés par le chef des balayeurs, et une promesse de livraison d'armes par Awîl-mîšarum, nu-banda3, l'un des collecteurs de l'argent versé en compensation des absences. - IDEM, "Equids in Mari and Chagar Bazar", AOF 29, 2002, p. 19-30: sur les lectures akkadiennes des logogrammes anše-la-gu et anše-nun-na dans les textes de Samsi-Addu et Zimri-Lim, et les emplois des équidés au IIe millénaire. - IDEM, "Redeeming a Father's Seal", in: Fs Walker, p. 147-176: éd. d'une tablette de Sippar concernant la restitution de deux sceaux paternels au second fils d'un officier militaire après la mort de l'aîné qui les détenait. La possession des sceaux implique la responsabilité pour les dettes par les précédents détenteurs et restées impayées. Il s'ensuit que l'impression du sceau sur une tablette ne sert pas à identifier une partie mais à établir le lien d'obligation créé par le contrat. La clause sur la responsabilité rappelle les mesures prises en cas de perte de sceau. L'a. s'interroge sur la portée des pratiques de scellement à l'époque paléo-babylonienne, notamment l'emprunt d'un sceau par la partie contractante. Il évalue aussi la présence d'officiers militaires à Sippar et la question de la fortune familiale d'Ilsu-ibni, propriétaire initial des sceaux. - K. VAN LERBERGHE, “On Storage in Old-Babylonian Sippar", OLP 24, 1993, p. 29-40: éd. de 6 tablettes de Sippar. Les trois premières concernent la distribution ou le prêt d'orge par le grenier de la ville (natbâkum), sous le contrôle d'officiers municipaux. L'absence du šatammu, mentionné aux époques antérieures, signifie peut-être que cette fonction a disparu après Ammi-saduqa. Deux autres textes sont des prêts d'argent: l'un est consenti à Yakîtum par le temple pour qu'il achète de l'orge et qu'il rembourse sa dette à la moisson; l'autre est un texte-parsum, dans lequel la dette d'un mari pour le rite religieux accompli par sa femme, est payée par une caution. L'autorité recevant le paiement est laïque, contrairement à la compétence habituelle des temples en la matière. Ceci confirme que le palais tire profit des rituels destinés à Annunîtum. Le dernier document est une étiquette de panier contenant des tablettes d'Halhalla et Merigat. - IDEM, “The Ladies Amat-aja and Šât-aja, Business Associates under Hammurabi", OLP 25, 1994, p. 25: éd. de sept tablettes de location de champs appartenant à deux nadîtû de Sippar. Les contrats prévoient que le preneur est subrogé dans l'obligation des religieuses d'apporter plusieurs fois par an des offrandes rituelles. Trois transactions précisent que le bail prend effet “au moment de l'ouverture du canal d'irrigation", cette précision étant atypique dans ce genre de documents. - IDEM, “Kassites and Old Babylonian Society. A Reappraisal", in: Fs Lipinski, p. 379-393: éd. complète de trois tablettes de Sippar venant enrichir le dossier de la présence kassite en Babylonie dans la première moitié du IIe millénaire. L'a. fait le point sur les informations contenues dans les textes, présentés par ordre chronologique des rois paléo-babyloniens. - IDEM, “Old Babylonian Soldiers at Sabum", in: Fs Römer, p. 447-455: éd. complète de 3 tablettes contenant des listes de champs, dont une mentionne la ville de Sabum, située en Babylonie centrale. - K. VAN LERGERGHE et G. VOET, Sippar-Amnânum. The Ur-Utu Archive vol. 1, MHET I, 1991, xii + 191 p., 81 pl.: éd. complète d'une archive cohérente, appartenant à un nommé Ur-Utu, Grand Lamentateur de la déesse Annunîtum à Sippar-Amnânum. Le lot se compose de 106 tablettes et fragments, répartis en lettres et documents juridiques consistant notamment en achats et locations de champs, divers reçus, listes variées et peut-être une dot. - EIDEM, “An Old Babylonian Clone", in: Fs de Meyer, p. 159-168: éd. d'un duplicat de Philadelphie d'une tablette du British Museum, reproduisant un partage successoral. Un frère y attribue une partie de sa part à ses deux cadets, qui reçoivent chacun un exemplaire de la convention. - EIDEM, "A Poor Man of Sippar", AOF 24/1, 1997, p. 148-157: éd. en trs et trd d'une tablette des archives d'Ur-Utu, relatant les vissicitudes d'un nommé Ibni-Marduk, adopté par son oncle puis renié et deshérité. Poussé par la faim et la misère, il abandonne Sippar et sa famille, ainsi que les perspectives d'entrer dans le clergé d'Annunîtum, conformément à la tradition familiale. La tablette se présente comme une quasi-enveloppe, servant de duplicat à un original conservé en l'occurrence par les ayants droit de l'ex-adoptant. - W. H. VAN SOLDT, "A Note on Old Babylonian lû ittum, ‘Let Me Remind You'", ZA 82/1, 1992, p. 30-38: l'expression signifie "laisse-moi te rappeler que...", plutôt que "qu'il y ait un signe que " (R. Frankena) ou "c'est un fait connu que" (J.-M. Durand). - H. L. J. VANSTIPHOUT, "The man from Elam. A Reconsideration of Isbi-Erra ‘Hymn B'", JEOL 31, 1989-1990, p. 53-65: l'analyse formelle et littéraire de cette composition conduit l'a. à contester la qualification "hymne" qui lui est attribuée. Il s'agit plutôt, de par son but idéologique et son style, d'un genre proche des lamentations historiques. - K. VEENHOF, “Assyrian Commercial Activities in Old Babylonian Sippar. Some New Evidence", in: Fs Garelli, p. 287-303: éd. complète de 3 tablettes du British Museum, constituant des memorandums privés récapitulant les créances commerciales d'un nommé Warad-Sîn, marchand et usurier installé à Sippar, qui entretenait des relations étroites avec l'Assyrie, ayant peut-être été lui-même d'abord un marchand assyrien. - IDEM, "Fatherhood is a Matter of Opinion. An Old Babylonian Trial on Filiation and Service Duties", in: Fs Wilcke, p. 313-332: éd. d'un procès de Sippar dans lequel les autorités militaires réclament l'enrôlement d'un nommé Surârum au motif que son père, Sumum-libsi, servait déjà dans l'armée. L'oncle et la tante maternels de l'intimé récusent la filiation invoquée par les demandeurs, en niant l'existence du mariage et la paternité même de Sumum-libsi, faisant valoir que la mère de Surârum, célibataire, eut plusieurs amants mais jamais de mari. Le serment est déféré aux deux parties mais les demandeurs abandonnent l'instance et renoncent donc à enrôler Surârum. L'a. étudie le lieu de prestation du serment, son contenu et les emblèmes de Samas cités dans ce texte. Il s'interroge aussi sur la nature du service attendu de Surârum. - R. A. VEENKER, “Two Old Babylonian Contracts", in: Fs Astour, p. 519-525: éd. complète de deux contrats, l'un de Kish ou Ur, concernant un prêt, et l'autre de Sippar, contenant un contrat de fermage. - V. VERARDI, “À propos de ARM II, 115", NABU 1997/72: l'a. propose que Šimatum ait réclamé l'envoi d'un sceau cylindre à son père Zimrî Lîm dans ARM II 115, requête que l'on retrouve dans ARM X 95. - P. VILLARD, “Nomination d'un scheich", in: Gs Birot, p. 291-297: éd. d'une lettre envoyée au roi, où un nommé Yamsi-Hadnû s'adresse à Bannum, chef des bédouins (merhûm), pour qu'il intercède auprès de Zimrî-Lîm afin d'obtenir le poste de scheich-sugâgum. A la mort de Bannum, le cadeau remis par Yamsi-Hadnû n'était toujours pas parvenu au roi. - IDEM, "Parade militaire dans les jardins de Babylone", in: Fs Fleury, p. 137-151: éd. d'une lettre dans laquelle le général mariote Ibâl-pî-El rend compte à Zimri-Lim de la réception d'un contingent de soldats. Le texte met en relief l'importance de l'étiquette et du protocole, notamment à l'occasion du repas, des cadeaux offerts aux officiers et du déroulement de la parade militaire. - C. -A. VINCENTE, “The Tall Leilân Recension of the Sumerian King List", ZA 85/2, 1995, p. 234-270: éd. de la version OB de la Liste royale sumérienne écrite durant le règne de Hammurabi ou celui de Samsu-iluna. Le texte est composé à partir de deux ou trois manuscrits tirés d'une collection de sources prestigieuses établie par Samsi-Addu. Il fournit notamment la liste complète des rois de Mari.
W - N. WASSERMAN, “An Old-Babylonian Medical Text against the kurârum Disease", RA 90, 1996, p. 1-5: publication d'une tablette inédite provenant de Tell Haddad (l'ancienne Me-Turan) contenant une prescription contre les furoncles, et sans aucun parallèle connu. - C. WILCKE, “Nanâja-šamhats Rechtsstreit um ihre Freiheit", in: Fs Röllig, p. 413-429: trscr. avec collation, trd et commentaire de la longue tablette BBVOT 1 n° 23, datée de Abi-ešuh, concernant le procès intenté par Nanâya-šamhat asservie au créancier Hazippa en remboursement d'une dette de sa défunte mère. La plaignante, voulant recouvrer sa liberté, fait comparaître comme témoins les membres de sa famille paternelle et maternelle pour attester sa filiation, contre son adversaire qui prétend l'avoir adoptée, puis déclare l'avoir achetée comme servante. Les témoins de Hazippa étant incapables de prouver ses dires. Le document confirme que la servitude pour dette, par définition temporaire, ne peut être abusivement prolongée. - Y. WU, “Two OB Tablets and the sale document formula šám-til-la-ni(or -bi)-šè", NABU 1993/79: éd. complète de deux tablettes issues de collections privées. La première est un contrat de vente foncière provenant sans doute de Girsu et datée de Sumu-E. A partir de ce texte, l'a. examine les emplois paléo-babyloniens de la formule sumérienne dans les traditions scribales de Nippur-Isin d'une part (“pour son (sum. -bi) prix complet") et de Ur-Larsa d'autre part (“pour son (sum. -ni) prix complet"). La seconde tablette est une liste de noms propres.
Y - W. YUHONG, “The Treaty between Shadlash (Sumu-Numhin) and Neribtum (Hammi-dushur)", JAC 9, 1994, p. 124-136: nouvelle éd. du premier traité mésopotamien, dont la date est incertaine, conclu entre les villes de Šadlaš et Neribtum, sans doute après une guerre entre les deux cités. Contenu: prix de vente des esclaves; conditions de libération des réfugiés, des captifs et des personnes détenues en gage (rapproché de CH 279-281); montant des amendes pour l'homicide d'un homme libre - une mine d'argent - ou d'un esclave - une demi-mine - (rapproché de LE 47A, donné en translitt. et trad.); mort de l'accusateur isolé qui échoue dans un procès capital, et amende payée par les éventuels complices (l'a. semble considérer cette amende comme un rachat de la peine de mort, ce que le texte n'indique pas; cf. ll. 24-27); libération des gages détenus par chaque ville “avant la guerre"; application de la loi personnelle de chaque partie en cas de vol; remboursement des prêts récents ou anciens d'argent, céréales et denrées, et protection des biens contre les crédits “sauvages" (rapproché de CH 113, interdisant le prêt consenti grâce aux biens d'un tiers sans son consentement); libération des prisonniers de guerre des deux camps. - IDEM, “urruru (D stem of arâru B) “to frighten" in TCL 18 90", NABU 1995/97: l'a. complète la notice du CAD s.v. arâru B par une lettre paléo-babylonienne adressée par Ili-iddinam, la ville et les Anciens à un nommé Šega-Enlilla, peut-être un juge, dans laquelle les expéditeurs plaident pour l'innocence de deux prévenus (l'un pour un vol et l'autre pour une infraction non précisée). On relèvera la mention d'une incarcération préventive pendant la poursuite de l'enquête.
Z - N. ZIEGLER, “Deux esclaves en fuite à Mari", in: Gs Birot, p. 11-21: éd. complète d'une tablette parallèle à ARMT XIII, 26, relatant une autre version de la fuite de deux esclaves du palais. Ces textes apportent des informations topographiques sur la ville elle-même, notamment l'existence d'un “mur du milieu", séparant la glacière de l'enceinte fortifiée de Mari. - EADEM, “Ein Bittbrief eines Händlers", in: Fs Hirsch, WZKM 86, 1996, 479-488: éd. complète d'une lettre (joint de J.-M. Durand) dont le nom de l'auteur est perdu et qui, sous prétexte de demander de matériels divers, aligne les formules de politesse sans doute pour rentrer en bonnes grâces auprès du roi. - EADEM, “L'armée, quel monstre!", in: Gs Barrelet, p. 145-152: joint à ARM IV 85, une lettre de Išme-Dagan à Yasmah-Addu lui demandant des informations sur la stratégie militaire des Ešnunéens, informations devant rester confidentielles au titre du secret militaire. – EADEM, Le harem de Zimrî-Lîm, Florilegium Marianum IV, Mémoires de NABU 5, Paris, 1999: étude prosopographique de la composition du harem de Zimrî-Lîm à partir de l'éd. complète de 59 tablettes administrative, avec d'utiles renvois au commentaire général. L'étude montre la composition précise de la population féminine du palais, et l'organisation hiérarchique des femmes dans le harem. Plusieurs conclusions décisives contribuent à une meilleure connaissance de cette institution, longtemps imprégnée de références au monde musulman. Le roi vit dans un environnement majoritairement féminin, dont les structures rappellent beaucoup celles des temples.
A - M. ANBAR, "Mari and the Origin of Prophecy", in: Gs Kutscher, p. 1-5: relecture de 3 textes d'ARMT XXVI, n° 206, 216 et 371 et interprétation à la lumière des parallèles bibliques. - IDEM, “Les milieux de vie de deux motifs dans le récit de l'Exode illustrés par les Archives Royales de Mari", in: Fs Lipinski, p. 11-17: les thèmes du guide terrestre et du guide divin utilisés dans le récit de la traversée du désert par les fils d'Israël sont déjà attestés dans la documentation de Mari: ARM II, 130 mentionne l'Ange protecteur (lamassatum/lamassum); ARM I, 85 + joint A. 1882 (J.-M. Durand) fait des Fils du désert des éclaireurs pour reconnaître une route désertique. - IDEM, "Les sentiments religieux dans la correspondance de Zimri-Lim, roi de Mari, et de ses fonctionnaires", in: Gs Cagni, vol. I, p. 1-11: les références aux divinités dans la correspondance royale de Mari ne font que rarement apparaître les sentiments religieux personnels de leur auteur. - D. ARNAUD, "Le panthéon de l'Ebabbar de Larsa à l'époque paléo-babylonienne", in: Fs Huot, p. 21-32: l'étude des textes concernant l'administration du temple de Larsa montre que l'Ebabbar n'abritait pas la totalité des divinités du panthéon mais seulement la moitié. Par ailleurs, la hiérarchie du panthéon civique diffère de celle du sanctuaire, donnant la prééminence à Sîn et non à Samas. Ces éléments accentuent la séparation entre monde profane et monde sacré, le temple étant non seulement autonome physiquement et autarcique économiquement, mais encore isolé du reste de la cité sur le plan religieux.
C - D. CHARPIN, "Le contexte historique et géographique des prophéties dans les textes retrouvés à Mari", BCSMS 23, 1992, p. 21-31: panorama du prophétisme à partir de la cinquantaine de textes de Mari consacrés à cette question, documentant la présence d'un personnel spécialisé, la possibilité de consultations divergentes, l'absence de prophéties sous le règne de Yasmah-Addu et l'origine occidentale de telles pratiques. - IDEM, “Inanna/Eštar, divinité poliade d'Uruk à l'époque paléo-babylonienne", NABU 1994/39: Inanna/Ištar (AN.dINANNA) était, à l'époque paléo-babylonienne, la divinité principale d'Uruk, le culte d'Anu n'étant que secondaire. - IDEM, "Le roi est mort, vive le roi", NABU 2001/42: à propos de 2 formules de noms d'années d'Apil-Sîn, se référant aux pratiques rituelles entourant la mort d'un roi: la fin du deuil pour le roi précédent est marquée par des ablutions rituelles, évoquées aussi dans AbB 12 172 à propos de la proclamation de la mîšarum par Abi-ešuh, lors de son avènement. - IDEM, « De la bière pour une femme qui vient d’accoucher », NABU 2004/80 : sur le sens « accoucher » du verbe šalâmum et un compte rendu administratif qui mentionne une forte ration de bière pour une femme venant de mettre au monde un enfant. L’a. rappelle que la bière favorise la lactation, ce qui explique l’attribution de bière aux nourrices à Mari. - IDEM, « Mois
intercalaire et fêtes religieuse : de Mari à Babylone, du deuxième au
premier millénaire », NABU 2005/35 : l’a. compare un épisode de
l’histoire néo-assyrienne à un événement ayant eu lieu dans la Mari
amorrite. A ces deux occasions différentes, le pouvoir politique
envisage l’intercalation d’un mois supplémentaire pour pouvoir
respecter le calendrier religieux.
D - R. L. VOS, “A Note on the Ritual Background of Sending the Hem and the Lock of Hair”, JEOL 40, 2007, p. 121-123 : l’a. revient sur le geste consistant à faire parvenir un pan de son habit et une mèche de cheveux à Mari. Dans la lettre ARMT XXVI/1.204, on mentionne la nécessité de purifier ces deux objets symbolisant une personne. Cette purification est, d’après l’a., un préalable indispensable à toute interrogation oraculaire. - J. -M. DURAND, “Le mythologème du combat entre le dieu de l'orage et la mer en Mésopotamie", MARI 7, 1993, p. 41-61: éd. d'une tablette de Mari qui révèle que le mythe fondateur du combat entre Marduk et Ti’amat (l'orage et la mer), attesté dans la Babylonie cassite et à Ugarit, était déjà connu à l'époque amorrite. Le texte a une portée politique spectaculaire en ce qu'il révèle une conception de la royauté fondée sur le rite de l'onction, désormais documenté explicitement pour la Mésopotamie, et la justice constituant la première mission du roi. On retrouve ainsi les bases de la souveraineté médiévale, jusqu'ici attribuée aux précédents bibliques. - IDEM, “Les prophéties des textes de Mari", in: Oracles, p. 115-134: la prophétie se présente sous la forme d'inspiration ou de rêve; dans ce dernier cas, les textes de Mari documentent le rôle d'Itûr-Mêr et d'Aštabi-El. Provoqué ou subi, le message du dieu est toujours explicite et c'est la raison pour laquelle, il n'y a pas de technicien de la prophétie. A Mari, la prophétie est liée au contexte historique. - IDEM, “La divination par les oiseaux", MARI 8, 1997, p. 273-282: analyse des traits proprement amorrites de la divination par les oiseaux, d'après notamment le lexique de la parenté, les noms des divinités et les ex-votos réclamés. - IDEM, Le culte d'Addu d'Alep et l'affaire d'Alahtum, FM VII, 2002, 188 p.: la figure du dieu Addu d'Alep sert de fil conducteur pour aborder un pan de l'histoire politique de Mari et sa région. La première partie présente les implications culturelles, religieuses et politiques du culte d'Addu dans le Proche-Orient amorrite, à travers notamment 1) la mission diplomatique de Dâriš-lîbûr au Yamhad (dont il était peut-être originaire) au début du règne de Zimrî-Lîm, après la révolte benjaminite , et 2) les deux missions du chef de musique Warad-ili-šu auprès de Yarîm-Lîm d'abord pour lui apporter l'ex-voto du roi de Mari, et de Hammu-rabi d'Alep ensuite pour préparer la venue des troupes d'Alep à Babylone. La seconde partie étudie le dossier de l'acquisition d'Alahtum par Zimrî-Lîm, dans ses aspects historiques et géographiques, juridiques, économiques et culturels. L'a. présente entre autres le processus d'acquisition des terres et le conflit avec Gašera, la reine-mère, qui se prévaut d'une andurârum pour réclamer la restitution d'une partie du domaine. - IDEM, "Un rite hépatoscopique et le roi Šarrum-kîma-kali.ma", NABU 2005/98 : sur le terme akkadien zirqum pour désigner une sorte d’ovin. D’après le contexte il est possible de le considérer comme un animal sacrificiel destiné à l’extispicine. Le conditionnement de ce mouton divinatoire comprendrait un rite de lustration, ce qui lui aurait donné le nom de zirqum. - IDEM, "Le dieu majeur de Qatna", NABU 2006/4, n°87: l'a. étudie l'inscription d'un sceau-cylindre mentionnant le roi de Qatna Išhî-Addu. Cette inscription comprend en effet une invocation à Addu, ce qui tend à indiquer que ce dieu devait être le chef du panthéon officiel de cette ville. - IDEM, « Un rite hépatoscopique et le roi Šarrum-kîma-kali.ma », NABU 2005/98 : sur le terme akkadien zirqum pour désigner une sorte d’ovin. D’après le contexte il est possible de le considérer comme un animal sacrificiel destiné à l’extispicine. Le conditionnement de ce mouton divinatoire comprendrait un rite de lustration, ce qui lui aurait donné le nom de zirqum. - J. -M. DURAND et M. GUICHARD, “Les rituels de Mari", in: Gs Barrelet, p. 19-78: rééd. du rituel d'Eštar et du rituel du kispum, et éd. complète du rituel d'Eštar d'Irradân et du rituel du humtûm, le tout précédé d'une introduction détaillée sur les textes littéraire à Mari. - C. B. DYCKHOFF, "Priester und Priesterinnen im altbabylonischen Larsa. Das Amtsarchiv als Grundlage für prosopographische Forschung", RAI 47, p. 123-127: les tablettes issues des fouilles clandestines entre 1896 et 1923 proviennent non pas d'archives privées dispersées mais d'une seule et même “archive professionnelle", conservée dans un lieu unique (peut-être le bâtiment B 22 du site) et rassemblant indistinctement les documents privés et officiels de personnages importants de Larsa (eg Šêp-Sîn ou Abu-waqar).
G - J. –J. GLASSNER, "L’aruspicine paléo-babylonienne et le témoignage des sources de Mari", ZA 94, 2004, p. 276-300 : sur la tradition mariote de l’haruspicine. L’a. se penche sur la lexicographie issue de la correspondance et met en évidence les spécificités de la pratique locale de cette science divinatoire. - M. GUICHARD, “La visite d'un prêtre de Dame-Nagar à Mari", NABU 1995/51: exploitation des informations historiques fournies par ARM XXI 370, à propos du statut du grand prêtre (šangûm) de Dame-Nagar et des relations entre les royaumes de Haute Mésopotamie et Mari. La statue de la déesse fut sans doute transportée à Mari lors d'une fête religieuse, à l'occasion de laquelle le grand prêtre reçut deux étoffes. La mention de ce personnage parmi les noms de plusieurs souverains indique qu'il occupait un rang élevé, peut-être investi de la plus haute autorité sur sa ville. - IDEM, “Présages fortuits à Mari (copies et ajouts à ARMT XXVI/1)", MARI 8, 1997, p. 305-328: outre les copies de sept textes édités dans ARM XXVI/1, l'a. édite une tablette concernant une naissance anormale d'un ovin (izbum) et réunit un petit dossier de tablettes inédites illustrant l'intérêt des Mariotes pour certaines espèces animales (fourmis, lions, autruches) dont l'apparition fortuite faisait l'objet de spéculations oraculaires. - IDEM, “Zimrî-Lîm à Nagar", MARI 8, 1997, p. 329-337: éd. de deux tablettes illustrant les liens cultuels entre Mari et Nagar, et analyse de la coexistence des cultes de divinités anthropomorphes avec des cultes naturalistes, représentés notamment par les bétyles. - IDEM, "Les aspects religieux de la guerre à Mari", in: Traditions amorrites, p. 27-48: remarques sur la "culture de la guerre" d'après les sources de Mari et sur son caractère "sacré". L'a. évoque les ordres divins d'aller à la guerre, les modes de préparation du combat, l'espionnage, les rituels précédant les combats, les conditions de partage du butin, les massacres, le destin des morts après les combats, l'asile recherché par ceux qui veulent échapper au vainqueur. Il évoque en conclusion le herem biblique, mais pour affirmer qu'on ne trouve pas de parallèle exact de cette notion à Mari.
H - W. HEIMPEL, “The River Ordeal in Hit", RA 90, 1996, p. 7-18: l'a. propose que l'ordalie fluviale de Hît, désormais bien connue grâce aux textes de Mari, n'ait pas eu lieu dans l'Euphrate, mais dans l'une des nombreuses sources de bitume de la région, où le patient aurait eu à combattre fumées toxiques et températures élevées. Ainsi le “rejet" des personnes soumises à l'ordalie ne décrirait pas leur mort mais leur survie. L'a. rediscute également le phénomène des ordalies doubles, qui permettent équitablement à chaque partie d'établir leur propre bonne foi. - J. -G. HEINTZ, “Des textes sémitiques anciens à la Bible hébraïque: un comparatisme légitime?", in: F. Boespflug et F. Dunand (éd. ), Le comparatisme en histoire des religions, Paris, 1997, p. 127-156: étude de Deut. XII 11 à la lumière de EA 287 et 288; étude d'une lettre de Mari (A. 1968) dans la perspective d'une possible fête du couronnement israélite. - IDEM, “La fin des prophètes bibliques? Nouvelles théories et documents sémitiques anciens", in: Oracles, p. 195-214.: une tendance récente critique de la recherche considère les textes de la Bible hébraïque relatifs au phénomène prophétique comme des constructions littéraires tardives et réfute leur existence historiques. L'examen des textes extra-bibliques tels que les textes prophétiques de Mari, en particulier AEM 1/1 216 et AEM 1/1 206, invite à repenser la question des origines du prophétisme.
J - C. JANSSEN, "e´iltam patârum: awat hadê!", RAI 36, p. 77-107: la racine j´l recouvre la notion de "responsabilité" . Les archives d'Ur-Utu montrent que cette responsabilité peut être liée aux fonctions du Grand Lamentateur, ou qu'elle peut être transférée sur sa personne. Ce personnage assume donc un rôle de bouc émissaire ou d'intermédiaire entre les dieux et les coupables de fautes à caractère religieux.
K - J. -R. KUPPER, “Les formules de malédiction dans les inscriptions royales de l'époque paléo-babylonienne", RA 84, 1990, p. 157-163: les malédiction inscrites dans les inscriptions royales sont une innovation de l'époque d'Agadé, mais deviennent un véritable genre littéraire à l'époque paléo-babylonienne, consacré et illustré dans le CH. - IDEM, “Le rituel elûnum", NABU 1996/32: trois textes de Mari montrent que la particularité de ce rituel consiste à faire parvenir au souverain des morceaux de l'animal sacrifié au cours de la cérémonie, pour manifester la participation directe du roi, même à distance, à ce rituel.
L - B. LAFONT, "Sacrifices et rituels à Mari et dans la Bible", in: Traditions amorrites, p. 57-77: les sacrifices en Mésopotamie et en Israël paraissent s'opposer dans leurs formes et leurs fonctions. Certains aspects des rituels et sacrifices attestés dans la documentation de Mari semblent se trouver à mi-chemin entre les traditions proprement suméro-assyro-babyloniennes et les traditions bibliques. Mari montre un lien fort entre sacrifice et divination ou encore l'importance des onctions d'huile. L'a. dresse la liste des occasions de sacrifices et rituels à Mari, étudie les quatre grands textes de rituels attestés à Mari, et propose une synthèse des informations épistolaires sur les sacrifices et rituels. Enfin sont examinés deux cas de sacrifices sanglants: le sacrifice de béliers sur une pierre du type humûsum et le sacrifice d'ânons dans le cadre de rituels d'alliance. L'a. conclut sur l'importance du sang versé à Mari comme dans la Bible. - A. LEMAIRE, "Traditions amorrites et Bible: le prophétisme", in: Traditions amorrites, p. 49-56: comparaison entre prophétisme mariote et prophétisme israélite, d'après plusieurs études récentes (Durand, Sasson, Malamat, Heintz). L'a. prône un élargissement de l'étude du phénomène prophétique au-delà de Mari et des capitales des royaumes d'Israël et de Juda, pour prendre en compte l'ensemble du Proche-Orient et du monde sémitique. - IDEM, “Les textes prophétiques de Mari dans leurs relations avec l’Ouest", Amurru I, p. 427-438.: l’a. confirme, après J.-M. Durand (ARMT XXVI/1), que le prophétisme est fondamentalement un phénomène commun à Mari et au monde ouest-sémitique.Il distingue néanmoins quelques différences. L’hépatoscopie, pratique courante à Mari, est absente voire inexistante dans le monde ouest-sémitique. Le prophétisme féminin n’y possède pas non plus le rôle prépondérant qu’il joue à Mari. Les groupes de prophètes constituent une composante importante dans l’ancien Israël, alors que dans la documentation mariote, une telle structure n’est attestée qu’une fois. Enfin, les oracles mariotes sont généralement destinés au roi alors que dans la littérature prophétique biblique, ils s’adressent à un éventail d’individus beaucoup plus large. Il reste à se demander si ces différences doivent être imputées à la documentation actuelle ou si elles reflètent réellement une diversité de cultures.
M - A. MALAMAT, “ A Note on the Ritual of Treaty Making in Mari and the Bible", Israel Exploration Journal 45, 1995, p. 226-229: sur les pratiques de sacrifices d'animaux dans le cadre de la conclusion d'une alliance à Mari et dans la Bible. - IDEM, "Addendum to Luigi Cagni's Collection of Mari Prophecies", in: Gs Cagni, vol. II, p. 631-634: il faut ajouter au corpus des prophéties de Mari étudié par L. Cagni les textes ARM 26/1 243 et ARM 27 32. - W. L. MORAN, “An Ancient Prophetic Oracle", in: Fs Lohfink, p. 252-259: étude d'un texte d'Ishchali contenant un oracle de la déesse Kititum à Ibal-pî-El, roi d'Ešnunna, édité par M. DeJong Ellis dans MARI 5.
N - I. NAKATA, “On the Official Pantheon of the Old Babylonian City of Mari as Reflected in the Record of Issuance of Sacrificial Animals", ASJ 13, 1991, p. 249-258: la “liste du Panthéon" de Dossin est en fait, à la lumière des textes d'ARMT XXI et d'ARM XXIII, une liste de petits animaux livrés au sacrifice. - C. NICOLLE et V. VERARDI, "Des oiseaux pour les dieux", NABU 2006/4, n°92: les a. signalent la découverte d'une dizaine de squelettes d'oiseaux sous la première assise des murs du temple paléo-babylonien de Tell Mohammed Diyab. Les a. pensent qu'il s'agit des restes d'un rituel de fondation, rapprochant cette pratique des sacrifices d'oiseaux attestés dans les textes de Mari. Il faut toutefois noter que, du moins à ma connaissance, c'est la première fois que ce type de sacrifice serait employé dans un contexte de rituel de fondation. Au Kizzuwatna et Syrie du Nord, les sacrifices d'oiseaux sont le plus souvent liés à des rituels de propitiation voire d'expiation. Ce nouveau témoignage apporte donc une lumière différente sur ce type de sacrifice sanglant.
R - K. REITER, “Altbabylonische Verträge unter Beachtung günstiger Tage", MARI 7, 1993, p. 359-363: la conclusion des alliances politiques et diplomatiques par des gestes rituels (action de se laver les mains, de se toucher la gorge, de prêter serment par les dieux et d'élever ses mains vers la divinité) dépendait d'observations hémérologiques favorables.
S - J. SASSON, “Divine divide: re FM 2: 71: 5", NABU 1994/42: comme en arabe et en hébreu, le verbe qasâmum a deux sens à Mari, “pratiquer la divination" et “diviser" dans le cadre d'une interrogation oraculaire. - IDEM, "The Posting of Letters with Divine Messages", in: Gs Birot, p. 299-316: étude du rôle des intermédiaires chargés de transmettre au roi le contenu des prophéties. L'a. souligne l'intervention des femmes, et notamment l'influence de Šiptu, épouse de Zimrî-Lîm, pour les oracles pris à Mari. Au contraire, les prophéties prises en province ou à l'étranger sont transmises par des intermédiaires très variables. - IDEM, “Mari Apocalypticism Revisited", in: Fs Lipinski, p. 285-298: à propos d'ARM 26: 208 et 196, deux exemples de références “apocalyptisantes" où les crises politiques annonçant la chute de Mari sont interprétées comme les reflets de tensions dans le monde divin. - IDEM, “Water beneath Straw: Adventures of a Prophetic Phrase in the Mari Archives", in: Fs Greenfield, p. 599-608: analyse des trois versions différentes d'un même oracle de Dagan de Terqa transmis à Zimrî-Lîm par trois personnages distincts. Seule la phrase “Sous la paille coule l'eau" figure dans les trois récits, sans doute parce qu'elle a frappé les intéressés qui ne l'ont pas comprise. Les variantes tiennent à l'interprétation de chacun du message délivré oralement, dont aucun original n'existe. - IDEM, "Ancestors divine?", in: Fs Veenhof, p. 413-428: 5 noms de divinités, Aštabi-El, Ikrub-El, Itûr-Mer, Tašqi-Mama et Tar'am-El, pourraient être ceux d'ancêtres divinisés, même s'il n'existe pour l'instant aucune attestation de personnages historiques portant ces noms. L'a. étudie la formation de ces noms divins et leurs usages, la présence de ces divinités dans les fêtes, cérémonies et rituels. - A. SCHART, “Combining Prophetic Oracles in Mari Letters and Jeremiah 36", JANES 23, 1995, p. 75-93: sur les points communs entre les prophéties de Mari et celles du livre de Jérémie, notamment l'oralité du message délivré et le rôle des officiers palatins comme intermédiaires. - M. STRECK, “-ussu, lâtu, Ellipsen und ARM 2, 77:9", NABU 1993/108: l'a. conteste, sur des arguments philologiques la relecture d'ARM 2, 77 proposée par K. Reiter dans MARI 7 (v. supra) établissant un lien entre la conclusion des traités et les observations hémérologiques.
V - K. VAN DER TOORN, “Migration and the Spread of Local Cults", in: Fs Lipinski, p. 365-377: le transport des divinités familiales par les émigrés à l'époque paléo-babylonienne et en Israël permet de maintenir l'identité culturelle en terre étrangère et favorise le développement de certains cultes hors de son lieu d'origine. - N. C. VELDHUIS, “The heartgrass and related matters", OLP 21, 1990, p. 27-44: analyse des textes magiques paléo-babyloniens de YOS XI, montrant que la maladie est une violation de l'ordre cosmique qui doit être éradiquée à ce titre. - IDEM, “The Fly, the Worm, and the Chain. Old Babylonian Chain Incantations", OLP 24, 1993, p. 41-64: éd. de deux incantations contre les mouches et contre les vers et étude des chaînes incantatoires, dans leur aspect littéraire et sémantique.
W - Y. WU, “Kill a Donkey or a Dog for Making an Alliance, an Explanation according to the Practices in Ancient China", NABU 1995/17: la comparaison entre les pratiques d'alliance mésopotamiennes et chinoises (entre 2100 et 216 av. J.-C.) suggère, pour le monde amorrite, l'existence d'une hiérarchie dans le choix des animaux sacrifiés.
Y - N. YOFFEE, “The Economics of Ritual at Late Old Babylonian Kish", JESHO 41, 1998, p. 312-343: étude d'une petite archive administrative de Kish (une trentaine de textes), issue de la comptabilité du “responsable des femmes-kezertu" sur le paiement de la taxe-kezertu. L'a. se penche sur les fonctions rituelles de ces femmes, sur les activités de gestion du “responsable des femmes-kezertu" et conteste la traduction “prostituée" pour ce terme.
Z - N. ZIEGLER et N. WASSERMAN, “Qâtum ba’’îtum. A Check-list", NABU 1994/30: l'expression désigne une liste récapitulative, et apparaît dans le vocabulaire administratif et sapiential où elle exprime l'idée d'une destinée irréversible décidée par les dieux.
|