





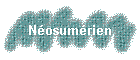

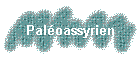
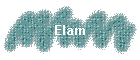


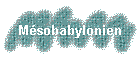
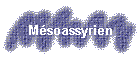



A - P. ARTZI, “The Middle-Assyrian Kingdom as Precursor to the Assyrian Empire", RAI 39, p. 3-6: l'a. analyse l'expansion assyrienne du milieu du IIe millénaire à travers les deux siècles de campagnes militaires (1466-1250) et la volonté hégémonique qui en découle, annoçant l'empire.
C - E. CANCIK-KIRSCHBAUM, “Rechtfertigung von politischem Handel in Assyrien im 13./12. Jh. v.Chr.", in: Fs Röllig, p. 69-77: analyse des Annales de Tiglat-phalazar Ier (fin XIIe s.) et de l'épopée de Tukulti-Ninurta (fin XIIIe s.), pour montrer que les actes politiques royaux y sont présentés non pas seulement comme des exemples historiques, mais comme des modèles de référence, justifiant une conception militaire du pouvoir dans laquelle la domination assyrienne issue des guerres de conquête est présentée comme une entreprise de pacification. - EADEM, “Nebenlinien des assyrischen Königshauses in der 2. Hälfte des 2. Jts. v. Chr.", AOF 26, 1999, p. 210-222: la reconstruction de la généalogie des rois assyriens montre que la monarchie repose sur un principe de transmission du pouvoir à l'intérieur de la famille. Les frères du souverain et leur descendance constituaient de grandes “maisons" qui fournissaient l'élite de l'administration étatique. L'influence de ces collatéraux dans la vie politique et institutionnelle est illustrée par les exemples de Ilî-ipadâ, Bêr-nâdin-ahhê et Bâbu-aha-iddina. - EADEM, "Organisation und Verwaltung von Grenzgebieten in mittelassyrischer Zeit: die Westgrenze", RAI 44, vol. 2, p. 5-8: l'organisation administrative du royaume subit des modifications fondamentales au cours du XIIe s. av. J.-C. Les districts périphériques sont remplacés par de petits Etats clients qui se définissent géographiquement dans la titulature de leurs rois. L'ambition d'un pouvoir universel exprimée par le titre šar kiššati échoua à cause de l'incapacité des souverains assyriens à maintenir durablement l'autorité impériale dans les zones de marche du royaume. - EADEM, Die Assyrer, Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Munich, 2003, 128 p.: manuel d'introduction à l'histoire des Assyriens depuis le début du IIe millénaire jusqu'à la chute de l'empire au VIIe s.
D - V. DONBAZ, “The Date of the Eponym Nabû-bêla-usur", in: Fs Garelli, p. 73-80: éd. de 3 tablettes méso-assyriennes permettant de placer l'éponyme Nabû-bêla-usur sous le règne de Salmanazar Ier et non de Tukulti-Ninurta Ier.
F - H. FREYDANK, Beiträge zur mittelassyrischen Chronologie und Geschichte, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 21, 1991, 227 p., index: faute de liste d'éponymes mésoassyriens, la chronologie de cette époque est reconstruite à partir des documents datés des 300 noms de lîmu connus depuis Salmanazar jusqu'à Tiglath-phalazar. Le but de cette démarche est de reconstituer les structures sociales et les comportements économiques. - IDEM, “Zum mittelassyrischen Königsbrief KBo XXVIII 61-64", AOF 18/1, 1991, p. 23-31: étude d'une lettre expédiée par Tukulti-Ninurta Ier à un inconnu, et traitant des démêlés du roi avec Babylone.
G - A. K. GRAYSON, Assyrian Rulers of the Early First Millenium B.C. (1114-895 B.C.), RIMA 2, 1990, xix + 425 p., bibliogr.: translittération et traduction des inscriptions royales depuis Tiglath-phalazar Ier jusqu'à Aššur-nasirpal II. Les textes attestent les réformes de stratégie, de politique et d'administration opérées par les souverains, et reprennent régulièrement les thèmes relatifs à la reconstruction de la prospérité assyrienne et aux conquêtes militaires.
K - C. KÜHNE, “Aspects of the Middle Assyrian Harbu Archive", SAAB 10/2, 1996, p. 3-7: l'analyse des restes d'une archive administrative de Tell Chuêra (= Harbu) datant de la fin du règne de Tukulti-Ninurta Ier, montre que le représentant du pouvoir central (bêl pahête) est responsable de l'odre public, des transports, des grands travaux et de l'encadrement des travailleurs. Un officier supérieur supervise la région (pâhatâtu) sans empêcher pour autant les contacts directs avec la capitale.
M - P. MARELLO, "Les femmes et le palais", in: Fastes, p. 50-55: sur l'organisation du harem d'après l'édit de Tiglath-phalazar Ier. - M. G. MASETTI-ROUAULT, “Syriens et Assyriens dans la Djéziré, XIVème-IXème siècle av. J.-C.", Subartu IV/2, 1998, p. 223-242: l'a. retrace les relations politiques et l'implantation progressive des Assyriens en Djéziré, constituant une véritable colonisation destinée à éliminer les anciennes élites locales mitanniennes au profit des grandes familles assyriennes. La décolonisation se manifeste par la création de royaumes locaux araméens, selon un processus de “créolisation" déjà constaté en Syrie occidentale ou dans la haute vallée de l'Euphrate avec la réorganisation des états néo-hittites ou syro-hittites. - D. MORANDI, "Stele e statue reali assire: localizzazione, diffusione e implicazioni ideologiche", Mesopotamia 23, 1988, 105-155: les déplacements des stèles et des statues royales permettent de reconstruire la progression des conquêtes assyriennes. L'a. examine aussi les implications idéologiques de la statuaire, qui exalte la personnalité du roi.
S - H. SADER, "The Aramean Kingdoms of Syria. Origin and Formation Processes", in: Syria, p. 61-76: les textes des annales royales et l'archéologie montrent que les ahlamû sont des Araméens qui ont fondé les Etats syriens attestés dès le Xe s. autour de l'Euphrate. Ils s'installent pacifiquement vers les XIe-Xe s. en se regroupant par clans, sans que soit attesté un processus de conquêtes militaires, sauf pour Damas. Avec l'expansion territoriale, l'urbanisation et la royauté héréditaire, le sentiment ethnique s'affaiblit à partir du Xe s. La centralisation monarchique des IXe-VIIIe s. est marquée par la construction de nouvelles capitales et une concentration du pouvoir politique et administratif.
W - Y. WU, “Did the Assyrian King List attempt to prove the legitimacy of Šamši-Adad?", JAC 5, 1990, p. 25-37: la Liste royale assyrienne, composée à l'époque médio-assyrienne, a été recopiée souvent et longtemps après sa composition, d'où des erreurs dans la généalogie de Šamši-Adad, dont le frère, Aminum, a été pris pour le père de Sulili, premier roi de la dynastie paléo-assyrienne. Il n'y aurait donc pas de falsification délibérée destinée à légitimer Šamši-Adad, mais plutôt des maladresses de copistes.
Y - S. YAMADA, “The Editorial History of the Assyrian King List", ZA 84/1, 1994, p. 11-37: la structure littéraire hétérogène de la Liste Royale assyrienne montre que l'œuvre n'a pas été composée en une seule fois à l'époque méso-assyrienne, mais qu'elle résulte d'une succession de rédactions et d'adjonctions s'étalant sur un millénaire à partir du règne de Šamši-Addad. L'expression “fils de personne" et l'absence de certains rois sur la liste reflèteraient un remaniement de la Liste vers les XVIe-XVe s., après une période d'anarchie. La Liste aurait été canonisée à partir du XIVe s. et mise à jour jusqu'à Sargon II.
Z - R. ZADOK, "Elements of Aramean Pre-History", in: Fs Tadmor, p. 104-117: point sur les éléments historiques, politiques et linguistiques permettant de retracer la préhistoire araméenne, depuis le milieu du XVIe s. jusqu'à 1111, date de la pacification de la Djéziré, majoritairement araméenne, par Tiglath-phalazar.
L - J. LLOP, "Ein weiterer Beleg für den mA Ortsnamen Sa-Sîn-rabi", NABU 2002/35: MARV 3 1:I 1-9 et A 2824 publié par Donbaz montrent que la ville de Sa-Sîn-rabi se trouve au sud de Kalhu.
N - N. NA’AMAN, “Assyrian Chronicle Fragment 4 and the Location of Idu", RA 88/1, 1994, p. 33-35: la restitution des ll. 11-12 de la Chronique Assyrienne permet de situer la province d'Idu, à l'époque médio-assyrienne, sur le Tigre au nord de Ninive.
A - K. ABRAHAM, "The Middle Assyrian Period", in: Security, p. 161-221: les contrats de prêt et les reconnaissances de dettes documentent 3 types de sûretés: le gage (šapartu), la garantie subsidiaire (kattû) et la garantie-ukâl. Outre l'étude des diverses techniques mises en œuvre par le créancier pour obtenir l'exécution de son obligation, l'a. s'intéresse aussi au contexte socio-économique de l'asservissement pour dettes.
D - S. DALLEY, compte rendu de R. Mattila, The King's Magnate (SAAS 11, 2000), BiOr 58, 2001, p. 197-206: ce long compte rendu aborde le débat entourant la traduction de lú sag = ša rêšên par "eunuque", en relisant plusieurs textes habituellement compris en référence aux castrats. Le § 15 LA in fine ne prévoit pas la castration de l'amant de l'épouse adultère (ce qui romprait l'égalité des sanctions entre les deux fautifs) mais une procédure spécifique, alternative à celle qui est conduite par le roi. Si le mari mutile sa femme, il remet l'amant à un officier-ša rêšên (tuâru ana ša rêšên, "livrer à un officier-ša rêšên" et non pas "transformer en eunuque") agissant à la place du roi et infligeant la même peine qu'à la femme. La même expression utilisée à propos de la fausse accusation de sodomie (§ 20 LA) signifie que le coupable sera remis à l'officier pour être astreint à la corvée. Le paragraphe des édits du harem consacré au courtisan (mazziz pâni) indique qu'il sera confirmé dans ses fonctions (MRR système II) et non pas castré (Grayson). La fonction de ša rêšên ne pouvait être transmise aux fils biologiques de l'officier, ce qui correspond à une pratique connue en Babylonie (§ 186-187 CH) et en Assyrie, consistant à imposer l'adoption des enfants des courtisans en leur interdisant une action en recherche de paternité. Leur nomination à un office public tenait alors compte de leurs aptitudes et non de leur ascendance, limitant ainsi les intrigues de palais et le népotisme. - K. DELLER, “The Assyrian Eunuchs and Their Predecessors", in: Priests, p. 303-311: les expression ša rêšên turru/marruru dans les LA et dans un édit du harem désignent la castration et laissent supposer un sens dérivé et euphémistique pour rêšu, “tête", désignant ici les testicules.
F - J. FINCKE, “Noch einmal zum mittelassyrischen šiluhli", AOF 21/2, 1994, p. 339-351: le šiluhli des sources mésoassyriennes est, comme le šelluhli des textes de Nuzi un travailleur agricole; le premier est un semi-libre, attaché à la terre qu'il travaille, tandis que le second est un homme libre. - H. FREYDANK, “Drei Tafeln aus der Verwaltung des mittelassyrischen Kronlandes", AOF 21/1, 1994, p. 13-30: transl., trad. et commentaire de 3 tablettes administratives trouvées à Assur concernant la liquidation de stocks de céréales (pišerti karû’e). Ces trois documents illustrent les relations qui unissent le pouvoir politique central et les administrations provinciales. - IDEM, “Gewänder für ein Dolmetscher", AOF 21/1, 1994, p. 31-33: éd. d'un fragment de tablette dans laquelle le roi récompense un interprète en lui offrant un vêtement. - IDEM, Mittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexte III, WVDOG 92, Berlin, 1994, 82 p.: catalogue, copie et index de 86 tablettes d'Assur qui intéressent l'administration (listes de personnes, gestion des stocks de céréales, contrats de travail) et le commerce extérieur. - IDEM, “Nachlese zu dem mittelassyrischen Gesetzen", AOF 21/2, 1994, p. 203-211: étude comparative des divers exemplaires des LA par rapport à l'original de Berlin. L'a. relit notamment la tabl. E, qui se rapporterait (§ 1) à certains groupes sociaux et (§§ 3-4) aux conditions de versement du salaire de travailleurs, et la tabl. K. - IDEM, “Zur Interpretation einer mittelassyrischen Urkunde aus Tell Chuêra", AOF 26, 1999, p. 207-209: le texte édité par C. Kühne (AOF 24) s'analyse comme un pense-bête administratif rédigé par un “groupe de dix" personnes (ešertu), illustrant un aspect du système de production et de distribution dans le cadre de l'administration du temple.
G - A. GHIROLDI, “Ruolo degli stranieri nei documenti economici medio-assiri", EVO 12, 1989, p. 145-151: recherche sur l'insertion des étrangers et leur statut aux XVe-XIIIe s., à partir de 200 textes provenant d'archives administratives ou privées d'Assur. Ces documents montrent la prédominance du groupe hourrite, notamment dans la fonction publique, à côté de populations cassites, amorréennes ou occidentales.
H - R. HAASE, "Grenzüberschreitungen im mittelassyrischen Rechtsbuch", ZAR 3, 1997, p. 202-206: étude des §§ 8-9 et 12-15 de la tabl. B des LA. Les dommages causés aux délimitations de terrains, envisagés par ces textes, ne sont pas considérés comme des sacrilèges, au contraire de la situation prévalant dans certains autres droits orientaux, notamment le droit biblique.
J - S. JAKOB, Mittelassyrische Verwaltung und Sozialstruktur, Untersuchungen, CM 29, 2003, lxi + 587 p.: synthèse sur l'organisation administrative du royaume assyrien examinant les différents secteurs de l'administration (administration centrale/locale, justice, armée, diplomatie) et les types de fonctions, regroupés par activités (agriculture, élevage, artisanat, commerce, culte). Les structures mises en place à la suite de l'expansion territoriale sont calquées sur le modèle de la ville d'Assur, et persisteront durablement puisqu'on les retrouve à l'époque néo-assyrienne.
M - D. MATTHEWS, "Middle Assyrian Glyptic from Tell Billa", Iraq 53, 1991, p. 17-42: les archives de Billa documentent l'utilisation des sceaux pour contracter une obligation ou contester une revendication. Le nombre de sceaux et la présence ou non de témoins dépendent du type d'acte considéré et de ses conséquences. - R. MATTILA, “Balancing the accounts of the Royal New Year's reception", SAAB IV/1, 1990, p. 8-22: l'a. s'intéresse aux fêtes du nouvel an d'après diverses sources administratives, sans doute des listes de rations d'aliments ou de cadeaux distribués pour la réception donnée à l'occasion des cérémonies du nouvel an royal dans la capitale.
O - E. OTTO, "Die Rechtsintentionen des Paragraphen 6 der Tafel A des mittelassyrischen Kodex in Tradition und Redaktion", UF 23, 1991, p. 306-314: le § 6 de la tablette A des LA doit être compris à la lumière du § 9 de la tablette C+G des LA: LA A 6 est une formulation elliptique de LA C+G 9, les deux textes exprimant la même règle: le preneur à gage qui reçoit illicitement le gage d'une femme ou d'un esclave doit le restituer. Ce rapprochement conduit à interpréter ensemble les §§ 5-6 LA A, qui énoncent des règles complémentaires: le § 5 punit le vol commis chez un tiers, et le § 6 envisage le dépôt en gage du bien volé (surqu) hors du domicile conjugal. Le gage est alors illicite puisqu'il sert à dissimuler l'objet dérobé.
P - E. PORADA, "Sidelights on Life in the 13th and 12th Centuries B.C. in Assyria", in: Crisis Years, p. 182-187: l'analyse des sceaux cylindres contemporains du règne de Ninurta-tukulti-Aššur (1133-1132) atteste l'influence culturelle des Hourrites, déportés en Assyrie depuis la fin du XIIIe s., à travers les représentations de créatures monstrueuses ou démoniaques.
V - P. VILLARD, “L'archivage public des contrats de vente d'immeubles d'après les Lois assyriennes", NABU 1996/61: le § 6 tabl. B des Lois assyriennes impose la rédaction en trois originaux des contrats de vente d'immeubles. Un exemplaire est destiné aux officiers-qêpu, qui représentent le roi, un autre revient à l'acheteur à titre de preuve de son acquisition. Le troisième serait attribué au scribe de la ville, représentant les autorités municipales, et non pas au vendeur, qui, en règle générale ne détient pas le contrat.
W - F. A. M. WIGGERMANN, "Agriculture in the Northern Balikh Valley. The Case of Middle Assyrian Tell Sabi Abyad", in: Rainfall, p. 171-231: cette synthèse sur l'agriculture assyrienne dans la région nord du Balih évoque l'irrigation et la culture pluviale, les zones agricoles, la production agricole, les rendements et les surplus, l'élevage et développe également la conception locale des fondements cosmiques de l'agriculture. L'unité rurale d'habitation, le dunnu, abrite 2 types de dépendants: 400 šiluhlu, partie non-libre de la population (100 familles), reçevant des rations et utilisant 500 ikû de terre, dont la moitié est cultivée chaque année; 440 fermiers âlayu (110 familles) cultivant env. 1260 ikû, et qui produisent leurs propres moyens de subsistance sur leur tenure. Le rendement annuel (421 kg/ha, soit 1:7.35) est très inférieur aux résultats actuels mais plutôt meilleur que ce que produit l'agriculture en dry-farming de Dur-katlimmu (en moyenne 1:3). L'intensité du travail est faible (un travailleur consacre 3/7e de son temps à la production agricole). Un quart des surplus est stocké, le reste est utilisé pour l'approvisionnement d'Aššur, du vice-roi, de l'armée, pour les distributions de rations et pour nourrir le bétail. L'a. joint l'éd. en copies et trs des tablettes de Tell Sabi Abyad utilisées pour cette étude.
C - E. CANCIK-KIRSCHBAUM, Die Mittelassyrischen Briefe aus Tell Šêh Hamad, Berichte der Ausgrabung Tall Šêh Hamad/Dûr-katlimmu 4, Texte 1, Berlin, 1996, xl + 245 p., 46 pl.: éd. de 46 lettres médio-assyriennes provenant du Tell Šêh Hamad, l'ancienne Dûr-Katlimmu. Très bonne introduction au genre des “lettres médio-assyriennes", soulignant les caractéristiques de ces documents. Bibliographie de toutes les lettres médio-assyriennes d'après le lieu de leur trouvaille; syllabaire des lettres provenant de Dûr-Katlimmu. Les lettres sont de caractère politique (n° 2, 3, 4, 6, 7, 14) administratif (n° 11, 12, 13, 15, 16, 21) et divers (n° 17, 18). Le n°10 décrit les préparatifs pour l'arrivée de la cour cassite et de celle du roi assyrien Tukultî-Ninurta Ier à Dûr-Katlimmu. - EADEM, "lú sâpi'u/sêpû. Eine akkadische Berufsbezeichnung aus dem Bereich der Textilherstellung", in: Fs Renger, p. 79-93: les occurrences de ce terme dans les sources médio-assyriennes et les textes lexicaux montrent que le sâpi'u est un artisan spécialisé dans la fabrication du feutre. Le mot vient de la racine araméenne spâ signifiant "réunir, accumuler".
D - K. DELLER, A. FADHIL, K. M. AHMAD, “Two New Royal Inscriptions dealing with Construction Work in Kar-Tukulti-Ninurta", BagM 25, 1994, p. 459-472: éd. complète de deux inscriptions relatant la construction des murailles de Kâr-Tukulti-Ninurta. - K. DELLER, F.M. FALES, L. JAKOB-ROST et V. DONBAZ, “Neo-Assyrian Texts from Assur, Private Archives in the Vorderasiatisches Museum of Berlin", SAAB 91/2, 1995, p. 3-137: suite de l'enquête publiée dans SAAB 5, intitulée par les aa. NATAPA 1 (dont les copies cunéiformes sont éditées par L. Jakob-Rost, F.M. Fales et E. Klengel-Brandt, Neuassyrischen Rechtsurkunden I, 1996), dans le cadre du projet international d'étude et de publication des archives privées d'Assur. Edition des textes N11 à N24 du catalogue d'O. Pedersén. Beaucoup de ces textes ont des liens prosopographiques et factuels entre eux. - M. DE ODOROCO, “Compositional and Editorial Processes of annalistic and Summary Texts of Tiglath-pileser I", SAAB 8/2, 1994, p. 67-112: à partir du travail de Grayson, l'a. reconstitue l'ordre chronologique hypothétique des inscriptions royales de Teglath-phalazar et en donne un bref commentaire. Le contenu de ces annales était soigneusement préparé, sans doute sur un brouillon, avant d'être rédigés dans leur version officielle. - V. DONBAZ, “The ‘House of Kings' in the city of Aššur", in: Fs Alp, p. 119-125: éd. complète d'une tablette contenant une liste d'offrandes, issue de l'archive de Ninurta-tukul-Aššur. La mention de la Maison des rois renvoie au cimetière royal de la ville d'Aššur, attesté jusqu'à l'époque d'Assurbanipal. - IDEM, "A Middle Assyrian Private Letter", in: Gs Cagni, vol. 1, p. 237-242: éd. d'une lettre privée écrite par Burakum à Ahâte, fille de Qibi-ilî.
F - F. M. FALES, “A Middle Assyrian Text concerning Vineyards and Fruit Groves", SAAB 3/1, 1989, p. 53-59: éd. complète d'une tablette appartenant à un collectionneur privé, datant du XIIIe s., et provenant des environs de Dur-Katlimmu (actuel Tell Shekh Hamad). Il s'agit d'une liste de vignobles associés à des NP et des NG. Ce texte apporte des informations sur les unités de mesure et le paysage agricole assyrien. - G. FRAME, Rulers of Babylonia, From the Second Dynasty of Isin to the End of Assyrian Domination (1157-621 BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia Babylonian Period, vol. 2, Toronto, 1995, 350 p.: recueil d’inscriptions royales qui s’étend chronologiquement de la chute des Cassites jusqu’à l’éffondrement du pouvoir assyrien en Babylonie. - H. FREYDANK, “Berliner Fragmente zu an-gim dím-ma", AOF 17/1, 1990, p. 180-181: copie de 3 fragments d'une tablette mésoassyrienne d'Aššur appartenant à la série sumérienne Angim (cf. J. Cooper, AnOr. 52). - IDEM, “Anmerkungen zu mittelassyrischen Texten 3", AOF 18/2, 1991, p. 219-223: série de remarques sur des sujets divers: le poids sûtu et sa valeur; le toponyme Zaqqu, dans RGTC 5, 281; l'éponyme d'un texte publié par Jankovskaj (VDI 1989/1, 82-85); un fragment de l'édit de Salmanazar Ier publié par A.R. George (Iraq 50, 25ss). - IDEM, "Das Archiv Assur 18764", AOF 19, 1992, p. 276-321: éd. des 32 tablettes composant une partie des archives de Šamaš-aha-ēriš, divisées en trois groupes correspondant à trois fonctionnaires du temple, et contenant des reconnaissances de dettes. - IDEM, “bitqî batâqu ‘Abschneidungen abschneiden?'", AOF 24/1, 1997, p. 105-114: étude de la tablette fragmentaire VAT 20328, dans laquelle le roi Tukulti-Ninurta Ier tranche un litige de droit des obligations en faveur du débiteur, héritier des dettes de son père. La tablette est transmise au fils du plaignant, qui peut donc se prévaloir d'une extinction de la dette. L'expression bitqî batâqu (l. 64) signifie “exécuter une exécution", non seulement en justice mais aussi entre parties, hors du cadre contentieux, comme le montre KAV 201, édité en copie, trs, trd et commentaire. Par extension, le bâtiqânu du § 40 LA n'est pas un “informateur" mais le représentant d'une partie, dans un procès, qui a accès au patrimoine personnel du coupable ou du débiteur. - IDEM, “Mittelassyrische Opferlisten aus Assur", RAI 39, p. 47-52: analyse des listes d'offrandes versées au temple d'Aššur par les provinces, à l'époque de Tiglat-phalazar Ier. - IDEM, “Noch einmal zum Vorgang pišerti karûie", in: Fs Röllig, p. 129-143: l'a. propose le sens de “liquidation d'un tas de grain" pour l'expression pišerti karû'e désigne la répartition sous contrôle d'un agent royal de la récolte de céréales de la couronne dans le cadre d'une campagne militaire, et désigne une sorte de “mainlevée" décidée par l'administration pour distribuer ses stocks. - IDEM, "Anmerkungen zu mittelassyrischen Texten. 4", AOF 30/2, 2003, p. 244-255: collations et relectures de divers textes médio-assyriens, notamment de DeZ 2521, un itinéraire trouvé à Dûr-Katlimmu.
H - V. HUROWITZ et J. GOODNICK WESTENHOLZ, “LKA 63: A Heroic Poem in Celebration of Tiglat-pileser I's Musru-Qumanu Campaign", JCS 42/1, 1990, p. 1-49: relecture d'une inscription royale mésoassyrienne soulignant la qualité de la facture littéraire et l'utilité historique du texte, notamment quant aux informations sur la préparation des batailles et la manière de fêter la victoire.
K - H. KÜHNE et W. RÖLLIG, “Das Siegel des Königs Salmanassar I von Assyrien", in: Fs Özgüç, p. 295-299: étude du sceau de Salmanazar Ier figurant sur des enveloppes de tablettes retrouvées dans le palais de Dûr-katlimmu (Tall Shekh Hamad). L'iconographie très particulière représente le roi devant une ziggourat de forme atypique.
L - J. LLOP, "Ein Fragment einer Königsinschrift Tukultî-Ninurtas I. zu seinene Babylonienfeldzügen (K 2667)", ZA 93/1, 2003, p. 82-87: éd. d'un fragment d'époque néo-assyrienne d'une inscription royale médio-assyrienne de Ninive, attribuée à Assur-dân Ier par Grayson (RIMA 1) et à Tukultî-Ninurta Ier par l'a., sur la base de critère toponymiques. Le texte apporte des détails sur terres conquises par les Assyriens lors de leur expédition contre Babylone. – IDEM, "Zur Tilgung von Surqu B in CAD Š/III", AOF 30, 2003, p. 3-10: relecture de la lettre MARV 1 71:32 et 35, visant à écarter l'interprétation du terme surqu “volé" par les lexicographes en référence à une catégorie de travailleurs.
M - M. P. MAIDMAN, review-article de J. N. Postgate, The Archive of Urad-Šerūa and his Family, 1988, BiOr 49, 1992, p. 153-161: en l'absence de contexte archéologique sûr et de critères internes suffisants, il est difficile de parler d'"archive" pour ce lot de textes, qui comporte seulement 84 documents. L'appellation "archive publique" n'est pas démontrée non plus, le corpus contenant des sources privées et publiques. Il est dès lors hasardeux de construire sur une base aussi incertaine une théorie sur les relations entre les grandes familles provinciales et l'aristocratie d'Assur ou la couronne. - S. M. MAUL, Die Inschriften von tall Bderi, BBVOT 2, Berlin, 1992, 78 p., 8 pl.: éd. des inscriptions sur cylindres et sur les sceaux médio-assyriens du site de Tell Bdêri, situé sur le Habur inférieur.
P - O. PEDERSÉN, “The structure of VS 19, 47", NABU 1991/51: l'obscurité de ce texte tenait à sa publication erronée. Il s'agit, après remise à l'endroit du document, d'une tablette contenant 8 prêts en blé consentis par l'administration des greniers, agissant par l'intermédiaire d'un scribe, fonctionnaire municipal de Kurda. La tablette n'ayant pas été détruite, il faut en déduire que les prêts n'ont pas été remboursés, c'est pourquoi le scribe l'a transmise à Urad-Šerû’a ou à son père pour prendre une décision. - IDEM, “Gräber und Archive in mesopotamischen Wohnhäusern- besonders Gruft 45 in Assur und Archiv des Babu-aha-iddina", in: Fs Strommenger, p. 163-169: à propos des 90 tablettes de Babu-aha-iddina, un haut dignitaire assyrien du XIIIe s. Le lot se compose de lettres et de documents administratifs concernant la gestion des biens familiaux. L'a. insiste sur le rapport existant entre le lieu de découverte des tablettes et la présence en sous-sol du caveau familial. - IDEM, “Eine mittelassyrische Tontafel aus Assur im British Museum", MDOG 129, 1997, p. 171-172: compléments sur l'interprétation du mémorandum de boulangerie publié par Postgate (SAA 8, 1994), qui appartient apparemment à l'archive de Mušallim-Marduk conservée à Istanbul. - J. N. POSTGATE, “A Middle Assyrian Bakery Memorandum", SAAB 8, 1994, p. 13-15: éd. complète d'une tablette sans doute d'Assur, consignant un reçu de diverses quantités de pain et de farine, peut-être pour une cérémonie laïque ou religieuse en présence du roi. - IDEM, “Gleanings from ADD. 1. One of the First Assyrian Texts Found at Assur", SAAB VII/1, 1993, p. 5-7: la relecture de ADD I, 173 est l'occasion de comprendre la forme RI-pi-tu en talpittu, “enduire", en référence à une onction d'huile. - IDEM, " 'Queen' in Middle Assyrian', NABU 2001/40: relecture de la lettre à Aššur-iddin, gouverneur de Dur-katlimmu, sur la composition du cortège royal qui doit venir le trouver. On y trouve mention de la reine, évoquée de manière métonymique et par déférence envers son rang, à travers le terme é-gal-lim “palais".
R - J. L. RADUÀ, "Ein weiterer mA Beleg zu Dunni-Aššur", NABU 2002/15: en complément à l'article de M. Luciani, l'a. ajoute un texte de Tell Sabi Abyad, qui pourrait être selon l'éditeur (F. Wiggermann) le nom moderne de Dunni-Aššur.
T - R. -J. TOURNAY, “La stèle du roi Tukulti-Ninurta II", Subartu IV/2, 1998, p. 273-278: nouvelles trs, trd et commentaire de la stèle trouvée à Terqa. - A. TSUKIMOTO, “Aus einer japanischer Privatsammlung: Drei Verwaltungstexte und ein Breif aus mittelassyrischer Zeit", WO 23, 1992, p. 21-38: éd. complète de 4 tablettes de Dûr-katlimmu (l'actuel Tell Schech-Hamad), à rattacher à l'archive de cette ville publiée par Röllig et Kühne. Le lot comporte une liste de bétail, une liste de rations de laine pour des femmes, une créance d'orge et une lettre à Aššur-iddin, šukallu de Dûr-katlimmu.
V - G. VAN DRIEL et R. JAS, "A second middle assyrian LB text on gold", JEOL 31, 1989-1990, p. 63-65: éd. complète d'une tablette et de son enveloppe appartenant à la collection De Liagre Böhl, et concernant une transaction sur une petite quantité d'or. Le métal précieux accompagnait peut-être la tablette, inséré dans l'enveloppe.
W - G. WILHELM, “Der mittleassyrische Brief eines Verwalters an seinen Herrn", in: Fs Röllig, p. 431-434: éd. complète d'une tablette endommagée appartenant à une collection privée et datée de Salmanazar Ier. Il s'agit d'une lettre envoyée par un agent administratif à son supérieur hiérarchique.
K - C. KÜHNE, “Ein mittelassyrischer Kulttext aus der westlichen Gezira", AOF 24/2, 1997, p. 383-389: éd. complète d'une tablette de Tell Chuêra contenant une liste de cérémonies cultuelles mensuelles.
M - M. MÜLLER, “Die ‘grossen Götter' Tiglatpilesars I.", AOF 22/1, 1995, p. 151-156: l'éd. d'un fragment d'une tablette de collection privée complétant les deux inscriptions royales de Tiglat-phalazar Ier permet d'ajouter deux nouvelles divinités à la liste des “grands dieux", Anu et Ea.
|